2006-03-31
La SF à l'écran... en 1960
Après avoir évoqué des films de 1954, 1955 et 1976, rendons hommage à la première adaptation au grand écran d'un roman de Stanislas Lem, malheureusement décédé cette semaine au terme d'une carrière des plus significatives dans plusieurs domaines, dont celui de la science-fiction mais aussi de la pensée sur la technologie.
Le premier roman de Lem, Astronauci, est connu en anglais sous le titre The Astronauts, en français, sous celui de Feu Vénus, et sous celui de Der Planet des Todes en allemand. Le film qui en a été tiré a connu un destin encore plus mouvementé. Coproduction de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est, essentiellement filmée dans les studios de la DEFA à Babelsberg en banlieue de Berlin, l'œuvre est la victime du contexte politique de l'après-Spoutnik et coïncide avec les tensions associées à la conférence de Paris. L'histoire remaniée sous la pression des autorités politiques met l'accent sur le pacifisme, sur l'internationalisme et sur l'horreur de l'arme atomique, explicitement (et quasi uniquement) associée à Hiroshima.
Le film est sorti en Pologne sous le titre de Milczaca Gwiazda et en Europe francophone sous le titre de L'Étoile du silence, mais le monde anglophone n'en connaîtra qu'une version charcutée, First Spaceship on Venus. Ce sont près de quinze minutes qui disparaissent au (dé)montage qui produit une version susceptible d'être distribuée en Allemagne de l'Ouest et aux États-Unis. Le capitaine russe de la fusée Cosmocrator est ainsi réduit à un rôle de simple figurant...
Malgré des choix narratifs douteux, l'intrigue demeure digne de respect. Vers 1970, la découverte d'un cylindre d'origine extraterrestre est associée à l'explosion de la Toungouska en 1908. Il contient un message et serait d'origine vénusienne. Le bloc socialiste décide d'envoyer une mission internationale sur Vénus pour en apprendre plus en utilisant une nouvelle fusée, le Cosmocrator, qui a tout juste assez d'avance sur sa concurrente étatsunienne pour qu'un savant des États-Unis, Hawling, soit obligé de se joindre à l'équipage. En chemin, le décodage du message révèle que les Vénusiens planifiaient l'extermination de l'humanité et la conquête de la Terre. Sur Vénus, les explorateurs découvrent les restes d'une civilisation disparue, qui s'est détruite elle-même dans une catastrophe nucléaire totale.
La première moitié du film est plutôt didactique, car les événements sont racontés (par une voix off) plutôt que montrés. On rencontre les membres de l'équipage international de huit personnes, qui comprend un capitaine russe, un ingénieur polonais du nom de Soltyk qui est cybernéticien (petit clin d'œil à Lem?) et qui a construit un robot mobile sur chenillettes appelé Oméga, un linguiste chinois, un autre de l'Inde, un pilote allemand, un physicien étatsunien et, comme médecin, une Japonaise, Sumiko, dont la mère est morte à Hiroshima. Le personnage africain, Talua, semble surtout affecté aux communications — ce qui peut rappeler le rôle dévolu à Uhura dans Star Trek, quelques années plus tard... (Une journaliste du nom de Jeanne Moreau apparaît brièvement, mais je n'ai pas pu déterminer s'il s'agit de l'actrice française. En revanche, Yves Montand et Simone Signoret avaient été pressentis avant de refuser.)
Le compte à rebours (qui rend hommage à la tradition inaugurée dans le précédent film de science-fiction tourné en Allemagne, Frau im Mond de Lang en 1928) lance la fusée dans l'espace et met aussi sur orbite le film, qui commence enfin à devenir plus intéressant. La réalisation de Kurt Maetzig (1911-?) est assez ordinaire, ainsi que la fusée et les costumes (les combinaisons spatiales — en cuir? — semblent assez primitives). En revanche, les décors vénusiens et les effets spéciaux sont des plus originaux. Le film exploite le procédé Schüfftan, qui permet d'intégrer les acteurs dans des décors artificiels de plus petite taille.
C'est relativement efficace, mais ce qui frappe surtout, c'est le style des décors, qui doit sans doute quelque chose aux recherches d'artistes comme Max Ernst ou Yves Tanguy dans le cadre du surréalisme et de l'expressionnisme. En science-fiction, on pense plutôt aux illustrations de Richard M. Powers aux États-Unis, qui avait commencé à creuser cette veine vers 1953. Et les deux tours penchées (voir l'illustration originale d'Alfred Hirschmeier à droite) qui se trouvent au cœur du centre de commandement vénusien rappellent assez le projet de Vladimir Tatline pour un monument à la IIIe Internationale (ce qui pourrait introduire une note subversive dans ce qui est ouvertement un film pro-communiste...). La « super-science » invoquée pour expliquer le fonctionnement de l'arme vénusienne destinée à exterminer toute vie humaine sur Terre a aussi quelque chose d'assez baroque pour amuser.
ou Yves Tanguy dans le cadre du surréalisme et de l'expressionnisme. En science-fiction, on pense plutôt aux illustrations de Richard M. Powers aux États-Unis, qui avait commencé à creuser cette veine vers 1953. Et les deux tours penchées (voir l'illustration originale d'Alfred Hirschmeier à droite) qui se trouvent au cœur du centre de commandement vénusien rappellent assez le projet de Vladimir Tatline pour un monument à la IIIe Internationale (ce qui pourrait introduire une note subversive dans ce qui est ouvertement un film pro-communiste...). La « super-science » invoquée pour expliquer le fonctionnement de l'arme vénusienne destinée à exterminer toute vie humaine sur Terre a aussi quelque chose d'assez baroque pour amuser.
Bref, même si on prend avec un grain de sel capitaliste les bonnes intentions du film, on peut admirer les décors et goûter un film qui s'insère assez bien dans l'histoire de la science-fiction à l'écran entre Planète interdite et Star Trek.
Le premier roman de Lem, Astronauci, est connu en anglais sous le titre The Astronauts, en français, sous celui de Feu Vénus, et sous celui de Der Planet des Todes en allemand. Le film qui en a été tiré a connu un destin encore plus mouvementé. Coproduction de la Pologne et de l'Allemagne de l'Est, essentiellement filmée dans les studios de la DEFA à Babelsberg en banlieue de Berlin, l'œuvre est la victime du contexte politique de l'après-Spoutnik et coïncide avec les tensions associées à la conférence de Paris. L'histoire remaniée sous la pression des autorités politiques met l'accent sur le pacifisme, sur l'internationalisme et sur l'horreur de l'arme atomique, explicitement (et quasi uniquement) associée à Hiroshima.
Le film est sorti en Pologne sous le titre de Milczaca Gwiazda et en Europe francophone sous le titre de L'Étoile du silence, mais le monde anglophone n'en connaîtra qu'une version charcutée, First Spaceship on Venus. Ce sont près de quinze minutes qui disparaissent au (dé)montage qui produit une version susceptible d'être distribuée en Allemagne de l'Ouest et aux États-Unis. Le capitaine russe de la fusée Cosmocrator est ainsi réduit à un rôle de simple figurant...
Malgré des choix narratifs douteux, l'intrigue demeure digne de respect. Vers 1970, la découverte d'un cylindre d'origine extraterrestre est associée à l'explosion de la Toungouska en 1908. Il contient un message et serait d'origine vénusienne. Le bloc socialiste décide d'envoyer une mission internationale sur Vénus pour en apprendre plus en utilisant une nouvelle fusée, le Cosmocrator, qui a tout juste assez d'avance sur sa concurrente étatsunienne pour qu'un savant des États-Unis, Hawling, soit obligé de se joindre à l'équipage. En chemin, le décodage du message révèle que les Vénusiens planifiaient l'extermination de l'humanité et la conquête de la Terre. Sur Vénus, les explorateurs découvrent les restes d'une civilisation disparue, qui s'est détruite elle-même dans une catastrophe nucléaire totale.
La première moitié du film est plutôt didactique, car les événements sont racontés (par une voix off) plutôt que montrés. On rencontre les membres de l'équipage international de huit personnes, qui comprend un capitaine russe, un ingénieur polonais du nom de Soltyk qui est cybernéticien (petit clin d'œil à Lem?) et qui a construit un robot mobile sur chenillettes appelé Oméga, un linguiste chinois, un autre de l'Inde, un pilote allemand, un physicien étatsunien et, comme médecin, une Japonaise, Sumiko, dont la mère est morte à Hiroshima. Le personnage africain, Talua, semble surtout affecté aux communications — ce qui peut rappeler le rôle dévolu à Uhura dans Star Trek, quelques années plus tard... (Une journaliste du nom de Jeanne Moreau apparaît brièvement, mais je n'ai pas pu déterminer s'il s'agit de l'actrice française. En revanche, Yves Montand et Simone Signoret avaient été pressentis avant de refuser.)
Le compte à rebours (qui rend hommage à la tradition inaugurée dans le précédent film de science-fiction tourné en Allemagne, Frau im Mond de Lang en 1928) lance la fusée dans l'espace et met aussi sur orbite le film, qui commence enfin à devenir plus intéressant. La réalisation de Kurt Maetzig (1911-?) est assez ordinaire, ainsi que la fusée et les costumes (les combinaisons spatiales — en cuir? — semblent assez primitives). En revanche, les décors vénusiens et les effets spéciaux sont des plus originaux. Le film exploite le procédé Schüfftan, qui permet d'intégrer les acteurs dans des décors artificiels de plus petite taille.
C'est relativement efficace, mais ce qui frappe surtout, c'est le style des décors, qui doit sans doute quelque chose aux recherches d'artistes comme Max Ernst
 ou Yves Tanguy dans le cadre du surréalisme et de l'expressionnisme. En science-fiction, on pense plutôt aux illustrations de Richard M. Powers aux États-Unis, qui avait commencé à creuser cette veine vers 1953. Et les deux tours penchées (voir l'illustration originale d'Alfred Hirschmeier à droite) qui se trouvent au cœur du centre de commandement vénusien rappellent assez le projet de Vladimir Tatline pour un monument à la IIIe Internationale (ce qui pourrait introduire une note subversive dans ce qui est ouvertement un film pro-communiste...). La « super-science » invoquée pour expliquer le fonctionnement de l'arme vénusienne destinée à exterminer toute vie humaine sur Terre a aussi quelque chose d'assez baroque pour amuser.
ou Yves Tanguy dans le cadre du surréalisme et de l'expressionnisme. En science-fiction, on pense plutôt aux illustrations de Richard M. Powers aux États-Unis, qui avait commencé à creuser cette veine vers 1953. Et les deux tours penchées (voir l'illustration originale d'Alfred Hirschmeier à droite) qui se trouvent au cœur du centre de commandement vénusien rappellent assez le projet de Vladimir Tatline pour un monument à la IIIe Internationale (ce qui pourrait introduire une note subversive dans ce qui est ouvertement un film pro-communiste...). La « super-science » invoquée pour expliquer le fonctionnement de l'arme vénusienne destinée à exterminer toute vie humaine sur Terre a aussi quelque chose d'assez baroque pour amuser.Bref, même si on prend avec un grain de sel capitaliste les bonnes intentions du film, on peut admirer les décors et goûter un film qui s'insère assez bien dans l'histoire de la science-fiction à l'écran entre Planète interdite et Star Trek.
Libellés : Films, Science-fiction
In Memoriam Louise Trudel, 1936-2006
Il y a une semaine, ma tante Louise est morte au terme d'une longue maladie. Ce n'était donc pas une surprise que ce décès attendu, mais c'est quand même une autre partie de ma famille qui disparaît et, avec elle, beaucoup de souvenirs et de liens avec des parents proches et plus éloignés.
Née à Saint-Boniface au Manitoba le 23 août 1936, Louise était la benjamine de la famille Trudel, la fille du docteur Jean-Joseph Trudel et de Margherita Chevrier. Mais la petite fillette aux joues rondes des plus anciennes photos — dont celle du 13 mai 1942 à gauche où on la voit avec un Colt à la ceinture — est devenue très tôt une patineuse déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle n'a jamais changé. C'est cette détermination qu'il faut lire sans
Chevrier. Mais la petite fillette aux joues rondes des plus anciennes photos — dont celle du 13 mai 1942 à gauche où on la voit avec un Colt à la ceinture — est devenue très tôt une patineuse déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle n'a jamais changé. C'est cette détermination qu'il faut lire sans doute dans la photo de droite, qui date de septembre 1945, où la jeune Louise n'est pas à son meilleur mais n'a pas l'air disposée à s'en laisser conter.
doute dans la photo de droite, qui date de septembre 1945, où la jeune Louise n'est pas à son meilleur mais n'a pas l'air disposée à s'en laisser conter.
Longtemps avant Cindy Klassen, Winnipeg était une capitale mondiale du patinage de vitesse (le championnat du monde tenu à Montréal en 1897 avait été remporté par Jack McCulloch de Winnipeg) et elle l'est restée longtemps, tandis que d'autres villes nord-américaines optaient pour la pratique du hockey. Louise profite de la présence dans son quartier du club de patinage de vitesse de Norwood—Saint-Boniface pour s'y mettre. En 1944, elle est championne nord-américaine des filles de moins de 10 ans dans la photo de droite, prise le 19 février 1944. Pendant plusieurs années, elle disputera des courses sur plus d'une piste glacée du Canada ou des États-Unis, arrivant souvent la première et décrochant une série de titres. Quand on connaît les hivers rigoureux de Winnipeg, on ne peut qu'admirer la persévérance qui l'a toujours distinguée. Pour quitter la maison et aller s'exercer le soir, à la nuit tombée, sur une piste à ciel ouvert en plein hiver, il fallait une ténacité peu ordinaire. En 1947, elle est championne canadienne de patinage de vitesse des filles midget. Comme
Pendant plusieurs années, elle disputera des courses sur plus d'une piste glacée du Canada ou des États-Unis, arrivant souvent la première et décrochant une série de titres. Quand on connaît les hivers rigoureux de Winnipeg, on ne peut qu'admirer la persévérance qui l'a toujours distinguée. Pour quitter la maison et aller s'exercer le soir, à la nuit tombée, sur une piste à ciel ouvert en plein hiver, il fallait une ténacité peu ordinaire. En 1947, elle est championne canadienne de patinage de vitesse des filles midget. Comme  on peut le voir dans la photo de gauche, prise en février 1947, l'uniforme n'avait rien à voir avec ce que les patineuses portent aujourd'hui... Plus tard, elle deviendrait championne nationale junior, ce qui lui a valu plus tard d'être immortalisée dans la catégorie des pionnières du Sports Hall of Fame manitobain. Mais le sport qu'elle a pratiqué le plus longtemps et le plus assidûment, c'est sans doute le ski. Elle consacrait quelques semaines chaque année à un séjour sur les pentes, à Vail au Colorado ou ailleurs. Mais elle était aussi une randonneuse à l'occasion et n'avait pas dédaigné de s'initier à l'ornithologie. Cette année encore, elle avait fait un dernier voyage à Vail, moins pour skier que pour retrouver des lieux qu'elle connaissait et qu'elle aimait.
on peut le voir dans la photo de gauche, prise en février 1947, l'uniforme n'avait rien à voir avec ce que les patineuses portent aujourd'hui... Plus tard, elle deviendrait championne nationale junior, ce qui lui a valu plus tard d'être immortalisée dans la catégorie des pionnières du Sports Hall of Fame manitobain. Mais le sport qu'elle a pratiqué le plus longtemps et le plus assidûment, c'est sans doute le ski. Elle consacrait quelques semaines chaque année à un séjour sur les pentes, à Vail au Colorado ou ailleurs. Mais elle était aussi une randonneuse à l'occasion et n'avait pas dédaigné de s'initier à l'ornithologie. Cette année encore, elle avait fait un dernier voyage à Vail, moins pour skier que pour retrouver des lieux qu'elle connaissait et qu'elle aimait.
En 1958, elle termine ses études à l'école des infirmières de l'hôpital de Saint-Boniface. Armée de son diplôme du St. Boniface School of Nursing, elle travaille dans plusieurs hôpitaux au Manitoba et en Ontario avant de poursuivre sa formation au Johns Hopkins Hospital à Baltimore, Maryland, qui était déjà parmi les plus réputés au monde. Elle voyage plus loin encore, car elle se rend en Europe, où travaille son frère, et elle ramènera de nombreux souvenirs d'un grand voyage qui la mène de la France à la Suède. Elle s'installe à Toronto en 1966, débutant une carrière de trente ans au Toronto Western Hospital.
Femme de grande culture, elle était une force tranquille et une amie appréciée de nombreuses personnes. Elle s'intéressait aussi bien aux sports et au cinéma qu'à la littérature et à l'histoire, y compris à sa propre histoire familiale (dont j'ai donné quelques aperçus sur ce blogue). Elle goûtait le bon vin, la bonne musique, la verrerie de qualité et les objets d'art. Son soutien m'a été précieux et je lui ai dédié Les insurgés de Tianjin, le volume qui concluait ma décalogie pour jeunes, « L'Ère du Nouvel Empire », chez Médiaspaul.
Une année, elle m'a demandé en cadeau Citadelle, d'Antoine Saint-Exupéry. J'y ai cherché des mots, rien que des mots, pour dire ce qu'elle a été. Saint-Exupéry est l'écrivain de l'action, de la réalisation, de l'être humain qui s'accomplit par ce qu'il accomplit dans le monde, et aussi envers et contre le monde. « Et le plaisir de former la fleur, de vaincre la tempête, de bâtir le temple, se distingue du plaisir de posséder une fleur faite, une tempête vaincue, un temple debout. » Ouvrage des ultimes années de l'auteur français, rédigé entre 1936 et 1944, Citadelle est le plus religieux de ses livres. On peut comprendre Le petit prince comme une distillation des thèmes abordés par Citadelle, dont le personnage principal est aussi un prince, non d'un astéroïde mais d'une cité et d'un royaume quelque part dans le désert.
Pourtant, si le nom de Dieu, du Seigneur, reviens assez souvent, Saint-Exupéry fait plutôt de la permanence des choses, des faits, des gestes posés (ou plus exactement peut-être de leur rémanence) la justification de nos vies. « Car tu n'as rien à espérer si rien ne dure plus que toi. » Dieu, lui, est tout au plus le sens du monde. Écrivant dans l'ombre de la guerre, car il ne faut pas oublier qu'il a connu la guerre civile en Espagne dès l'été 1936, Saint-Exupéry écrit aussi dans l'ombre de la mort et il est d'autant plus attaché à ce qui survit, ou à ce qui, ayant vécu, a été réel et ne saurait cesser de l'être. « Et certes il existe, l'irréparable, mais il n'y a rien là qui soit triste ou gai, c'est l'essence même de ce qui fut. »

Née à Saint-Boniface au Manitoba le 23 août 1936, Louise était la benjamine de la famille Trudel, la fille du docteur Jean-Joseph Trudel et de Margherita
 Chevrier. Mais la petite fillette aux joues rondes des plus anciennes photos — dont celle du 13 mai 1942 à gauche où on la voit avec un Colt à la ceinture — est devenue très tôt une patineuse déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle n'a jamais changé. C'est cette détermination qu'il faut lire sans
Chevrier. Mais la petite fillette aux joues rondes des plus anciennes photos — dont celle du 13 mai 1942 à gauche où on la voit avec un Colt à la ceinture — est devenue très tôt une patineuse déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle n'a jamais changé. C'est cette détermination qu'il faut lire sans doute dans la photo de droite, qui date de septembre 1945, où la jeune Louise n'est pas à son meilleur mais n'a pas l'air disposée à s'en laisser conter.
doute dans la photo de droite, qui date de septembre 1945, où la jeune Louise n'est pas à son meilleur mais n'a pas l'air disposée à s'en laisser conter.Longtemps avant Cindy Klassen, Winnipeg était une capitale mondiale du patinage de vitesse (le championnat du monde tenu à Montréal en 1897 avait été remporté par Jack McCulloch de Winnipeg) et elle l'est restée longtemps, tandis que d'autres villes nord-américaines optaient pour la pratique du hockey. Louise profite de la présence dans son quartier du club de patinage de vitesse de Norwood—Saint-Boniface pour s'y mettre. En 1944, elle est championne nord-américaine des filles de moins de 10 ans dans la photo de droite, prise le 19 février 1944.
 Pendant plusieurs années, elle disputera des courses sur plus d'une piste glacée du Canada ou des États-Unis, arrivant souvent la première et décrochant une série de titres. Quand on connaît les hivers rigoureux de Winnipeg, on ne peut qu'admirer la persévérance qui l'a toujours distinguée. Pour quitter la maison et aller s'exercer le soir, à la nuit tombée, sur une piste à ciel ouvert en plein hiver, il fallait une ténacité peu ordinaire. En 1947, elle est championne canadienne de patinage de vitesse des filles midget. Comme
Pendant plusieurs années, elle disputera des courses sur plus d'une piste glacée du Canada ou des États-Unis, arrivant souvent la première et décrochant une série de titres. Quand on connaît les hivers rigoureux de Winnipeg, on ne peut qu'admirer la persévérance qui l'a toujours distinguée. Pour quitter la maison et aller s'exercer le soir, à la nuit tombée, sur une piste à ciel ouvert en plein hiver, il fallait une ténacité peu ordinaire. En 1947, elle est championne canadienne de patinage de vitesse des filles midget. Comme  on peut le voir dans la photo de gauche, prise en février 1947, l'uniforme n'avait rien à voir avec ce que les patineuses portent aujourd'hui... Plus tard, elle deviendrait championne nationale junior, ce qui lui a valu plus tard d'être immortalisée dans la catégorie des pionnières du Sports Hall of Fame manitobain. Mais le sport qu'elle a pratiqué le plus longtemps et le plus assidûment, c'est sans doute le ski. Elle consacrait quelques semaines chaque année à un séjour sur les pentes, à Vail au Colorado ou ailleurs. Mais elle était aussi une randonneuse à l'occasion et n'avait pas dédaigné de s'initier à l'ornithologie. Cette année encore, elle avait fait un dernier voyage à Vail, moins pour skier que pour retrouver des lieux qu'elle connaissait et qu'elle aimait.
on peut le voir dans la photo de gauche, prise en février 1947, l'uniforme n'avait rien à voir avec ce que les patineuses portent aujourd'hui... Plus tard, elle deviendrait championne nationale junior, ce qui lui a valu plus tard d'être immortalisée dans la catégorie des pionnières du Sports Hall of Fame manitobain. Mais le sport qu'elle a pratiqué le plus longtemps et le plus assidûment, c'est sans doute le ski. Elle consacrait quelques semaines chaque année à un séjour sur les pentes, à Vail au Colorado ou ailleurs. Mais elle était aussi une randonneuse à l'occasion et n'avait pas dédaigné de s'initier à l'ornithologie. Cette année encore, elle avait fait un dernier voyage à Vail, moins pour skier que pour retrouver des lieux qu'elle connaissait et qu'elle aimait.En 1958, elle termine ses études à l'école des infirmières de l'hôpital de Saint-Boniface. Armée de son diplôme du St. Boniface School of Nursing, elle travaille dans plusieurs hôpitaux au Manitoba et en Ontario avant de poursuivre sa formation au Johns Hopkins Hospital à Baltimore, Maryland, qui était déjà parmi les plus réputés au monde. Elle voyage plus loin encore, car elle se rend en Europe, où travaille son frère, et elle ramènera de nombreux souvenirs d'un grand voyage qui la mène de la France à la Suède. Elle s'installe à Toronto en 1966, débutant une carrière de trente ans au Toronto Western Hospital.
Femme de grande culture, elle était une force tranquille et une amie appréciée de nombreuses personnes. Elle s'intéressait aussi bien aux sports et au cinéma qu'à la littérature et à l'histoire, y compris à sa propre histoire familiale (dont j'ai donné quelques aperçus sur ce blogue). Elle goûtait le bon vin, la bonne musique, la verrerie de qualité et les objets d'art. Son soutien m'a été précieux et je lui ai dédié Les insurgés de Tianjin, le volume qui concluait ma décalogie pour jeunes, « L'Ère du Nouvel Empire », chez Médiaspaul.
Une année, elle m'a demandé en cadeau Citadelle, d'Antoine Saint-Exupéry. J'y ai cherché des mots, rien que des mots, pour dire ce qu'elle a été. Saint-Exupéry est l'écrivain de l'action, de la réalisation, de l'être humain qui s'accomplit par ce qu'il accomplit dans le monde, et aussi envers et contre le monde. « Et le plaisir de former la fleur, de vaincre la tempête, de bâtir le temple, se distingue du plaisir de posséder une fleur faite, une tempête vaincue, un temple debout. » Ouvrage des ultimes années de l'auteur français, rédigé entre 1936 et 1944, Citadelle est le plus religieux de ses livres. On peut comprendre Le petit prince comme une distillation des thèmes abordés par Citadelle, dont le personnage principal est aussi un prince, non d'un astéroïde mais d'une cité et d'un royaume quelque part dans le désert.
Pourtant, si le nom de Dieu, du Seigneur, reviens assez souvent, Saint-Exupéry fait plutôt de la permanence des choses, des faits, des gestes posés (ou plus exactement peut-être de leur rémanence) la justification de nos vies. « Car tu n'as rien à espérer si rien ne dure plus que toi. » Dieu, lui, est tout au plus le sens du monde. Écrivant dans l'ombre de la guerre, car il ne faut pas oublier qu'il a connu la guerre civile en Espagne dès l'été 1936, Saint-Exupéry écrit aussi dans l'ombre de la mort et il est d'autant plus attaché à ce qui survit, ou à ce qui, ayant vécu, a été réel et ne saurait cesser de l'être. « Et certes il existe, l'irréparable, mais il n'y a rien là qui soit triste ou gai, c'est l'essence même de ce qui fut. »

Good night, sweet prince.
2006-03-30
Futur et contre-futur
La binarité des futurs possibles — des futuribles — est d'ordinaire exprimée par l'alternative utopie ou dystopie. Pourtant, l'utopie n'est pas toujours associée au futur; depuis More jusqu'au XIXe siècle, les auteurs ont couramment localisé les utopies qu'ils imaginaient aux antipodes du monde connu, mais dans un cadre contemporain. Entre autres, Bellamy a lancé le mouvement de l'amélioration du futur avec Looking Backward: 2000-1887 (1888), mais l'anticipation libérale et progressiste, depuis les ébauches encore hésitantes de Mercier et Shelley, avait déjà commencé à occuper le terrain. L'anticipation négative est presque aussi ancienne. Les récits de fin du monde, dès le début du XIXe siècle, et les guerres futures de la fin du même siècle proposaient déjà des futurs sombres et menaçants, en particulier à ceux qui refusaient d'entendre leurs avertissements...
Toutefois, ces futurs imaginaires n'entrent pas tout à fait dans la même catégorie que les futurs calculés, planifiés et extrapolés du XXe siècle. Les architectes, les ingénieurs, les inventeurs et par-dessus tout les scientifiques proposent des futurs qu'ils tiennent pour réalisables, sinon inévitables, en se basant sur les effets de telle ou telle invention ou le prolongement de telle ou telle tendance. Leurs scénarios ont souvent été optimistes, en particulier dans le contexte nord-américain qu'évoque Mario Tessier dans le dernier numéro de Solaris. Après tout, ils devaient bien vendre leur camelote, et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre...
Mais il y a aussi eu des futurs plus sombres, proposés avec un égal sérieux. Les anticipations politiques, contrairement aux anticipations sociales (communistes ou autres) et aux anticipations technico-économiques, ont souvent été de nature dystopique. En politique, la peur du bâton est plus efficace que l'attrait de la carotte. Les marchands de parano ont donc souvent misé sur des scénarios pessimistes, du Péril Jaune à la menace rouge au «fascisme vert»... Comme il reste encore quelques noms de couleurs, nous n'en avons sans doute pas fini avec eux. (Évidemment, même les paranos ont des ennemis : la peur est plus aigüe — et mauvaise conseillère — si l'on a conscience de s'être fait des ennemis...) Et quand l'invasion ennemie devient improbable, on peut toujours miser sur la hantise du déclin, de Spengler à Baverez.
Mais je ne parle pas de ça. L'hiver nucléaire de Sagan et compagnie permet plutôt de faire le lien entre ces pronostics de catastrophes politiques et les contre-futurs qui ont animé la contre-culture après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'extrapolations réalistes ou présentées comme telles, dans plusieurs domaines, dont ceux du climat, de la biodiversité, de l'environnement, de la disponibilité des ressources... Les versions les plus connues ont été fournies par le Club de Rome fondé en 1968, mais de nombreux experts ont proposé leurs propres scénarios dans les champs qui leur étaient propres. L'épuisement des ressources, la disparition des espèces, la pollution des environnements naturels, le réchauffement global, l'amincissement de la couche d'ozone... autant de points de départ de futurs aussi peu reluisants que les avenirs des technophiles façon Bel Geddes, Apple ou Wired étaient chromés et bien astiqués.
Conclusion temporaire : on n'a pas cessé de s'intéresser au futur, mais il existe sans doute un déséquilibre actuel en faveur des futurs les plus inquiétants. Les futurs d'autrefois ont pris de l'âge et montrent leurs rides; on attend la relève. Si les jeunes générations tardent à se manifester en défendant des visions radicalement novatrices, est-ce parce qu'elles sont obnubilées par le dernier-né des contre-futurs, celui de vies professionnelles entièrement consacrées à payer pour les retraites de leurs aînés du baby-boom?
Toutefois, ces futurs imaginaires n'entrent pas tout à fait dans la même catégorie que les futurs calculés, planifiés et extrapolés du XXe siècle. Les architectes, les ingénieurs, les inventeurs et par-dessus tout les scientifiques proposent des futurs qu'ils tiennent pour réalisables, sinon inévitables, en se basant sur les effets de telle ou telle invention ou le prolongement de telle ou telle tendance. Leurs scénarios ont souvent été optimistes, en particulier dans le contexte nord-américain qu'évoque Mario Tessier dans le dernier numéro de Solaris. Après tout, ils devaient bien vendre leur camelote, et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre...
Mais il y a aussi eu des futurs plus sombres, proposés avec un égal sérieux. Les anticipations politiques, contrairement aux anticipations sociales (communistes ou autres) et aux anticipations technico-économiques, ont souvent été de nature dystopique. En politique, la peur du bâton est plus efficace que l'attrait de la carotte. Les marchands de parano ont donc souvent misé sur des scénarios pessimistes, du Péril Jaune à la menace rouge au «fascisme vert»... Comme il reste encore quelques noms de couleurs, nous n'en avons sans doute pas fini avec eux. (Évidemment, même les paranos ont des ennemis : la peur est plus aigüe — et mauvaise conseillère — si l'on a conscience de s'être fait des ennemis...) Et quand l'invasion ennemie devient improbable, on peut toujours miser sur la hantise du déclin, de Spengler à Baverez.
Mais je ne parle pas de ça. L'hiver nucléaire de Sagan et compagnie permet plutôt de faire le lien entre ces pronostics de catastrophes politiques et les contre-futurs qui ont animé la contre-culture après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'extrapolations réalistes ou présentées comme telles, dans plusieurs domaines, dont ceux du climat, de la biodiversité, de l'environnement, de la disponibilité des ressources... Les versions les plus connues ont été fournies par le Club de Rome fondé en 1968, mais de nombreux experts ont proposé leurs propres scénarios dans les champs qui leur étaient propres. L'épuisement des ressources, la disparition des espèces, la pollution des environnements naturels, le réchauffement global, l'amincissement de la couche d'ozone... autant de points de départ de futurs aussi peu reluisants que les avenirs des technophiles façon Bel Geddes, Apple ou Wired étaient chromés et bien astiqués.
Conclusion temporaire : on n'a pas cessé de s'intéresser au futur, mais il existe sans doute un déséquilibre actuel en faveur des futurs les plus inquiétants. Les futurs d'autrefois ont pris de l'âge et montrent leurs rides; on attend la relève. Si les jeunes générations tardent à se manifester en défendant des visions radicalement novatrices, est-ce parce qu'elles sont obnubilées par le dernier-né des contre-futurs, celui de vies professionnelles entièrement consacrées à payer pour les retraites de leurs aînés du baby-boom?
Libellés : Futurisme, Histoire, Réflexion
2006-03-27
Organiser l'indépendance... des indépendants
Certains plaisantins seraient tentés de comparer l'initiative à une tentative de rassembler des chats et de les faire marcher au pas. Le grand Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) veut lancer un syndicat des pigistes et des travailleurs autonomes dans le domaine des médias et des relations publiques. L'annonce est uniquement en anglais pour l'instant, semble-t-il, mais c'est peut-être l'occasion de changer un rapport de forces devenu de plus en plus défavorable depuis que les médias sont contrôlés par un nombre toujours plus petit de grands conglomérats.
Il existe déjà des organisations qui représentent plus ou moins les pigistes des médias, comme l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) ou la Periodical Writers' Association of Canada (PWAC). L'une est petite et l'autre compte beaucoup plus de membres, mais les deux restent dans l'ombre d'associations aux reins plus solides comme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ou la Canadian Association of Journalists (CAJ). Cependant, celles-ci doivent aussi représenter des journalistes employés par les grandes compagnies dans le domaine des médias; or, les intérêts des employés et des pigistes à contrat ne coïncident pas toujours... Quelque chose comme un grand syndicat national des pigistes combinerait l'avantage d'une mission bien définie et celui d'une organisation solide, soutenue au début par le SCEP.
C'est, comme on dit dans le métier, une histoire à suivre.
Il existe déjà des organisations qui représentent plus ou moins les pigistes des médias, comme l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) ou la Periodical Writers' Association of Canada (PWAC). L'une est petite et l'autre compte beaucoup plus de membres, mais les deux restent dans l'ombre d'associations aux reins plus solides comme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ou la Canadian Association of Journalists (CAJ). Cependant, celles-ci doivent aussi représenter des journalistes employés par les grandes compagnies dans le domaine des médias; or, les intérêts des employés et des pigistes à contrat ne coïncident pas toujours... Quelque chose comme un grand syndicat national des pigistes combinerait l'avantage d'une mission bien définie et celui d'une organisation solide, soutenue au début par le SCEP.
C'est, comme on dit dans le métier, une histoire à suivre.
La Comtesse blanche
Dernier film des vieux complices Ismail Merchant et James Ivory, on croirait presque que The White Countess a été écrit pour être le chant du cygne de leur longue collaboration.
Dans les faits, il s'agissait d'un trio : Merchant était le producteur, Ivory le réalisateur et Ruth Prawer Jhabvala la scénariste. Ils s'inspiraient souvent (sinon toujours) de romans. Dans ce cas-ci, The White Countess était un roman de Junichiro Tanizaki (Diary of a Mad Old Man) qui se passait au Japon à l'origine, adapté — et refondu — par Kazuo Ishiguro, qui retrouve une période qu'il avait déjà explorée dans The Remains of the Day.
Du coup, l'action est déplacée à Shanghai avant la Seconde Guerre mondiale. Les protagonistes ne sont plus du tout japonais. D'une part, nous avons Todd Jackson, un ancien diplomate étatsunien qui a perdu sa famille et sa vue. D'autre part, nous avons la comtesse Sofia, une Russe blanche qui a encore une famille mais qui n'a plus de pays. Alors que la fille de Jackson est morte, Sofia a une fille bien vivante, Katya. Tandis que Jackson cherche une raison de vivre, Sofia se vend pour gagner l'argent qui permet aux siens de vivoter — et qui leur permet de la mépriser parce qu'elle déroge à tous les codes de l'aristocratie.
C'est un film plein de moments charmants et de rebondissements pas toujours convaincants. Même si les plus grands romanciers, comme Dickens, n'ont jamais eu peur d'user et d'abuser des coïncidences, elles sont d'un maniement difficiles dans le cadre d'un film de moins de deux heures... Les grands thèmes du film n'apparaissent vraiment que dans les scènes ultimes. La boîte de nuit si ardemment rêvée et désirée par Jackson était une construction aussi brillante et aussi éphémère que la Shanghai polyglotte et multinationale que les Japonais sont en train de détruire. Mais c'était aussi une famille de remplacement, et sa destruction pousse enfin Jackson, avec un coup de pouce de son ami et rival japonais, Matsuda, à chercher la comtesse Sofia pour lui déclarer les sentiments qu'il éprouve pour elle. D'une famille à l'autre.
Mais il est difficile de ne pas entendre dans le dernier face à face de Jackson et Matsuda un hommage rendu à la création de ces petits mondes fermés, îlots de beauté dans un monde chaotique qui les fait souvent oublier et les détruit parfois, que sont les œuvres d'art — et les films de Merchant et Ivory... L'esthétisme de Jackson et de Matsuda n'est pas entièrement crédible, mais le film a l'intelligence de ne pas leur faire parler d'art avant que leurs œuvres respectives soient réalisées. La réalité est un argument imparable.
Les principaux mérites du film, ce sont la beauté des images et les hésitations des personnages qui ont déjà trop donné d'eux-mêmes pour ne pas y songer à deux fois avant de se commettre. Mais j'ai aussi admiré la reconstruction du Shanghai de l'entre-deux-guerres, un exploit que l'on mesure mieux quand on a vu Code 46, un film futuriste en partie tourné à Shanghai et Pudong depuis la floraison d'édifices modernes, ultra-modernes et post-modernes...
Il restait si peu de l'ancien Shanghai que les cinéastes ont dû se contenter de cadrages très serrés, ce qui crée une atmosphère quelque peu claustrophobe, mais pas si étrangère aux autres films de la maison. Même sans avoir visité la nouvelle Shanghai, on peut deviner aussi l'étendue des changements en comparant The White Countess à Empire of the Sun de Spielberg, sorti en 1987. Spielberg avait été beaucoup moins chiche en grands angles. En principe, le Bund — le district le plus historique de Shanghai — n'a pas tellement changé, mais il est sans doute devenu beaucoup plus difficile pour un cinéaste d'accaparer une partie du quartier afin de faire revivre le passé. Il y a vingt ans, Spielberg avait pu obtenir l'autorité et les autorisations nécessaires, mais le boom économique de la Chine a sans doute rendu la chose impossiblement coûteuse aujourd'hui.
La conclusion du film est un happy end en quelque sorte. Pas au point de friser l'invraisemblance; Jackson et la comtesse ont tourné le dos à l'espoir de refaire leur vie dans des circonstances plus faciles, à Hong Kong ou ailleurs, mais ils sont ensemble. Tandis que Merchant et Ivory ne le sont plus.
Dans les faits, il s'agissait d'un trio : Merchant était le producteur, Ivory le réalisateur et Ruth Prawer Jhabvala la scénariste. Ils s'inspiraient souvent (sinon toujours) de romans. Dans ce cas-ci, The White Countess était un roman de Junichiro Tanizaki (Diary of a Mad Old Man) qui se passait au Japon à l'origine, adapté — et refondu — par Kazuo Ishiguro, qui retrouve une période qu'il avait déjà explorée dans The Remains of the Day.
Du coup, l'action est déplacée à Shanghai avant la Seconde Guerre mondiale. Les protagonistes ne sont plus du tout japonais. D'une part, nous avons Todd Jackson, un ancien diplomate étatsunien qui a perdu sa famille et sa vue. D'autre part, nous avons la comtesse Sofia, une Russe blanche qui a encore une famille mais qui n'a plus de pays. Alors que la fille de Jackson est morte, Sofia a une fille bien vivante, Katya. Tandis que Jackson cherche une raison de vivre, Sofia se vend pour gagner l'argent qui permet aux siens de vivoter — et qui leur permet de la mépriser parce qu'elle déroge à tous les codes de l'aristocratie.
C'est un film plein de moments charmants et de rebondissements pas toujours convaincants. Même si les plus grands romanciers, comme Dickens, n'ont jamais eu peur d'user et d'abuser des coïncidences, elles sont d'un maniement difficiles dans le cadre d'un film de moins de deux heures... Les grands thèmes du film n'apparaissent vraiment que dans les scènes ultimes. La boîte de nuit si ardemment rêvée et désirée par Jackson était une construction aussi brillante et aussi éphémère que la Shanghai polyglotte et multinationale que les Japonais sont en train de détruire. Mais c'était aussi une famille de remplacement, et sa destruction pousse enfin Jackson, avec un coup de pouce de son ami et rival japonais, Matsuda, à chercher la comtesse Sofia pour lui déclarer les sentiments qu'il éprouve pour elle. D'une famille à l'autre.
Mais il est difficile de ne pas entendre dans le dernier face à face de Jackson et Matsuda un hommage rendu à la création de ces petits mondes fermés, îlots de beauté dans un monde chaotique qui les fait souvent oublier et les détruit parfois, que sont les œuvres d'art — et les films de Merchant et Ivory... L'esthétisme de Jackson et de Matsuda n'est pas entièrement crédible, mais le film a l'intelligence de ne pas leur faire parler d'art avant que leurs œuvres respectives soient réalisées. La réalité est un argument imparable.
Les principaux mérites du film, ce sont la beauté des images et les hésitations des personnages qui ont déjà trop donné d'eux-mêmes pour ne pas y songer à deux fois avant de se commettre. Mais j'ai aussi admiré la reconstruction du Shanghai de l'entre-deux-guerres, un exploit que l'on mesure mieux quand on a vu Code 46, un film futuriste en partie tourné à Shanghai et Pudong depuis la floraison d'édifices modernes, ultra-modernes et post-modernes...
Il restait si peu de l'ancien Shanghai que les cinéastes ont dû se contenter de cadrages très serrés, ce qui crée une atmosphère quelque peu claustrophobe, mais pas si étrangère aux autres films de la maison. Même sans avoir visité la nouvelle Shanghai, on peut deviner aussi l'étendue des changements en comparant The White Countess à Empire of the Sun de Spielberg, sorti en 1987. Spielberg avait été beaucoup moins chiche en grands angles. En principe, le Bund — le district le plus historique de Shanghai — n'a pas tellement changé, mais il est sans doute devenu beaucoup plus difficile pour un cinéaste d'accaparer une partie du quartier afin de faire revivre le passé. Il y a vingt ans, Spielberg avait pu obtenir l'autorité et les autorisations nécessaires, mais le boom économique de la Chine a sans doute rendu la chose impossiblement coûteuse aujourd'hui.
La conclusion du film est un happy end en quelque sorte. Pas au point de friser l'invraisemblance; Jackson et la comtesse ont tourné le dos à l'espoir de refaire leur vie dans des circonstances plus faciles, à Hong Kong ou ailleurs, mais ils sont ensemble. Tandis que Merchant et Ivory ne le sont plus.
Libellés : Films
2006-03-26
Le livre que l'on finit la nuit
Il y a longtemps que j'ai commencé à lire le recueil de Holly Phillips, In the Palace of Repose.
Si j'ai interrompu ma lecture, c'était sans doute parce que j'étais convaincu que je ne regretterais pas d'y revenir. À bien y penser, ce sont les livres les moins intéressants que l'on s'empresse de finir. Quand une intrigue prévisible et une prose sans relief font de la lecture quelque chose comme un pensum, on préfère en finir et passer à autre chose.
Les trois dernières nouvelles du recueil de Phillips ne déçoivent pas. Souvent, tout tient dans la révélation finale, même si les rebondissements suffisent à soutenir l'intérêt. La meilleure des trois dernières est sans doute « By the Light of Tomorrow's Sun », qui raconte le retour d'un enfant du pays dans un petit port de pêche isolé (probablement en Colombie-Britannique, mais pas nécessairement) pour des retrouvailles avec son père qui ne se passent pas comme prévu. Des secrets enfouis émergent, mais tout n'a pas été dit et le protagoniste, Daniel, voit enfin surgir du brouillard un vaisseau venu d'ailleurs.
Les deux autres nouvelles, malgré toutes leurs qualités, ne sont pas aussi efficaces. Dans « Summer Ice », Phillips verse plutôt dans la science-fiction la plus discrète. Dans une ville qui pourrait être Toronto après l'effondrement de la prospérité nord-américaine, une jeune artiste essaie de se faire sa place. Tout se noue dans les dernières pages, mais la conclusion révèle un art du dénouement qui coupe le souffle. Quand Phillips verse dans l'horrifique, elle joue sur une émotion primale qu'il n'est pas si difficile de susciter. Mais quand elle invoque l'admiration, elle accède à quelque chose qui est beaucoup plus rare. La nouvelle en tant que telle n'est pas tout à fait réussie dans la mesure où le lecteur hésite à s'investir parce qu'il ne voit pas où elle veut en venir, mais la fin rachète tout le reste.
La dernière nouvelle, « Variations on a Theme », est surtout une manière de conclure le recueil. L'histoire d'une école de musique fréquentée par des visiteurs féeriques qui choisissent parfois de séduire des étudiants malheureux pour les ramener dans leur monde enchanté n'offre justement qu'une... variation sur le thème de la séduction et de l'évasion dans un monde ensorcelé dont les beautés ont, peut-être, un prix.
Cependant, ce sont les personnages qui emportent la conviction. Phillips les anime en quelques lignes — ils vivent, ils souffrent, ils rient... La nouvelle repose sur une petite surprise — et sur la question implicite posée non seulement aux personnages mais aux lecteurs. Si on vous offrait de partir pour le pays des fées, accepteriez-vous? Dans ce recueil, il faudrait poser la question au début, car le lecteur qui pénètre dans le cercle enchanté des neuf fictions de Phillips risquera de tomber sous le charme d'une plume magique.
Si j'ai interrompu ma lecture, c'était sans doute parce que j'étais convaincu que je ne regretterais pas d'y revenir. À bien y penser, ce sont les livres les moins intéressants que l'on s'empresse de finir. Quand une intrigue prévisible et une prose sans relief font de la lecture quelque chose comme un pensum, on préfère en finir et passer à autre chose.
Les trois dernières nouvelles du recueil de Phillips ne déçoivent pas. Souvent, tout tient dans la révélation finale, même si les rebondissements suffisent à soutenir l'intérêt. La meilleure des trois dernières est sans doute « By the Light of Tomorrow's Sun », qui raconte le retour d'un enfant du pays dans un petit port de pêche isolé (probablement en Colombie-Britannique, mais pas nécessairement) pour des retrouvailles avec son père qui ne se passent pas comme prévu. Des secrets enfouis émergent, mais tout n'a pas été dit et le protagoniste, Daniel, voit enfin surgir du brouillard un vaisseau venu d'ailleurs.
Les deux autres nouvelles, malgré toutes leurs qualités, ne sont pas aussi efficaces. Dans « Summer Ice », Phillips verse plutôt dans la science-fiction la plus discrète. Dans une ville qui pourrait être Toronto après l'effondrement de la prospérité nord-américaine, une jeune artiste essaie de se faire sa place. Tout se noue dans les dernières pages, mais la conclusion révèle un art du dénouement qui coupe le souffle. Quand Phillips verse dans l'horrifique, elle joue sur une émotion primale qu'il n'est pas si difficile de susciter. Mais quand elle invoque l'admiration, elle accède à quelque chose qui est beaucoup plus rare. La nouvelle en tant que telle n'est pas tout à fait réussie dans la mesure où le lecteur hésite à s'investir parce qu'il ne voit pas où elle veut en venir, mais la fin rachète tout le reste.
La dernière nouvelle, « Variations on a Theme », est surtout une manière de conclure le recueil. L'histoire d'une école de musique fréquentée par des visiteurs féeriques qui choisissent parfois de séduire des étudiants malheureux pour les ramener dans leur monde enchanté n'offre justement qu'une... variation sur le thème de la séduction et de l'évasion dans un monde ensorcelé dont les beautés ont, peut-être, un prix.
Cependant, ce sont les personnages qui emportent la conviction. Phillips les anime en quelques lignes — ils vivent, ils souffrent, ils rient... La nouvelle repose sur une petite surprise — et sur la question implicite posée non seulement aux personnages mais aux lecteurs. Si on vous offrait de partir pour le pays des fées, accepteriez-vous? Dans ce recueil, il faudrait poser la question au début, car le lecteur qui pénètre dans le cercle enchanté des neuf fictions de Phillips risquera de tomber sous le charme d'une plume magique.
Libellés : Livres, Science-fiction
2006-03-24
Ouverture et fermeture
Quelques échos de science-fiction en terre canadienne aujourd'hui...
Dans le nouveau numéro de la revue Liaison, qui prend le virage d'une vocation pancanadienne en s'intéressant désormais aux productions artistiques de toute la francophonie canadienne hors-Québec, on trouvera ma critique du roman Terre des Autres de Sylvie Bérard. Ce livre fait partie des œuvres en lice pour le Prix des Lecteurs Radio-Canada. Le prix sera décerné lors du Salon du livre de Sudbury, le samedi 6 mai.
Entre Ottawa et Montréal, j'ai terminé la lecture d'une anthologie réunie par Claude Lalumière, Open Space: New Canadian Fantastic Fiction (Red Deer Press, 2003). Ce sont 21 auteurs qui se retrouvent dans ces pages, entre une préface par Cory Doctorow et une postface par John Rose. La science-fiction est minoritaire, mais de peu, tandis que les textes de fantastique ne sont pas si éloignés de la science-fiction, parfois. Ce qu'on ne trouvera pas dans cette antho, cependant, ce sont des nouvelles de fantasy classique. Bref, pas de chevaliers, de nains, de trolls, d'épées magiques...
Ce qui frappe le plus, c'est la grande diversité des cultures et des contextes. Pratiquement toutes les régions du Canada sont représentées, ainsi que plusieurs cultures différentes. Dans certains cas, on peut avoir l'impression qu'il ne s'agit que d'un enrobage qui cache mal une simple variante d'un sujet quasiment éculé. Ailleurs, c'est le style qui semble s'efforcer de donner le change. Néanmoins, mieux vaut retenir les meilleurs textes, et il y en a d'excellents. La nouvelle qui conclut l'antho, « More Painful than the Dreams of Other Boys » de Derryl Murphy, par exemple, qui prend l'enfance et le vieillissement comme thèmes. Ou encore « The Traumatized Generation » de Murray Leeder sur une épidémie de zombification qui a transformé la société, et pas pour le mieux. Mais cette société reste mieux lotie que les réfugiés irlandais du dix-neuvième siècle dans « The Banshee of Cholera Bay » de Jes Sugrue ou les colons fondamentalistes sur une autre planète dans « March on the New Gomorrah » de Mark Anthony Brennan. Il y a heureusement des nouvelles plus réjouissantes, dont « Of Wings » de Shane Michael Arbuthnott ou « A Gift of Power » de Janet Marie Rogers. Et même « La Rivière Noire » de Leslie Brown. Sinon, je crois que « Appetite » de Nicholas Knight était censée être horrifique, mais elle chatouille plutôt mon sens de l'humour... noir, très noir.
Et, en guise de visionnement vespéral, j'ai vu à Montréal V for Vendetta des frères W. Film violent qui va loin dans la vaticination volontariste sur fond de virulences variées — vigiles vexatoires, vagues varioliques avec ou sans vaccin, vacance de la pensée versant dans le fascisme vidéo et la fausse vertu de vicaires vicieux... La vengeance des victimes fait vibrer, mais la victoire d'un vengeur sans visage sur des vantards et des vénaux a dans les veines et dans le ventre quelque chose de vénéneux... Ce verdict doit toutefois tenir compte d'une verve jamais verbeuse, de la virtuosité des Wachowski et de la vivification de la vérité par le film. La vie au vingt-et-unième siècle est encore trop vulnérable pour rejeter facilement une vision par trop vraisemblable de la vilenie de vendeurs de vitupérations...
En clair, donc, je ne peux pas juger de l'adaptation, n'ayant pas lu la BD originale d'Alan Moore — qui a exigé que son nom soit retiré du générique. (De sorte que celui-ci mentionne le nom du dessinateur de la BD mais sans dire qui l'écrivait. L'effet est curieux.) L'histoire conserve d'ailleurs les traces d'un enracinement dans le terreau des comics. Le personnage de V, qui porte un masque de Guy Fawkes, a quelques traits des superhéros classiques, dont un repaire inexpugnable et des pouvoirs physiques exceptionnels, qui sont le résultat d'expériences dont il a été la victime.
L'intrigue laisse aussi voir un découpage épisodique qui reflète sans doute la composition de (10)chapitres distincts pour la BD originale. L'époque de la composition (le début des années 80) explique aussi sans doute la timidité de l'extrapolation; dans la version originale, la dystopie britannique de Moore s'inspirait beaucoup du Big Brother d'Orwell et de l'expérience encore récente du fascisme en Europe. La version des Wachowski repousse l'époque du film vers les 2030 ou 2040, mais la technologie mise en scène reste proche de celle qui existe aujourd'hui. Il pourrait d'ailleurs s'agir d'une uchronie — on s'attend par exemple à ce que le personnage d'Evey, la jeune femme recueillie par V, soit repérée par les logiciels de reconnaissance des visage qui ont sûrement été perfectionnés et branchés sur les caméras de surveillance déjà omniprésentes à Londres aujourd'hui; or, ce n'est pas le cas, ce qui incite à croire qu'on se trouve vraiment dans un autre univers.
Au cœur de l'histoire, il y a l'affrontement de deux formes de violence. Celle de V est apparemment édulcorée dans le film, relativement à la BD, mais V reste suffisamment sanguinaire et vindicatif pour poser la question des moyens. La fin justifie-t-elle tous les moyens, même les plus meurtriers? La fin du film des Wachowski inclut des extraits de discours de Malcolm X, qui croyait à la violence justifiée par la violence de l'oppression. Mais la violence de la résistance justifie aussi la violence de l'oppresseur, enfermant tout le monde dans la logique de l'escalade.
Si l'anthologie de Lalumière ouvrait sur des horizons effectivement variés, le film des Wachowski tend à nous enfermer dans une alternative fermée, et fort peu utile.
Dans le nouveau numéro de la revue Liaison, qui prend le virage d'une vocation pancanadienne en s'intéressant désormais aux productions artistiques de toute la francophonie canadienne hors-Québec, on trouvera ma critique du roman Terre des Autres de Sylvie Bérard. Ce livre fait partie des œuvres en lice pour le Prix des Lecteurs Radio-Canada. Le prix sera décerné lors du Salon du livre de Sudbury, le samedi 6 mai.
Entre Ottawa et Montréal, j'ai terminé la lecture d'une anthologie réunie par Claude Lalumière, Open Space: New Canadian Fantastic Fiction (Red Deer Press, 2003). Ce sont 21 auteurs qui se retrouvent dans ces pages, entre une préface par Cory Doctorow et une postface par John Rose. La science-fiction est minoritaire, mais de peu, tandis que les textes de fantastique ne sont pas si éloignés de la science-fiction, parfois. Ce qu'on ne trouvera pas dans cette antho, cependant, ce sont des nouvelles de fantasy classique. Bref, pas de chevaliers, de nains, de trolls, d'épées magiques...
Ce qui frappe le plus, c'est la grande diversité des cultures et des contextes. Pratiquement toutes les régions du Canada sont représentées, ainsi que plusieurs cultures différentes. Dans certains cas, on peut avoir l'impression qu'il ne s'agit que d'un enrobage qui cache mal une simple variante d'un sujet quasiment éculé. Ailleurs, c'est le style qui semble s'efforcer de donner le change. Néanmoins, mieux vaut retenir les meilleurs textes, et il y en a d'excellents. La nouvelle qui conclut l'antho, « More Painful than the Dreams of Other Boys » de Derryl Murphy, par exemple, qui prend l'enfance et le vieillissement comme thèmes. Ou encore « The Traumatized Generation » de Murray Leeder sur une épidémie de zombification qui a transformé la société, et pas pour le mieux. Mais cette société reste mieux lotie que les réfugiés irlandais du dix-neuvième siècle dans « The Banshee of Cholera Bay » de Jes Sugrue ou les colons fondamentalistes sur une autre planète dans « March on the New Gomorrah » de Mark Anthony Brennan. Il y a heureusement des nouvelles plus réjouissantes, dont « Of Wings » de Shane Michael Arbuthnott ou « A Gift of Power » de Janet Marie Rogers. Et même « La Rivière Noire » de Leslie Brown. Sinon, je crois que « Appetite » de Nicholas Knight était censée être horrifique, mais elle chatouille plutôt mon sens de l'humour... noir, très noir.
Et, en guise de visionnement vespéral, j'ai vu à Montréal V for Vendetta des frères W. Film violent qui va loin dans la vaticination volontariste sur fond de virulences variées — vigiles vexatoires, vagues varioliques avec ou sans vaccin, vacance de la pensée versant dans le fascisme vidéo et la fausse vertu de vicaires vicieux... La vengeance des victimes fait vibrer, mais la victoire d'un vengeur sans visage sur des vantards et des vénaux a dans les veines et dans le ventre quelque chose de vénéneux... Ce verdict doit toutefois tenir compte d'une verve jamais verbeuse, de la virtuosité des Wachowski et de la vivification de la vérité par le film. La vie au vingt-et-unième siècle est encore trop vulnérable pour rejeter facilement une vision par trop vraisemblable de la vilenie de vendeurs de vitupérations...
En clair, donc, je ne peux pas juger de l'adaptation, n'ayant pas lu la BD originale d'Alan Moore — qui a exigé que son nom soit retiré du générique. (De sorte que celui-ci mentionne le nom du dessinateur de la BD mais sans dire qui l'écrivait. L'effet est curieux.) L'histoire conserve d'ailleurs les traces d'un enracinement dans le terreau des comics. Le personnage de V, qui porte un masque de Guy Fawkes, a quelques traits des superhéros classiques, dont un repaire inexpugnable et des pouvoirs physiques exceptionnels, qui sont le résultat d'expériences dont il a été la victime.
L'intrigue laisse aussi voir un découpage épisodique qui reflète sans doute la composition de (10)chapitres distincts pour la BD originale. L'époque de la composition (le début des années 80) explique aussi sans doute la timidité de l'extrapolation; dans la version originale, la dystopie britannique de Moore s'inspirait beaucoup du Big Brother d'Orwell et de l'expérience encore récente du fascisme en Europe. La version des Wachowski repousse l'époque du film vers les 2030 ou 2040, mais la technologie mise en scène reste proche de celle qui existe aujourd'hui. Il pourrait d'ailleurs s'agir d'une uchronie — on s'attend par exemple à ce que le personnage d'Evey, la jeune femme recueillie par V, soit repérée par les logiciels de reconnaissance des visage qui ont sûrement été perfectionnés et branchés sur les caméras de surveillance déjà omniprésentes à Londres aujourd'hui; or, ce n'est pas le cas, ce qui incite à croire qu'on se trouve vraiment dans un autre univers.
Au cœur de l'histoire, il y a l'affrontement de deux formes de violence. Celle de V est apparemment édulcorée dans le film, relativement à la BD, mais V reste suffisamment sanguinaire et vindicatif pour poser la question des moyens. La fin justifie-t-elle tous les moyens, même les plus meurtriers? La fin du film des Wachowski inclut des extraits de discours de Malcolm X, qui croyait à la violence justifiée par la violence de l'oppression. Mais la violence de la résistance justifie aussi la violence de l'oppresseur, enfermant tout le monde dans la logique de l'escalade.
Si l'anthologie de Lalumière ouvrait sur des horizons effectivement variés, le film des Wachowski tend à nous enfermer dans une alternative fermée, et fort peu utile.
Libellés : Canada, Films, Livres, Science-fiction
Libation
La Mort n'avertit pas, elle égorge d'un trait,
crevant le cœur que l'on croyait fortifié,
exécutant un jugement ratifié
avant d'être annoncé, comme s'il était prêt
le coeur blessé la nuit, quand le flanc il montrait
au fer qui l'a meurtri et a sacrifié
son sang clair, recueilli de l'âme horrifiée
dans la coupe remplie d'amour et de regret.
Ce vin pâle et doré reste comme un rayon
du Soleil des étés heureux que nous payons
si longtemps après d'une agonie partagée
Cette coupe de sang tiré d'un cœur béant,
quand la peine de l'autre est ma peine encagée,
se boit à la fin, pour embrasser le néant.
crevant le cœur que l'on croyait fortifié,
exécutant un jugement ratifié
avant d'être annoncé, comme s'il était prêt
le coeur blessé la nuit, quand le flanc il montrait
au fer qui l'a meurtri et a sacrifié
son sang clair, recueilli de l'âme horrifiée
dans la coupe remplie d'amour et de regret.
Ce vin pâle et doré reste comme un rayon
du Soleil des étés heureux que nous payons
si longtemps après d'une agonie partagée
Cette coupe de sang tiré d'un cœur béant,
quand la peine de l'autre est ma peine encagée,
se boit à la fin, pour embrasser le néant.
Libellés : Poème
2006-03-23
Inflation, croissance et production
Il y a la pensée économique, et ensuite il y a le discours économiste.
Les deux sont parfois confondus, mais ils ne sont pas toujours identiques. L'économie est une science, souvent peu réjouissante, mais sujette à discussion et argumentation. Le discours économiste tend à dédaigner les nuances et les ouvertures de la pensée économique au profit d'une réification de telle ou telle variable.
Dans le Globe and Mail du 22 mars, le chroniqueur Neil Reynolds s'inspire d'écrits issus du Shadow Open Market Committee, une association d'économistes étatsuniens qui suivent les faits et gestes du comité correspondant de la Federal Reserve, pour préconiser la poursuite d'un taux d'inflation nul. Il fait remarquer que l'inflation, même lorsqu'elle est basse, produit des effets stupéfiants. Depuis 1914, le taux d'inflation au Canada a rarement dépassé une moyenne de 2% sur de longues périodes de temps, exception faite des années consécutives au choc pétrolier et à la fin de la guerre au Viêt-Nam. Pourtant, cette inflation a suffi pour que le pouvoir d'achat de 100$ en 1914 ne puisse être obtenu qu'avec une somme de 1788.99$ en 2006... Reynolds parle donc d'une corruption de la monnaie, permise et encouragée par les banques, qui nuit à la stabilité des prix.
Mais est-ce bien vrai? Certes, l'augmentation de la productivité du travail, telle qu'on la voit depuis 1914 dans les entreprises et les manufactures, devrait idéalement réduire le prix des biens correspondants. En principe, la progression de la productivité devrait générer de la déflation.
L'innovation technologique complique les choses, toutefois. C'est bien beau de dire que 100$ en 1914 achetait plus que 100$ n'en achète en 2006, mais c'est faire fi de la réalité. De nombreux biens de consommation n'existaient tout simplement pas en 1914. Pour 100$ aujourd'hui, on peut acheter une excellente clé USB pour entreposer ses fichiers informatiques — ce que tout l'argent du monde en 1914 n'aurait pu acheter. Les deux mondes sont incommensurables.
L'existence de l'inflation est en fait déduite du choix axiomatique de considérer que l'iPod d'Apple, par exemple, qui vient d'être ajouté à la corbeille des biens de consommation servant à calculer le taux de l'inflation, est strictement comparable aux biens de consommation qu'il remplace. Si on essayait de calculer le vrai taux de l'inflation, on aurait peut-être des surprises. Imaginons une corbeille de base qui, en 2006, comprendrait une miche de pain et une calculatrice pour enfants. Cela se procure pour quelques dizaines de dollars. En revanche, en 1946, il aura fallu dépenser plusieurs milliers de dollars pour avoir une miche de pain et le meilleur ordinateur. De ce point de vue, même si la miche de pain a beaucoup augmenté, l'accroissement de la productivité est immense et il produit de la déflation, comme on s'y attendait...
Reynolds plaide les vertus de la stabilité des prix. Pourtant, la stabilité absolue des prix impliquerait que l'argent gagné hier, alors que la productivité du travail était moindre, et soigneusement thésaurisé par le bourgeois devrait valoir autant que l'argent gagné aujourd'hui, par un ouvrier plus productif que jamais auparavant.
Du coup, on commence à s'interroger sur les défenseurs de cette stabilité des prix. À qui profiterait-elle? L'accroissement de la productivité est censé augmenter les revenus des travailleurs, mais les économistes Ian Dew-Becker et Robert J. Gordon ont récemment calculé (.PDF) que ce n'est pas si simple. Tout d'abord, aux États-Unis, les fruits de la croissance depuis 1966 ont presque exclusivement profité aux personnes occupant le 10% supérieur de la distribution des revenus. Ceci aurait beaucoup à voir avec les structures des marchés, mais, ensuite, un ensemble de facteurs (dont l'immigration illégale, le libre-échange, etc.) réduisent les revenus des plus pauvres. Dans la mesure où la stabilité des prix représente une autre spoliation du présent par le passé, on n'a pas l'impression que que le travail des travailleurs est récompensé à sa juste valeur, de toute façon.
Les deux sont parfois confondus, mais ils ne sont pas toujours identiques. L'économie est une science, souvent peu réjouissante, mais sujette à discussion et argumentation. Le discours économiste tend à dédaigner les nuances et les ouvertures de la pensée économique au profit d'une réification de telle ou telle variable.
Dans le Globe and Mail du 22 mars, le chroniqueur Neil Reynolds s'inspire d'écrits issus du Shadow Open Market Committee, une association d'économistes étatsuniens qui suivent les faits et gestes du comité correspondant de la Federal Reserve, pour préconiser la poursuite d'un taux d'inflation nul. Il fait remarquer que l'inflation, même lorsqu'elle est basse, produit des effets stupéfiants. Depuis 1914, le taux d'inflation au Canada a rarement dépassé une moyenne de 2% sur de longues périodes de temps, exception faite des années consécutives au choc pétrolier et à la fin de la guerre au Viêt-Nam. Pourtant, cette inflation a suffi pour que le pouvoir d'achat de 100$ en 1914 ne puisse être obtenu qu'avec une somme de 1788.99$ en 2006... Reynolds parle donc d'une corruption de la monnaie, permise et encouragée par les banques, qui nuit à la stabilité des prix.
Mais est-ce bien vrai? Certes, l'augmentation de la productivité du travail, telle qu'on la voit depuis 1914 dans les entreprises et les manufactures, devrait idéalement réduire le prix des biens correspondants. En principe, la progression de la productivité devrait générer de la déflation.
L'innovation technologique complique les choses, toutefois. C'est bien beau de dire que 100$ en 1914 achetait plus que 100$ n'en achète en 2006, mais c'est faire fi de la réalité. De nombreux biens de consommation n'existaient tout simplement pas en 1914. Pour 100$ aujourd'hui, on peut acheter une excellente clé USB pour entreposer ses fichiers informatiques — ce que tout l'argent du monde en 1914 n'aurait pu acheter. Les deux mondes sont incommensurables.
L'existence de l'inflation est en fait déduite du choix axiomatique de considérer que l'iPod d'Apple, par exemple, qui vient d'être ajouté à la corbeille des biens de consommation servant à calculer le taux de l'inflation, est strictement comparable aux biens de consommation qu'il remplace. Si on essayait de calculer le vrai taux de l'inflation, on aurait peut-être des surprises. Imaginons une corbeille de base qui, en 2006, comprendrait une miche de pain et une calculatrice pour enfants. Cela se procure pour quelques dizaines de dollars. En revanche, en 1946, il aura fallu dépenser plusieurs milliers de dollars pour avoir une miche de pain et le meilleur ordinateur. De ce point de vue, même si la miche de pain a beaucoup augmenté, l'accroissement de la productivité est immense et il produit de la déflation, comme on s'y attendait...
Reynolds plaide les vertus de la stabilité des prix. Pourtant, la stabilité absolue des prix impliquerait que l'argent gagné hier, alors que la productivité du travail était moindre, et soigneusement thésaurisé par le bourgeois devrait valoir autant que l'argent gagné aujourd'hui, par un ouvrier plus productif que jamais auparavant.
Du coup, on commence à s'interroger sur les défenseurs de cette stabilité des prix. À qui profiterait-elle? L'accroissement de la productivité est censé augmenter les revenus des travailleurs, mais les économistes Ian Dew-Becker et Robert J. Gordon ont récemment calculé (.PDF) que ce n'est pas si simple. Tout d'abord, aux États-Unis, les fruits de la croissance depuis 1966 ont presque exclusivement profité aux personnes occupant le 10% supérieur de la distribution des revenus. Ceci aurait beaucoup à voir avec les structures des marchés, mais, ensuite, un ensemble de facteurs (dont l'immigration illégale, le libre-échange, etc.) réduisent les revenus des plus pauvres. Dans la mesure où la stabilité des prix représente une autre spoliation du présent par le passé, on n'a pas l'impression que que le travail des travailleurs est récompensé à sa juste valeur, de toute façon.
Libellés : Économie
2006-03-22
Syntonicité et virtualité
En 1982, dans The Second Self, Sherry Turkle s'était intéressée aux rapports que les premiers propriétaires d'ordinateurs personnels entretenaient avec leurs machines. Tout en s'avérant une observatrice avisée, sincèrement à l'écoute des personnes qu'elle avait interrogées et capable d'analyser leurs mobiles avec une grande finesse psychologique, elle avait aussi avancé quelques hypothèses peut-être un peu moins fondées.
Ainsi, sans doute dans la foulée de Seymour Papert, elle invoquait la syntonicité pour illuminer le penchant de ces hobbyistes à concevoir le fonctionnement de leurs machines et de leurs logiciels en termes du fonctionnement de leur corps ou de leur esprit — ou plutôt de leur représentation de ceux-ci — au point de s'identifier à ces opérations, voire de les assimiler à des prolongements de leur propre personne (corporelle ou psychologique). Turkle proposait donc : « The CPU of the hobbyist computer lends itself to personal identification with its primary action: moving something that is conceptually almost a physical object (a byte of information) in and out of some thing (a register) that is almost a physical place. The metaphor is concrete and spatial. one can imagine finding the bytes, feeling them, doing something very simple to them, and passing them on. For many of the people that I met in the hobbyist culture, getting into this kind of identification feels safe. It makes the machine feel real. »
Passons sur la métaphore sexuelle, et passons aussi sur le fait que ceci ressemble beaucoup plus au fonctionnement d'un programme écrit en langage machine ou en assembleur qu'au fonctionnement d'un logiciel moderne. Même dans ce contexte très particulier de la préhistoire de l'informatique personnelle, il était aussi possible, à mon avis, d'interpréter autrement le sentiment de réalité dont parle Turkle.
Ainsi, en revenant aux essais philosophiques de Suzanne K. Langer réunis en 1957, Problems of Art, je crois qu'il ne serait pas impropre de faire de ces octets en mouvement des objets virtuels. Tant leur représentation symbolique que la représentation qu'on s'en fait divergent de manière marquée de la réalité physique sous-jacente. Langer désignait comme virtuelles les entités sans réalité physique propre mais qui peuvent donner lieu à une perception réelle. L'objet représenté par un reflet dans un miroir ou quelques centimètres carrés de peinture dans un tableau est un objet sans réalité physique propre même s'il est parfaitement appréhendé par les sens humains, le fait de cette appréhension étant parfaitement objectif.
Cette conception de ce qui est virtuel, et donc de la virtualité, semble bien avoir inspiré l'informaticien Ivan Sutherland qui s'en empare, quelques années plus tard, pour imaginer que l'ordinateur puisse fabriquer des fenêtres par lesquelles percevoir les mondes créés par ses propres processus. Une fois admise la possibilité (au moins théorique) d'une variété de mécanismes capables de susciter l'illusion d'une interaction avec le monde réel, il propose comme but la création d'un monde virtuel contrôlé de telle sorte par l'ordinateur qu'il deviendrait possible de faire l'essai total de réalités qui seraient aussi étrangères que désiré à notre monde familier : « The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming such a display could literally be the Wonderland into which Alice walked. » Autrement dit, la fenêtre devient si parfaite qu'elle s'abolit elle-même.
La question que j'ai envie de poser est la suivante. Certains hobbyistes étaient sans doute suffisamment proches de leurs ordinateurs pour qu'on parle de syntonicité. Dans la plupart des cas, cependant, le sentiment de réalité dont parle Turkle ne serait-il pas tout simplement la reconnaissance par ces premiers usagers de la réalité virtuelle ébauchée par les codes des langages informatiques et par leurs propres représentations du fonctionnement de ces micro-ordinateurs... À ce niveau, on rejoint de nombreux auteurs qui ont plaidé la cause de la virtualité, comme David H. Gelernter.
Osons cependant une synthèse — ou peut-être un pas en arrière. Depuis l'avènement de la Toile, la chimère d'un lieu de rencontre dans le cyberespace qui serait véritablement perçu comme un espace virtuel en a fait galoper plus d'un. Dans la pratique, les interfaces les plus courantes se présentent comme des entités réelles (le bouton de la souris transfère, en apparence, le mouvement du doigt vers un onglet de l'écran, par exemple), mais elles ne sont ni des lieux à part entière ni des prolongements du corps. De l'esprit, peut-être, mais pas tellement plus que les technologies cognitives, comme le papier et le crayon...
La tendance, depuis l'invention du visiocasque par Sutherland il y a une trentaine d'années, est restée au perfectionnement des moyens techniques d'une meilleure interface. Mais néglige-t-on les possibilités de favoriser une identité mentale entre l'usager et les processus informatiques? Papert avait recherché cette identification, mais dans le contexte de l'apprentissage d'abord. Les métaphores proposées par les ordinateurs sont-elles trop peu organiques pour favoriser la syntonicité? Dans ce sens, la popularité même de l'image du cyborg — du Six Million Dollar Man et Darth Vader à Locutus dans Star Trek, voire à Neo dans la trilogie Matrix — pourrait être un avertissement que nous sommes sur la mauvaise voie. Malgré l'imbrication de la chair et de la machine, qui est censée estomper la frontière entre les deux, les deux composantes restent visibles. En partie, c'est sans doute impossible d'y échapper dans les représentations visuelles de nos médias. En partie, toutefois, c'est aussi une limite implicite que l'on fixe à la fusion...
Mais à quoi ressemblerait des ordinateurs plus facilement annexés à nos identités?
Ainsi, sans doute dans la foulée de Seymour Papert, elle invoquait la syntonicité pour illuminer le penchant de ces hobbyistes à concevoir le fonctionnement de leurs machines et de leurs logiciels en termes du fonctionnement de leur corps ou de leur esprit — ou plutôt de leur représentation de ceux-ci — au point de s'identifier à ces opérations, voire de les assimiler à des prolongements de leur propre personne (corporelle ou psychologique). Turkle proposait donc : « The CPU of the hobbyist computer lends itself to personal identification with its primary action: moving something that is conceptually almost a physical object (a byte of information) in and out of some thing (a register) that is almost a physical place. The metaphor is concrete and spatial. one can imagine finding the bytes, feeling them, doing something very simple to them, and passing them on. For many of the people that I met in the hobbyist culture, getting into this kind of identification feels safe. It makes the machine feel real. »
Passons sur la métaphore sexuelle, et passons aussi sur le fait que ceci ressemble beaucoup plus au fonctionnement d'un programme écrit en langage machine ou en assembleur qu'au fonctionnement d'un logiciel moderne. Même dans ce contexte très particulier de la préhistoire de l'informatique personnelle, il était aussi possible, à mon avis, d'interpréter autrement le sentiment de réalité dont parle Turkle.
Ainsi, en revenant aux essais philosophiques de Suzanne K. Langer réunis en 1957, Problems of Art, je crois qu'il ne serait pas impropre de faire de ces octets en mouvement des objets virtuels. Tant leur représentation symbolique que la représentation qu'on s'en fait divergent de manière marquée de la réalité physique sous-jacente. Langer désignait comme virtuelles les entités sans réalité physique propre mais qui peuvent donner lieu à une perception réelle. L'objet représenté par un reflet dans un miroir ou quelques centimètres carrés de peinture dans un tableau est un objet sans réalité physique propre même s'il est parfaitement appréhendé par les sens humains, le fait de cette appréhension étant parfaitement objectif.
Cette conception de ce qui est virtuel, et donc de la virtualité, semble bien avoir inspiré l'informaticien Ivan Sutherland qui s'en empare, quelques années plus tard, pour imaginer que l'ordinateur puisse fabriquer des fenêtres par lesquelles percevoir les mondes créés par ses propres processus. Une fois admise la possibilité (au moins théorique) d'une variété de mécanismes capables de susciter l'illusion d'une interaction avec le monde réel, il propose comme but la création d'un monde virtuel contrôlé de telle sorte par l'ordinateur qu'il deviendrait possible de faire l'essai total de réalités qui seraient aussi étrangères que désiré à notre monde familier : « The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming such a display could literally be the Wonderland into which Alice walked. » Autrement dit, la fenêtre devient si parfaite qu'elle s'abolit elle-même.
La question que j'ai envie de poser est la suivante. Certains hobbyistes étaient sans doute suffisamment proches de leurs ordinateurs pour qu'on parle de syntonicité. Dans la plupart des cas, cependant, le sentiment de réalité dont parle Turkle ne serait-il pas tout simplement la reconnaissance par ces premiers usagers de la réalité virtuelle ébauchée par les codes des langages informatiques et par leurs propres représentations du fonctionnement de ces micro-ordinateurs... À ce niveau, on rejoint de nombreux auteurs qui ont plaidé la cause de la virtualité, comme David H. Gelernter.
Osons cependant une synthèse — ou peut-être un pas en arrière. Depuis l'avènement de la Toile, la chimère d'un lieu de rencontre dans le cyberespace qui serait véritablement perçu comme un espace virtuel en a fait galoper plus d'un. Dans la pratique, les interfaces les plus courantes se présentent comme des entités réelles (le bouton de la souris transfère, en apparence, le mouvement du doigt vers un onglet de l'écran, par exemple), mais elles ne sont ni des lieux à part entière ni des prolongements du corps. De l'esprit, peut-être, mais pas tellement plus que les technologies cognitives, comme le papier et le crayon...
La tendance, depuis l'invention du visiocasque par Sutherland il y a une trentaine d'années, est restée au perfectionnement des moyens techniques d'une meilleure interface. Mais néglige-t-on les possibilités de favoriser une identité mentale entre l'usager et les processus informatiques? Papert avait recherché cette identification, mais dans le contexte de l'apprentissage d'abord. Les métaphores proposées par les ordinateurs sont-elles trop peu organiques pour favoriser la syntonicité? Dans ce sens, la popularité même de l'image du cyborg — du Six Million Dollar Man et Darth Vader à Locutus dans Star Trek, voire à Neo dans la trilogie Matrix — pourrait être un avertissement que nous sommes sur la mauvaise voie. Malgré l'imbrication de la chair et de la machine, qui est censée estomper la frontière entre les deux, les deux composantes restent visibles. En partie, c'est sans doute impossible d'y échapper dans les représentations visuelles de nos médias. En partie, toutefois, c'est aussi une limite implicite que l'on fixe à la fusion...
Mais à quoi ressemblerait des ordinateurs plus facilement annexés à nos identités?
Libellés : Arts, Futurisme, Informatique, Réflexion
2006-03-21
Souvenirs de Milan
Alors que Silvio Berlusconi achève de sombrer dans le ridicule en promettant tout et n'importe quoi, s'acheminant en apparence vers une défaite inéluctable, on se demande si « Il Cavaliere » laissera à sa ville de prédilection, Milan, au moins autant que la famille Sforza qui avait eu l'intelligence d'embaucher Léonard de Vinci... D'une fresque expérimentale qui a presque tout de suite commencé à tomber en miettes (La Cène) aux manuscrits conservés à la Biblioteca Ambrosiana, les fruits du séjour milanais de Léonard suscitent encore aujourd'hui l'intérêt et font courir les foules (avec l'aide de Dan Brown, il est vrai, dans le cas de La Cène). J'inclus à droite ma carte d'usager (éphémère) de la Biblioteca Ambrosiana qui m'a permis de consulter non pas le Codex Atlanticus de Léonard mais des livres qu'il a fort bien pu consulter lui-même, en particulier deux incunables latins — une édition romaine de Vitruve parue en 1486 et une édition florentine de Vitruve parue en 1496. Des livres qui existaient du vivant de Léonard, qui traitaient d'architecture et qui auraient certainement pu l'intéresser à l'époque où il essayait d'apprendre le latin.
suite commencé à tomber en miettes (La Cène) aux manuscrits conservés à la Biblioteca Ambrosiana, les fruits du séjour milanais de Léonard suscitent encore aujourd'hui l'intérêt et font courir les foules (avec l'aide de Dan Brown, il est vrai, dans le cas de La Cène). J'inclus à droite ma carte d'usager (éphémère) de la Biblioteca Ambrosiana qui m'a permis de consulter non pas le Codex Atlanticus de Léonard mais des livres qu'il a fort bien pu consulter lui-même, en particulier deux incunables latins — une édition romaine de Vitruve parue en 1486 et une édition florentine de Vitruve parue en 1496. Des livres qui existaient du vivant de Léonard, qui traitaient d'architecture et qui auraient certainement pu l'intéresser à l'époque où il essayait d'apprendre le latin.
Ce séjour de Léonard à Milan a été si fructueux que même les simples projets, ébauches ou idées du Florentin ont parfois été honorés en connaissant une réalisation a posteriori. Ainsi, la statue équestre conçue par Léonard a été en partie recréée dans un petit parc à l'extérieur du centre-ville, mais tout proche du stade de foot San Siro. En juin 2004, j'avais fait un grand tour de cette banlieue milanaise, tombant enfin sur le cheval inspiré par le projet mort-né de Léonard. À l'origine, il s'agissait de représenter Francesco Sforza trônant sur sa monture caparaçonnée tandis qu'un ennemi vaincu serait étendu sur le sol. Mais cette version du cavallo de Léonard n'a pas de cavalier. Comme s'il s'agissait avec de nombreuses années d'avance d'un funeste augure pour Berlusconi, cavaliere sur le point de vider les étriers, lui aussi... Léonard l'inventeur inspire depuis longtemps des reconstructions de ses inventions sur papier. Les premières que j'ai eu l'occasion de voir étaient exposées à... Chicoutimi! (Sans doute dans la foulée de la grande exposition léonardienne au Musée des Beaux-Arts à Montréal en 1987, car elles faisaient partie d'une exposition à l'ancien Séminaire en 1988, au moment de Boréal 10.) J'en avais découvert d'autres au Clos-Lucé d'Amboise en 1990. Sans surprise, le musée des sciences et des techniques de Milan offre aux visiteurs d'autres machines construites d'après les dessins de Léonard. En juin 2004, je me souviens d'avoir été impressionné par la reconstitution d'un métier à tisser, mais, pour les besoins de ma thèse, j'ai photographié la maquette du mécanisme imaginé par Léonard pour la propulsion de bateaux. Imaginé, mais pas tout à fait inventé, car il n'était pas le premier à plancher sur la navigation mécanique; la combinaison des roues et de l'engrenage, toutefois, est relativement originale.
Léonard l'inventeur inspire depuis longtemps des reconstructions de ses inventions sur papier. Les premières que j'ai eu l'occasion de voir étaient exposées à... Chicoutimi! (Sans doute dans la foulée de la grande exposition léonardienne au Musée des Beaux-Arts à Montréal en 1987, car elles faisaient partie d'une exposition à l'ancien Séminaire en 1988, au moment de Boréal 10.) J'en avais découvert d'autres au Clos-Lucé d'Amboise en 1990. Sans surprise, le musée des sciences et des techniques de Milan offre aux visiteurs d'autres machines construites d'après les dessins de Léonard. En juin 2004, je me souviens d'avoir été impressionné par la reconstitution d'un métier à tisser, mais, pour les besoins de ma thèse, j'ai photographié la maquette du mécanisme imaginé par Léonard pour la propulsion de bateaux. Imaginé, mais pas tout à fait inventé, car il n'était pas le premier à plancher sur la navigation mécanique; la combinaison des roues et de l'engrenage, toutefois, est relativement originale. 
 suite commencé à tomber en miettes (La Cène) aux manuscrits conservés à la Biblioteca Ambrosiana, les fruits du séjour milanais de Léonard suscitent encore aujourd'hui l'intérêt et font courir les foules (avec l'aide de Dan Brown, il est vrai, dans le cas de La Cène). J'inclus à droite ma carte d'usager (éphémère) de la Biblioteca Ambrosiana qui m'a permis de consulter non pas le Codex Atlanticus de Léonard mais des livres qu'il a fort bien pu consulter lui-même, en particulier deux incunables latins — une édition romaine de Vitruve parue en 1486 et une édition florentine de Vitruve parue en 1496. Des livres qui existaient du vivant de Léonard, qui traitaient d'architecture et qui auraient certainement pu l'intéresser à l'époque où il essayait d'apprendre le latin.
suite commencé à tomber en miettes (La Cène) aux manuscrits conservés à la Biblioteca Ambrosiana, les fruits du séjour milanais de Léonard suscitent encore aujourd'hui l'intérêt et font courir les foules (avec l'aide de Dan Brown, il est vrai, dans le cas de La Cène). J'inclus à droite ma carte d'usager (éphémère) de la Biblioteca Ambrosiana qui m'a permis de consulter non pas le Codex Atlanticus de Léonard mais des livres qu'il a fort bien pu consulter lui-même, en particulier deux incunables latins — une édition romaine de Vitruve parue en 1486 et une édition florentine de Vitruve parue en 1496. Des livres qui existaient du vivant de Léonard, qui traitaient d'architecture et qui auraient certainement pu l'intéresser à l'époque où il essayait d'apprendre le latin.Ce séjour de Léonard à Milan a été si fructueux que même les simples projets, ébauches ou idées du Florentin ont parfois été honorés en connaissant une réalisation a posteriori. Ainsi, la statue équestre conçue par Léonard a été en partie recréée dans un petit parc à l'extérieur du centre-ville, mais tout proche du stade de foot San Siro. En juin 2004, j'avais fait un grand tour de cette banlieue milanaise, tombant enfin sur le cheval inspiré par le projet mort-né de Léonard. À l'origine, il s'agissait de représenter Francesco Sforza trônant sur sa monture caparaçonnée tandis qu'un ennemi vaincu serait étendu sur le sol. Mais cette version du cavallo de Léonard n'a pas de cavalier. Comme s'il s'agissait avec de nombreuses années d'avance d'un funeste augure pour Berlusconi, cavaliere sur le point de vider les étriers, lui aussi...
 Léonard l'inventeur inspire depuis longtemps des reconstructions de ses inventions sur papier. Les premières que j'ai eu l'occasion de voir étaient exposées à... Chicoutimi! (Sans doute dans la foulée de la grande exposition léonardienne au Musée des Beaux-Arts à Montréal en 1987, car elles faisaient partie d'une exposition à l'ancien Séminaire en 1988, au moment de Boréal 10.) J'en avais découvert d'autres au Clos-Lucé d'Amboise en 1990. Sans surprise, le musée des sciences et des techniques de Milan offre aux visiteurs d'autres machines construites d'après les dessins de Léonard. En juin 2004, je me souviens d'avoir été impressionné par la reconstitution d'un métier à tisser, mais, pour les besoins de ma thèse, j'ai photographié la maquette du mécanisme imaginé par Léonard pour la propulsion de bateaux. Imaginé, mais pas tout à fait inventé, car il n'était pas le premier à plancher sur la navigation mécanique; la combinaison des roues et de l'engrenage, toutefois, est relativement originale.
Léonard l'inventeur inspire depuis longtemps des reconstructions de ses inventions sur papier. Les premières que j'ai eu l'occasion de voir étaient exposées à... Chicoutimi! (Sans doute dans la foulée de la grande exposition léonardienne au Musée des Beaux-Arts à Montréal en 1987, car elles faisaient partie d'une exposition à l'ancien Séminaire en 1988, au moment de Boréal 10.) J'en avais découvert d'autres au Clos-Lucé d'Amboise en 1990. Sans surprise, le musée des sciences et des techniques de Milan offre aux visiteurs d'autres machines construites d'après les dessins de Léonard. En juin 2004, je me souviens d'avoir été impressionné par la reconstitution d'un métier à tisser, mais, pour les besoins de ma thèse, j'ai photographié la maquette du mécanisme imaginé par Léonard pour la propulsion de bateaux. Imaginé, mais pas tout à fait inventé, car il n'était pas le premier à plancher sur la navigation mécanique; la combinaison des roues et de l'engrenage, toutefois, est relativement originale. 
Libellés : Histoire, Italie, Technologie, Voyages
La France, entre frondes et jacqueries
L'éditorialiste de L'Express affirmait l'autre jour que le monde était médusé par les remous que provoque actuellement le CPE en France. « Une fois encore, une fois de plus, la France offre en spectacle au monde stupéfait l'un de ces psychodrames aussi coûteux qu'inutiles dont elle a le secret. » En fait, Denis Jeambar se trompait.
Non, le reste du monde n'est plus stupéfait. Il en a trop vu ces derniers temps et la grève impromptue française — assortie ou non de manifestations à la carte — lui apparaît désormais
comme une tradition pittoresque, un peu gênante pour les voyageurs de passage mais aussi caractéristique de la France que les fromages au lait cru. Il en sourit plutôt, si ce n'est que parce qu'il serait injuste qu'un pays à ce point comblé en dons de la nature et de l'histoire jouisse aussi d'une paix sociale et d'un ordre public inattaquables. Bref, qu'un tel pays de Cocagne sache aussi se gouverner.
Ce qui frappe, c'est le caractère contradictoire des manifs actuelles et des violences urbaines de l'automne dernier. L'opposition au CPE s'organise au nom de la lutte à la précarité de la vie et du travail pour les jeunes. Soit. Ce que retient surtout le reste du monde, c'est que, dans les pays industrialisés autres que la France, les conditions du CPE apparaîtraient comme nullement extraordinaires alors que ces autres pays font plutôt mieux que la France quand il s'agit de réduire le chômage ou le sous-emploi des jeunes.
Que se passe-t-il alors? Une façon de regarder les choses, c'est sans doute de retenir de l'histoire de France qu'elle a été parsemée de deux types de mouvements de résistance : les frondes et les jacqueries. Les frondes étaient le fait des grands et des puissants de ce monde, nobles et bourgeois réclamant plus de privilèges pour eux, pour les communes qu'ils habitaient, pour la gouverne de leurs fiefs ou pour les parlements où ils se retrouvaient entre eux. Et les jacqueries étaient le fait des pauvres, des misérables, des affamés et des exclus qui n'en pouvaient plus de se faire marcher dessus et qui passaient à l'action pour défendre leur dernier carré ou s'emparer de ce qui leur manquait pour avoir le minimum vital.
Si les « violences urbaines » ressemblaient plutôt à des simulacres de jacqueries (dans la mesure où ces violences tenaient plutôt de la démonstration de force et du marquage du territoire que d'une véritable forme de violence, à quelques incidents près), les manifestations actuelles ont certains traits d'une fronde dans la mesure où ce sont des privilégiés (syndiqués et étudiants promis à des carrières plus intéressantes qu'autrement) qui protestent — des privilégiés relativement aux jeunes des banlieues, souvent sous-qualifiés et sous-employés même quand ils ont obtenu des diplômes. Par définition, convoquer une grève générale qui ne peut concerner que ceux qui travaillent alors que le problème visé, c'est l'absence de travail, cela permet tout de suite de reconnaître que les opposants au CPE ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la classe d'âge concernée.
De toute manière, discuter sans fin des avantages et des désavantages du CPE fait oublier une question. Les frondes et les jacqueries ont-elles jamais fait changer les choses pour le mieux en France?
Non, le reste du monde n'est plus stupéfait. Il en a trop vu ces derniers temps et la grève impromptue française — assortie ou non de manifestations à la carte — lui apparaît désormais
comme une tradition pittoresque, un peu gênante pour les voyageurs de passage mais aussi caractéristique de la France que les fromages au lait cru. Il en sourit plutôt, si ce n'est que parce qu'il serait injuste qu'un pays à ce point comblé en dons de la nature et de l'histoire jouisse aussi d'une paix sociale et d'un ordre public inattaquables. Bref, qu'un tel pays de Cocagne sache aussi se gouverner.
Ce qui frappe, c'est le caractère contradictoire des manifs actuelles et des violences urbaines de l'automne dernier. L'opposition au CPE s'organise au nom de la lutte à la précarité de la vie et du travail pour les jeunes. Soit. Ce que retient surtout le reste du monde, c'est que, dans les pays industrialisés autres que la France, les conditions du CPE apparaîtraient comme nullement extraordinaires alors que ces autres pays font plutôt mieux que la France quand il s'agit de réduire le chômage ou le sous-emploi des jeunes.
Que se passe-t-il alors? Une façon de regarder les choses, c'est sans doute de retenir de l'histoire de France qu'elle a été parsemée de deux types de mouvements de résistance : les frondes et les jacqueries. Les frondes étaient le fait des grands et des puissants de ce monde, nobles et bourgeois réclamant plus de privilèges pour eux, pour les communes qu'ils habitaient, pour la gouverne de leurs fiefs ou pour les parlements où ils se retrouvaient entre eux. Et les jacqueries étaient le fait des pauvres, des misérables, des affamés et des exclus qui n'en pouvaient plus de se faire marcher dessus et qui passaient à l'action pour défendre leur dernier carré ou s'emparer de ce qui leur manquait pour avoir le minimum vital.
Si les « violences urbaines » ressemblaient plutôt à des simulacres de jacqueries (dans la mesure où ces violences tenaient plutôt de la démonstration de force et du marquage du territoire que d'une véritable forme de violence, à quelques incidents près), les manifestations actuelles ont certains traits d'une fronde dans la mesure où ce sont des privilégiés (syndiqués et étudiants promis à des carrières plus intéressantes qu'autrement) qui protestent — des privilégiés relativement aux jeunes des banlieues, souvent sous-qualifiés et sous-employés même quand ils ont obtenu des diplômes. Par définition, convoquer une grève générale qui ne peut concerner que ceux qui travaillent alors que le problème visé, c'est l'absence de travail, cela permet tout de suite de reconnaître que les opposants au CPE ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la classe d'âge concernée.
De toute manière, discuter sans fin des avantages et des désavantages du CPE fait oublier une question. Les frondes et les jacqueries ont-elles jamais fait changer les choses pour le mieux en France?
2006-03-19
Un parc en danger
Le parc du Mont-Orford sans le mont Orford? Il y a de ces absurdités qui portent tout de suite l'humeur du citoyen au point d'ébullition. Vendre l'essentiel du mont Orford pour agrandir un parc désormais privé de son point culminant éponyme? Une fois de plus, on s'interroge non sur les intentions du gouvernement Charest mais sur sa lucidité politique. Le parc du Mont-Orford est sans doute un des parcs québécois les plus connus de la population québécoise; il fallait s'attendre à ce que la réaction soit particulièrement vive et que la question ne puisse pas être traitée comme une simple affaire locale.
Personnellement, j'avais été déçu de constater à quel point le parc était déjà « développé » quand je l'avais visité. Terrains de camping au bord du lac, pistes de ski, routes asphaltées à l'intérieur des limites du parc, golf limitrophe... Je suis porté à faire une exception pour le Centre d'arts et l'auberge de jeunesse qui sont situés en périphérie du parc et qui sont d'utilité publique. En outre, quand j'avais débarqué de l'autobus de Magog à la sortie de l'autoroute pour entrer dans le parc à pied (à une époque où c'était gratuit), j'avais observé des domiciles prévus en bordure de rivière à l'intérieur du parc. J'ignore si ce projet a été mené à bien, mais la simple possibilité de proposer un lotissement dans un parc suffisait à faire descendre le parc — ou le « modèle québécois » en la matière — dans mon estime.
Bref, on ne s'étonnera pas que la résistance s'organise. Elle est d'autant plus vive que le Québec est loin de pouvoir se péter les bretelles dans ce domaine, malgré la conviction des Québécois d'être plus verts que la moyenne. En fait, s'il y a de nombreuses réserves fauniques au Québec, le niveau de protection de ces zones est très variable. Le rapport final de la commission Coulombe l'énonçait clairement dans le chapitre 4 (.PDF).
À l'international, la comparaison n'est pas favorable. Je cite : « Selon la Commission mondiale des aires protégées, environ 11% de la surface terrestre jouit actuellement d'un statut de protection, selon les catégories I à VI de l'Union mondiale pour la nature (UICN).» (p. 54) En 2004, on estimait à 5,4% de la surface du Québec l'étendue des zones protégées. Admettons que le Québec a, en principe, les moyens d'assurer une protection réelle à ces régions alors que des pays ailleurs dans le monde ne le peuvent peut-être pas. Mais la comparaison avec le reste du Canada n'est pas plus encourageante. L'Alberta et la Colombie-Britannique protègent plus de 12% de leurs territoires, le seuil minimum recommandé par le Rappport Brundtland en 1987. Admettons qu'il est plus facile de protéger des montagnes et des glaciers que des forêts potentiellement productives (même si la Colombie-Britannique continue à aller de l'avant avec de nouvelles mesures de protection de sa précieuse forêt pluviale). Mais l'Ontario, qui ressemble beaucoup plus au Québec que ces deux provinces, protège pourtant 9% de son territoire. À l'échelle du Canada, enfin, c'est 9,9% du territoire qui est protégé.
La conscience du rattrapage qui s'impose au Québec est sans doute pour beaucoup dans la réaction au projet du gouvernement Charest — même si les considérations purement politiques (hostilité épidermique aux Libéraux, cynisme et dédain face aux mœurs politiques) semblent l'emporter sur les considérations plus écologiques. Pourtant, au sud et à proximité du Saint-Laurent (c'est-à-dire dans les provinces naturelles A et B du Québec, soit les Appalaches et les basses-terres du Saint-Laurent), seulement 0,26% du territoire jouit d'une protection admissible aux trois paliers supérieurs du classement de l'UICN. Au total, 5,88% du territoire entre dans les six paliers supérieurs, mais les basses-terres du Saint-Laurent qui forment la région naturelle habitée par la plus grande partie des Québécois ne peuvent revendiquer que 1,44% d'aires protégées contre 4,44% pour la région des Appalaches.
En termes concrets, il n'y a que 10 kilomètres carrés (0,2% de l'ensemble) dans cette région des basses-terres laurentiennes qui soient protégés selon les trois paliers supérieurs de l'UICN. La carence est telle qu'on comprend mieux comment le gouvernement Charest s'est enfoncé dans un authentique bourbier en touchant à un des rares joyaux naturels à une distance raisonnable de Montréal...
Personnellement, j'avais été déçu de constater à quel point le parc était déjà « développé » quand je l'avais visité. Terrains de camping au bord du lac, pistes de ski, routes asphaltées à l'intérieur des limites du parc, golf limitrophe... Je suis porté à faire une exception pour le Centre d'arts et l'auberge de jeunesse qui sont situés en périphérie du parc et qui sont d'utilité publique. En outre, quand j'avais débarqué de l'autobus de Magog à la sortie de l'autoroute pour entrer dans le parc à pied (à une époque où c'était gratuit), j'avais observé des domiciles prévus en bordure de rivière à l'intérieur du parc. J'ignore si ce projet a été mené à bien, mais la simple possibilité de proposer un lotissement dans un parc suffisait à faire descendre le parc — ou le « modèle québécois » en la matière — dans mon estime.
Bref, on ne s'étonnera pas que la résistance s'organise. Elle est d'autant plus vive que le Québec est loin de pouvoir se péter les bretelles dans ce domaine, malgré la conviction des Québécois d'être plus verts que la moyenne. En fait, s'il y a de nombreuses réserves fauniques au Québec, le niveau de protection de ces zones est très variable. Le rapport final de la commission Coulombe l'énonçait clairement dans le chapitre 4 (.PDF).
À l'international, la comparaison n'est pas favorable. Je cite : « Selon la Commission mondiale des aires protégées, environ 11% de la surface terrestre jouit actuellement d'un statut de protection, selon les catégories I à VI de l'Union mondiale pour la nature (UICN).» (p. 54) En 2004, on estimait à 5,4% de la surface du Québec l'étendue des zones protégées. Admettons que le Québec a, en principe, les moyens d'assurer une protection réelle à ces régions alors que des pays ailleurs dans le monde ne le peuvent peut-être pas. Mais la comparaison avec le reste du Canada n'est pas plus encourageante. L'Alberta et la Colombie-Britannique protègent plus de 12% de leurs territoires, le seuil minimum recommandé par le Rappport Brundtland en 1987. Admettons qu'il est plus facile de protéger des montagnes et des glaciers que des forêts potentiellement productives (même si la Colombie-Britannique continue à aller de l'avant avec de nouvelles mesures de protection de sa précieuse forêt pluviale). Mais l'Ontario, qui ressemble beaucoup plus au Québec que ces deux provinces, protège pourtant 9% de son territoire. À l'échelle du Canada, enfin, c'est 9,9% du territoire qui est protégé.
La conscience du rattrapage qui s'impose au Québec est sans doute pour beaucoup dans la réaction au projet du gouvernement Charest — même si les considérations purement politiques (hostilité épidermique aux Libéraux, cynisme et dédain face aux mœurs politiques) semblent l'emporter sur les considérations plus écologiques. Pourtant, au sud et à proximité du Saint-Laurent (c'est-à-dire dans les provinces naturelles A et B du Québec, soit les Appalaches et les basses-terres du Saint-Laurent), seulement 0,26% du territoire jouit d'une protection admissible aux trois paliers supérieurs du classement de l'UICN. Au total, 5,88% du territoire entre dans les six paliers supérieurs, mais les basses-terres du Saint-Laurent qui forment la région naturelle habitée par la plus grande partie des Québécois ne peuvent revendiquer que 1,44% d'aires protégées contre 4,44% pour la région des Appalaches.
En termes concrets, il n'y a que 10 kilomètres carrés (0,2% de l'ensemble) dans cette région des basses-terres laurentiennes qui soient protégés selon les trois paliers supérieurs de l'UICN. La carence est telle qu'on comprend mieux comment le gouvernement Charest s'est enfoncé dans un authentique bourbier en touchant à un des rares joyaux naturels à une distance raisonnable de Montréal...
Libellés : Environnement, Québec
2006-03-18
L'émerveillement selon Miyazaki
La bonne nouvelle, c'est qu'il me reste quelques œuvres de Miyazaki Hayao à découvrir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a une de moins depuis que j'ai visionné Kiki's Delivery Service.
C'est très strictement l'histoire d'un destin individuel et il ne s'y mêle pas les aspects plus tragiques de Princesse Mononoke, Laputa, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant ou Porco Rosso. Pas de guerre sanglante en arrière-plan, pas d'injustices ou de drames séculaires à dévoiler, pas de conflits entre des allégeances rivales... Le récit n'évoque qu'en passant les distinctions de classe et l'immense dirigeable forcé de faire escale près de la ville choisie par la jeune Kiki n'a pas, semble-t-il, de finalité guerrière.
D'un film à l'autre se retrouvent suffisamment d'ingrédients pour qu'on parle, sinon d'une formule, du moins d'une recette — mais de la recette d'un excellent plat, que peu de chefs cuisiniers pourraient réussir. Plusieurs éléments de la recette se retrouvent dans Kiki's Delivery Service (Kiki la petite sorcière en français; Nicky aprendiz de bruja en castillan), dont un dirigeable, un voyage en chemin de fer (et un autre en autobus), de la pluie, une jeune fille qui fait son chemin dans le monde en livrant des colis mais aussi en se chargeant de sa part de nettoyage, car Miyazaki tend à transformer une besogne censément inférieure en une force régénératrice, symbolique du bien que peut faire une personne, Kiki en l'occurrence (mais plusieurs autres héroïnes de ses films); ranger, nettoyer, servir, c'est rendre le monde meilleur d'une manière très concrète et c'est aussi faire l'éloge d'une forme de pureté.
Il faudrait aussi parler du choix des décors. Dans Porco Rosso, Miyazaki avait choisi l'Italie du Nord, de Milan à l'Adriatique; dans Laputa, un village de mineurs britanniques; dans Princesse Mononoke et Le voyage de Chihiro, c'était l'ancien Japon qui était à l'honneur. La ville au bord de la mer que rejoint Kiki a quelque chose de scandinave, ou de germanique. Dans l'architecture des bâtiments et la présence de maisons à colombages, dans les quelques inscriptions lisibles sur les devantures, dans la propreté des rues sillonnées de trams (et d'autobus portant le nom des studios Ghibli si on reste vigilant), on retrouve quelque chose de ces villes égrenées de l'Italie du Nord jusqu'à Copenhague ou Stockholm. Et, bien entendu, dans le départ même de Kiki pour une année initiatique, on retrouve un écho de la coutume de la Wanderjahr traditionnelle allemande.
Le choix de lieux au moins un peu exotiques tant pour les Japonais que pour les Occidentaux qui connaissent moins le milieu de l'Europe, c'est-à-dire une Mitteleuropa étirée qui va de la Suède à la Lombardie, est sans doute pour quelque chose dans l'attrait des histoires toutes simples de Miyazaki, mais si merveilleusement « épaisses », enrichies de détails visuels et humains qui, dans le meilleur des cas, se recoupent et se complètent. Ce qui revient souvent dans le film, c'est l'émerveillement de Kiki face à la mer ou face à un paysage inattendu. Quel voyageur n'a pas ressenti le même émerveillement en découvrant une belle ville inconnue, un panorama vert et vallonné, ou la mer, la mer, la mer...
Cet émerveillement est sûrement parent du sense of wonder que l'on dit propre à la science-fiction. En partie parce qu'il est plus fréquent ou plus intense ou les deux quand on est jeune. On a souvent fait de la science-fiction une littérature adolescente parce qu'elle joue sur les joies de la découverte, de la compréhension, de l'illumination, bref, de l'apprentissage. Dans les meilleurs films de Miyazaki, il y a de semblables instants d'émerveillement — plus sombre dans Porco Rosso, plus ambigus dans Le voyage de Chihiro, plus poignants dans Laputa et surtout dans Princesse Mononoke... Comme ces moments admirables sont surtout visuels, il est difficile de concevoir de faire l'équivalent dans un contexte purement littéraire. La parole imprimée peut, au mieux, capturer l'impression produite sur un personnage ou plusieurs, mais non reproduire la source même de cette impression. Mais la littérature s'y essaie quand même à l'occasion — je songe ici aux descriptions du désert dans Seven Pillars of Wisdom ou à celles de la planète rouge dans Red Mars de Robinson. À mon avis, le succès est mitigé dans un cas comme dans l'autre. Le sublime visuel ne passe pas si facilement l'obstacle des mots.
C'est très strictement l'histoire d'un destin individuel et il ne s'y mêle pas les aspects plus tragiques de Princesse Mononoke, Laputa, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant ou Porco Rosso. Pas de guerre sanglante en arrière-plan, pas d'injustices ou de drames séculaires à dévoiler, pas de conflits entre des allégeances rivales... Le récit n'évoque qu'en passant les distinctions de classe et l'immense dirigeable forcé de faire escale près de la ville choisie par la jeune Kiki n'a pas, semble-t-il, de finalité guerrière.
D'un film à l'autre se retrouvent suffisamment d'ingrédients pour qu'on parle, sinon d'une formule, du moins d'une recette — mais de la recette d'un excellent plat, que peu de chefs cuisiniers pourraient réussir. Plusieurs éléments de la recette se retrouvent dans Kiki's Delivery Service (Kiki la petite sorcière en français; Nicky aprendiz de bruja en castillan), dont un dirigeable, un voyage en chemin de fer (et un autre en autobus), de la pluie, une jeune fille qui fait son chemin dans le monde en livrant des colis mais aussi en se chargeant de sa part de nettoyage, car Miyazaki tend à transformer une besogne censément inférieure en une force régénératrice, symbolique du bien que peut faire une personne, Kiki en l'occurrence (mais plusieurs autres héroïnes de ses films); ranger, nettoyer, servir, c'est rendre le monde meilleur d'une manière très concrète et c'est aussi faire l'éloge d'une forme de pureté.
Il faudrait aussi parler du choix des décors. Dans Porco Rosso, Miyazaki avait choisi l'Italie du Nord, de Milan à l'Adriatique; dans Laputa, un village de mineurs britanniques; dans Princesse Mononoke et Le voyage de Chihiro, c'était l'ancien Japon qui était à l'honneur. La ville au bord de la mer que rejoint Kiki a quelque chose de scandinave, ou de germanique. Dans l'architecture des bâtiments et la présence de maisons à colombages, dans les quelques inscriptions lisibles sur les devantures, dans la propreté des rues sillonnées de trams (et d'autobus portant le nom des studios Ghibli si on reste vigilant), on retrouve quelque chose de ces villes égrenées de l'Italie du Nord jusqu'à Copenhague ou Stockholm. Et, bien entendu, dans le départ même de Kiki pour une année initiatique, on retrouve un écho de la coutume de la Wanderjahr traditionnelle allemande.
Le choix de lieux au moins un peu exotiques tant pour les Japonais que pour les Occidentaux qui connaissent moins le milieu de l'Europe, c'est-à-dire une Mitteleuropa étirée qui va de la Suède à la Lombardie, est sans doute pour quelque chose dans l'attrait des histoires toutes simples de Miyazaki, mais si merveilleusement « épaisses », enrichies de détails visuels et humains qui, dans le meilleur des cas, se recoupent et se complètent. Ce qui revient souvent dans le film, c'est l'émerveillement de Kiki face à la mer ou face à un paysage inattendu. Quel voyageur n'a pas ressenti le même émerveillement en découvrant une belle ville inconnue, un panorama vert et vallonné, ou la mer, la mer, la mer...
Cet émerveillement est sûrement parent du sense of wonder que l'on dit propre à la science-fiction. En partie parce qu'il est plus fréquent ou plus intense ou les deux quand on est jeune. On a souvent fait de la science-fiction une littérature adolescente parce qu'elle joue sur les joies de la découverte, de la compréhension, de l'illumination, bref, de l'apprentissage. Dans les meilleurs films de Miyazaki, il y a de semblables instants d'émerveillement — plus sombre dans Porco Rosso, plus ambigus dans Le voyage de Chihiro, plus poignants dans Laputa et surtout dans Princesse Mononoke... Comme ces moments admirables sont surtout visuels, il est difficile de concevoir de faire l'équivalent dans un contexte purement littéraire. La parole imprimée peut, au mieux, capturer l'impression produite sur un personnage ou plusieurs, mais non reproduire la source même de cette impression. Mais la littérature s'y essaie quand même à l'occasion — je songe ici aux descriptions du désert dans Seven Pillars of Wisdom ou à celles de la planète rouge dans Red Mars de Robinson. À mon avis, le succès est mitigé dans un cas comme dans l'autre. Le sublime visuel ne passe pas si facilement l'obstacle des mots.
2006-03-17
Les questions qu'on ne pose pas
Il y a des questions que les journalistes ne posent pas. Ils savent peut-être qu'ils n'obtiendront pas de réponse, au nom de tel ou tel prétexte. Mais il faudrait parfois que la question soit posée quand même.
Le débat sur la présence de l'armée canadienne en Afghanistan, et plus précisément dans le sud du pays, a été d'une nullité consternante. Tout d'abord, il a tourné autour de la dichotomie entre maintien de la paix et conduite d'une guerre. Or, dans une culture nord-américaine qui carbure à la testostérone de droite (toujours prête à gonfler les muscles tant que ce sont les autres qui en subissent les effets secondaires), on n'hésite pas à parler d'une guerre pour faire plaisir aux plus belliqueux, alors que parler vrai, ce serait admettre que nous sommes quelque part entre les deux.
Le maintien de la paix traditionnel présupposait deux adversaires, souvent de nations différentes, qu'il était possible de cantonner de part et d'autre d'une frontière. Il supposait aussi la signature d'une trêve, à tout le moins.
Or, la victoire a été déclarée à Kaboul par les alliés des États-Unis, mais aucune paix n'a été signée. Une fois les Talibans évincés du pouvoir en Afghanistan, les Américains ont cru qu'il était possible de faire comme s'ils n'existaient plus. De toute évidence, il en reste suffisamment pour animer une insurrection aux intentions difficiles à définir. La reconquête de tout l'Afghanistan (ce que le régime taliban n'avait jamais réussi, ne l'oublions pas)? L'évacuation de tous les Occidentaux et infidèles afin d'imposer des régimes islamistes où ce faire se peut? On aimerait en savoir plus sur les véritables objectifs des islamistes.
Faute de paix, est-ce pour autant la guerre? Il faut être deux pour faire la paix, mais un seul pour faire la guerre. Si les Talibans considèrent qu'ils poursuivent une guerre entamée en 2001, il s'agit donc bel et bien d'une guerre, même si on peut l'appeler larvée ou parler d'une insurrection. On pourrait certes évoquer une guerre civile, si ce n'était de tous les intervenants étrangers. Dont le Canada, maintenant.
L'historien ne peut s'empêcher de penser à la guerre de Trente Ans en Europe au XVIIe siècle : de 1618 à 1648, l'Allemagne avait servi de champ de bataille aux Catholiques et aux protestants de tout crin, ainsi qu'à des armées étrangères venues de tous les horizons. Depuis bientôt trente ans, c'est ce qui se passe en Afghanistan. Tout comme la guerre de Trente Ans avait opposé des factions chrétiennes, celle-ci oppose des factions musulmanes, avec l'intervention en sus de soldats soviétiques, européens et nord-américains — et d'agents pakistanais, voire iraniens... Il était sorti de la guerre de Trente Ans la fameuse paix de Westphalie qui avait instauré un nouveau cadre pour la conduite des guerres. Le terrorisme international et la guerre préventive de Bush contre l'Irak ont fait voler en éclats ce cadre. Mais si jamais la guerre en Afghanistan et Irak se propageait au pays entre les deux, l'Iran, nous nous compterons heureux si tout se termine en 2009 — et s'il en résulte quelque chose comme les traités de Westphalie.
Le débat a ensuite porté sur la stratégie du Canada et de l'OTAN. Une belle manœuvre d'évitement, car il faut avoir des vues profondes pour sembler s'opposer au maintien de la paix et d'un régime plus ou moins démocratique dans un pays qui en a bien besoin. Or, si la tactique est fille de la stratégie, la tactique porte aussi la stratégie sur ses épaules, comme Énée Anchise.
Autrement dit, si la tactique fait défaut, la stratégie, aussi vertueuse et louable soit-elle, se casse la figure.
Or, personne ne semble s'interroger (du moins, pas longtemps) sur les tactiques canadiennes. Pourtant, elles semblent en grande partie inspirée par les tactiques des militaires étatsuniens (et, à travers eux, de Tsahal en ce qui concerne les occupations musclées), des tactiques qui sont loin d'avoir fait leurs preuves, en Irak comme en Palestine. (C'est une litote.) Pour un peu, on serait tenté de l'imputer à un manque d'imagination de nos militaires — et de regretter la tradition novatrice des grands états-majors allemands d'avant 1945. Sauf que même l'armée allemande n'a pas trouvé le secret de vaincre des insurrections sans recourir à des mesures répressives extrêmes, que ce soit durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde.
En particulier, après la mort d'un Afghan dont le véhicule avait eu le malheur de s'approcher un peu trop d'un convoi canadien, on devrait au moins poser une question sur la règle qui permet aux soldats canadiens de tirer sur les véhicules suspects. Cette question, c'est la suivante : est-ce que cela fonctionne?
Autrement dit, nous savons qu'en Irak, les troupes des États-Unis ont causé de nombreuses morts innocentes en tirant sur des véhicules suspects. (Sans parler des blessés et des survivants traumatisés.) Mais combien de fois ont-elles réussi à stopper ainsi un kamikaze déterminé? Entendons-nous : je ne doute pas que les soldats américains aient tiré sur les kamikazes qui s'en sont pris à leurs convois. Ils n'ont pas toujours tiré sans justification, non. Mais combien de fois ont-ils réussi à stopper une attaque et combien de fois ont-ils versé le sang pour rien? Bref, quel est le taux d'efficacité de ces tirs?
Car, si le taux d'efficacité de ces tirs était bas, on pourrait se demander très froidement si cela sert vraiment à quelque chose d'avoir le doigt sur la gâchette. Et s'il ne vaudrait pas mieux, pour les soldats canadiens juchés sur les véhicules, profiter de ces quelques secondes pour se mettre à l'abri au lieu de tirer... Cui bono? À qui profitent vraiment ces tactiques héritées des Américains? Posons aussi cette question : la réponse pourrait nous surprendre.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les agents du SOE britanniques détachés auprès des partisans de Tito enfouissaient parfois des armes hors d'usage dans les meules de foin des villages qu'ils contournaient durant la nuit. Si les Allemands trouvaient ces armes, leurs soupçons se porteraient automatiquement sur les villageois et toute mesure prise par les Allemands en conséquence — arrestations et interrogatoires musclés, prises d'otages, exécutions sommaires — leur susciterait de nouveaux ennemis alors que les villageois en cause étaient sans doute plus ou moins dans l'expectative auparavant.
Alors, demandons-nous si cela n'arrange pas les insurgés que de provoquer, au moyen d'une attaque occasionnelle, des ripostes anticipées en série qui suscitent aux Canadiens et autres militaires étrangers de nouveaux ennemis...
Ce qui semble certain, c'est que le Canada, alors qu'il accepte de prendre la relève des États-Unis dans un secteur des plus chauds, n'en a pas profité pour essayer de renouver la doctrine militaire en usage. Sans doute que le Canada avait trop l'impression de se faire pardonner son opposition à l'invasion de l'Irak en participant à la guerre en Afghanistan pour exiger une contrepartie à un engagement pourtant substantiel et le classant parmi les alliés les plus importants des États-Unis. Dommage.
Le débat sur la présence de l'armée canadienne en Afghanistan, et plus précisément dans le sud du pays, a été d'une nullité consternante. Tout d'abord, il a tourné autour de la dichotomie entre maintien de la paix et conduite d'une guerre. Or, dans une culture nord-américaine qui carbure à la testostérone de droite (toujours prête à gonfler les muscles tant que ce sont les autres qui en subissent les effets secondaires), on n'hésite pas à parler d'une guerre pour faire plaisir aux plus belliqueux, alors que parler vrai, ce serait admettre que nous sommes quelque part entre les deux.
Le maintien de la paix traditionnel présupposait deux adversaires, souvent de nations différentes, qu'il était possible de cantonner de part et d'autre d'une frontière. Il supposait aussi la signature d'une trêve, à tout le moins.
Or, la victoire a été déclarée à Kaboul par les alliés des États-Unis, mais aucune paix n'a été signée. Une fois les Talibans évincés du pouvoir en Afghanistan, les Américains ont cru qu'il était possible de faire comme s'ils n'existaient plus. De toute évidence, il en reste suffisamment pour animer une insurrection aux intentions difficiles à définir. La reconquête de tout l'Afghanistan (ce que le régime taliban n'avait jamais réussi, ne l'oublions pas)? L'évacuation de tous les Occidentaux et infidèles afin d'imposer des régimes islamistes où ce faire se peut? On aimerait en savoir plus sur les véritables objectifs des islamistes.
Faute de paix, est-ce pour autant la guerre? Il faut être deux pour faire la paix, mais un seul pour faire la guerre. Si les Talibans considèrent qu'ils poursuivent une guerre entamée en 2001, il s'agit donc bel et bien d'une guerre, même si on peut l'appeler larvée ou parler d'une insurrection. On pourrait certes évoquer une guerre civile, si ce n'était de tous les intervenants étrangers. Dont le Canada, maintenant.
L'historien ne peut s'empêcher de penser à la guerre de Trente Ans en Europe au XVIIe siècle : de 1618 à 1648, l'Allemagne avait servi de champ de bataille aux Catholiques et aux protestants de tout crin, ainsi qu'à des armées étrangères venues de tous les horizons. Depuis bientôt trente ans, c'est ce qui se passe en Afghanistan. Tout comme la guerre de Trente Ans avait opposé des factions chrétiennes, celle-ci oppose des factions musulmanes, avec l'intervention en sus de soldats soviétiques, européens et nord-américains — et d'agents pakistanais, voire iraniens... Il était sorti de la guerre de Trente Ans la fameuse paix de Westphalie qui avait instauré un nouveau cadre pour la conduite des guerres. Le terrorisme international et la guerre préventive de Bush contre l'Irak ont fait voler en éclats ce cadre. Mais si jamais la guerre en Afghanistan et Irak se propageait au pays entre les deux, l'Iran, nous nous compterons heureux si tout se termine en 2009 — et s'il en résulte quelque chose comme les traités de Westphalie.
Le débat a ensuite porté sur la stratégie du Canada et de l'OTAN. Une belle manœuvre d'évitement, car il faut avoir des vues profondes pour sembler s'opposer au maintien de la paix et d'un régime plus ou moins démocratique dans un pays qui en a bien besoin. Or, si la tactique est fille de la stratégie, la tactique porte aussi la stratégie sur ses épaules, comme Énée Anchise.
Autrement dit, si la tactique fait défaut, la stratégie, aussi vertueuse et louable soit-elle, se casse la figure.
Or, personne ne semble s'interroger (du moins, pas longtemps) sur les tactiques canadiennes. Pourtant, elles semblent en grande partie inspirée par les tactiques des militaires étatsuniens (et, à travers eux, de Tsahal en ce qui concerne les occupations musclées), des tactiques qui sont loin d'avoir fait leurs preuves, en Irak comme en Palestine. (C'est une litote.) Pour un peu, on serait tenté de l'imputer à un manque d'imagination de nos militaires — et de regretter la tradition novatrice des grands états-majors allemands d'avant 1945. Sauf que même l'armée allemande n'a pas trouvé le secret de vaincre des insurrections sans recourir à des mesures répressives extrêmes, que ce soit durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde.
En particulier, après la mort d'un Afghan dont le véhicule avait eu le malheur de s'approcher un peu trop d'un convoi canadien, on devrait au moins poser une question sur la règle qui permet aux soldats canadiens de tirer sur les véhicules suspects. Cette question, c'est la suivante : est-ce que cela fonctionne?
Autrement dit, nous savons qu'en Irak, les troupes des États-Unis ont causé de nombreuses morts innocentes en tirant sur des véhicules suspects. (Sans parler des blessés et des survivants traumatisés.) Mais combien de fois ont-elles réussi à stopper ainsi un kamikaze déterminé? Entendons-nous : je ne doute pas que les soldats américains aient tiré sur les kamikazes qui s'en sont pris à leurs convois. Ils n'ont pas toujours tiré sans justification, non. Mais combien de fois ont-ils réussi à stopper une attaque et combien de fois ont-ils versé le sang pour rien? Bref, quel est le taux d'efficacité de ces tirs?
Car, si le taux d'efficacité de ces tirs était bas, on pourrait se demander très froidement si cela sert vraiment à quelque chose d'avoir le doigt sur la gâchette. Et s'il ne vaudrait pas mieux, pour les soldats canadiens juchés sur les véhicules, profiter de ces quelques secondes pour se mettre à l'abri au lieu de tirer... Cui bono? À qui profitent vraiment ces tactiques héritées des Américains? Posons aussi cette question : la réponse pourrait nous surprendre.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les agents du SOE britanniques détachés auprès des partisans de Tito enfouissaient parfois des armes hors d'usage dans les meules de foin des villages qu'ils contournaient durant la nuit. Si les Allemands trouvaient ces armes, leurs soupçons se porteraient automatiquement sur les villageois et toute mesure prise par les Allemands en conséquence — arrestations et interrogatoires musclés, prises d'otages, exécutions sommaires — leur susciterait de nouveaux ennemis alors que les villageois en cause étaient sans doute plus ou moins dans l'expectative auparavant.
Alors, demandons-nous si cela n'arrange pas les insurgés que de provoquer, au moyen d'une attaque occasionnelle, des ripostes anticipées en série qui suscitent aux Canadiens et autres militaires étrangers de nouveaux ennemis...
Ce qui semble certain, c'est que le Canada, alors qu'il accepte de prendre la relève des États-Unis dans un secteur des plus chauds, n'en a pas profité pour essayer de renouver la doctrine militaire en usage. Sans doute que le Canada avait trop l'impression de se faire pardonner son opposition à l'invasion de l'Irak en participant à la guerre en Afghanistan pour exiger une contrepartie à un engagement pourtant substantiel et le classant parmi les alliés les plus importants des États-Unis. Dommage.
Libellés : Afghanistan, Canada, Guerre
2006-03-16
Portrait de l'artiste en jeune homme, bis
Je n'enseigne qu'un cours à l'Université d'Ottawa, mais, comme il compte de 145 à plus de 170 étudiants selon les semestres, je trouve que ce n'est pas exagéré de dire qu'il compte double, ou triple. De plus, comme je fais l'aller-retour entre Ottawa et Montréal, il est assez juste de dire que mon milieu de semaine est entièrement pris par la préparation du cours, l'enseignement du cours... et la récupération subséquente. Autrement dit, je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui.
Comme j'étais un peu indisposé, j'ai poursuivi sur ma lancée de la veille en exhumant quelques vieilles photos familiales de plus. Celle-ci peut faire pendant à celle que j'avais retrouvée précédemment. Après le fils, le père. Eh oui, il s'agit de mon père, installé à la machine à écrire, dans un sous-sol de Westmount (au 1019 Greene Avenue, à cinq minutes à pied de l'ancien Forum selon la carte... il faudra que j'aille faire un tour un de ces jours) le 28 juin 1950. Il faut savoir qu'à cette époque, l'écriture, que ce soit pour les journaux ou pour l'édition, avait un cachet qu'elle a un peu perdu...
retrouvée précédemment. Après le fils, le père. Eh oui, il s'agit de mon père, installé à la machine à écrire, dans un sous-sol de Westmount (au 1019 Greene Avenue, à cinq minutes à pied de l'ancien Forum selon la carte... il faudra que j'aille faire un tour un de ces jours) le 28 juin 1950. Il faut savoir qu'à cette époque, l'écriture, que ce soit pour les journaux ou pour l'édition, avait un cachet qu'elle a un peu perdu...
Rappelez-vous que nous sommes encore à l'époque des pulps et des épais supplements dominicaux des journaux. Les écrivains peuvent encore circuler assez facilement entre la presse, la radio et même la télévision plus ou moins embryonnaire — et se faire payer pour ce qu'ils écrivent. Il y a quelque chose de plus artisanal et, disons-le, de plus normal à vouloir publier dans un contexte où cela peut devenir un métier, et même faire de vous une vedette susceptible de marier Marilyn Monroe. (J'anticipe un peu : Arthur Miller n'allait épouser Monroe qu'en 1956.)
Ainsi, cigarette au bec, la machine à écrire calée sur une chaise, mon père écrit, assis dans un caveau à charbon reconverti.
Une boîte de Players trône sur le dictionnaire, un réveil est visible sur la pile de livres sous la radio et une lampe est posée sur la chaufferette. Est-ce une bouteille de bière à moitié vide devant la radio dans le coin de la pièce? Est-ce qu'il écrit quelque chose pour la Gazette de Montréal? Je sais qu'il avait espéré se faire embaucher par la Gazette à une époque, mais que cela n'avait pas marché. Mais il a si bien le look de l'écrivain de cette époque (look que certains de ses contemporains ont conservé longtemps) que la photo suffit à exprimer son ambition. Photo qui, compte tenu de l'angle de la lampe qui éclaire non la page mais le visage, a dû être assez soigneusement posée...
Comme j'étais un peu indisposé, j'ai poursuivi sur ma lancée de la veille en exhumant quelques vieilles photos familiales de plus. Celle-ci peut faire pendant à celle que j'avais
 retrouvée précédemment. Après le fils, le père. Eh oui, il s'agit de mon père, installé à la machine à écrire, dans un sous-sol de Westmount (au 1019 Greene Avenue, à cinq minutes à pied de l'ancien Forum selon la carte... il faudra que j'aille faire un tour un de ces jours) le 28 juin 1950. Il faut savoir qu'à cette époque, l'écriture, que ce soit pour les journaux ou pour l'édition, avait un cachet qu'elle a un peu perdu...
retrouvée précédemment. Après le fils, le père. Eh oui, il s'agit de mon père, installé à la machine à écrire, dans un sous-sol de Westmount (au 1019 Greene Avenue, à cinq minutes à pied de l'ancien Forum selon la carte... il faudra que j'aille faire un tour un de ces jours) le 28 juin 1950. Il faut savoir qu'à cette époque, l'écriture, que ce soit pour les journaux ou pour l'édition, avait un cachet qu'elle a un peu perdu...Rappelez-vous que nous sommes encore à l'époque des pulps et des épais supplements dominicaux des journaux. Les écrivains peuvent encore circuler assez facilement entre la presse, la radio et même la télévision plus ou moins embryonnaire — et se faire payer pour ce qu'ils écrivent. Il y a quelque chose de plus artisanal et, disons-le, de plus normal à vouloir publier dans un contexte où cela peut devenir un métier, et même faire de vous une vedette susceptible de marier Marilyn Monroe. (J'anticipe un peu : Arthur Miller n'allait épouser Monroe qu'en 1956.)
Ainsi, cigarette au bec, la machine à écrire calée sur une chaise, mon père écrit, assis dans un caveau à charbon reconverti.
Une boîte de Players trône sur le dictionnaire, un réveil est visible sur la pile de livres sous la radio et une lampe est posée sur la chaufferette. Est-ce une bouteille de bière à moitié vide devant la radio dans le coin de la pièce? Est-ce qu'il écrit quelque chose pour la Gazette de Montréal? Je sais qu'il avait espéré se faire embaucher par la Gazette à une époque, mais que cela n'avait pas marché. Mais il a si bien le look de l'écrivain de cette époque (look que certains de ses contemporains ont conservé longtemps) que la photo suffit à exprimer son ambition. Photo qui, compte tenu de l'angle de la lampe qui éclaire non la page mais le visage, a dû être assez soigneusement posée...
Libellés : Famille, Photographie
Fragments d'histoire familiale (3)
L'histoire des familles est souvent un long fleuve tranquille que personne ne cherche à immortaliser. C'est ainsi que les jours et les années passent et trépassent jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se pencher sur le passé parce que tous les témoins sont trépassés...
J'ai déjà eu l'occasion de parler d'Edmond Trudel (1860-1933), dont la vie s'est partagée entre Ottawa et Saint-Boniface au Manitoba. Sa mère était Delphine Lafleur, que l'on peut voir dans le cliché que je reproduis ci-contre — et que l'on peut comparer à l'ambrotype reproduit précédemment : elle n'a pas l'air plus commode dans l'un que dans l'autre. Edmond avait épousé Marie-Adeline-Augustine Raby le 16 août 1887 à Saint-André-Avellin.
cliché que je reproduis ci-contre — et que l'on peut comparer à l'ambrotype reproduit précédemment : elle n'a pas l'air plus commode dans l'un que dans l'autre. Edmond avait épousé Marie-Adeline-Augustine Raby le 16 août 1887 à Saint-André-Avellin.
Sa sœur aînée, Marie-Scholastique-Cimodocée, née en février 1858, avait épousé Charles Beautron Major (1851-1924) le 29 février 1876 à Sainte-Scholastique. Après la mort de son mari, qui avait fait carrière dans la politique provinciale, elle se serait retirée chez les Sœurs Grises d'Ottawa, où elle se serait trouvée encore en 1944... Selon sa biographie, Major aurait été le promoteur et directeur du Northern Colonization Railway. Il s'agit sans doute du Montreal Northern Colonization Railway (MNCR) lancé en 1869, un an après l'arrivée du célèbre curé Labelle à Saint-Jérôme. Plus tard, l'entreprise devenait la Montreal, Ottawa and Western Railway Company avant d'être officiellement acquise en 1882 par le Quebec, Montreal, Ottawa &Occidental Railway. Toutefois, l'entité MNCR semble avoir conservé une existence légale, puisque le CPR achète d'elle en 1897 la ligne qui va de Saint-Jérôme à Labelle — celle qui devait devenir le « petit train du Nord » une fois prolongée jusqu'à Mont-Laurier au début du siècle dernier.
Alfred Trudel aurait été le premier agent du CPR à la station de Sainte-Scholastique. Ainsi, il aurait partagé avec son gendre des intérêts ferroviaires...
Par contre, je dois corriger ce que j'avais écrit précédemment. Edmond Trudel n'avait pas fait ses études au Collège de Saint-Boniface, mais au Collège de Montréal de 1873 à 1881. (À gauche, j'inclus une photo du jeune Edmond, prise en principe en 1880 quand il avait vingt ans.) Ainsi, il n'a pas pu connaître Georges Lemay au Collège de Saint-Boniface; par contre, comme il s'établit au Manitoba en juillet 1881, ayant abandonné le droit pour le journalisme, il a quand même passé quelques années sur place avant de recevoir en 1884 le livre de Georges Lemay et il est donc possible qu'ils se connaissaient. Il est alors rédacteur en chef du journal Le Manitoba depuis peu, car il occupera ce poste de 1884 à 1894. Autrement dit, il sera aux premières loges pour la rébellion de Riel en 1885 et sa condamnation, ainsi que pour le débat des écoles du Manitoba...
Collège de Saint-Boniface; par contre, comme il s'établit au Manitoba en juillet 1881, ayant abandonné le droit pour le journalisme, il a quand même passé quelques années sur place avant de recevoir en 1884 le livre de Georges Lemay et il est donc possible qu'ils se connaissaient. Il est alors rédacteur en chef du journal Le Manitoba depuis peu, car il occupera ce poste de 1884 à 1894. Autrement dit, il sera aux premières loges pour la rébellion de Riel en 1885 et sa condamnation, ainsi que pour le débat des écoles du Manitoba...
Sur la fin, il cumule ses fonctions éditoriales avec un emploi de maître de poste de Saint-Boniface de 1892 à 1895. C'est en décembre 1895 qu'il accepte un emploi au Bureau des Terres du Dominion, qui fait partie du département de l'Intérieur. Transféré à Régina en 1898, il est de nouveau transféré en 1905, quand il est affecté à Ottawa. Entre temps, il avait ramené sa femme dans l'Ouest et mon grand-père était né, premier enfant de la famille, en 1888 à Saint-Boniface.
Leur quatrième enfant et troisième garçon naît le 5 décembre 1893, peu après l'accession d'Edmond Trudel au rang de maître de poste. C'est peut-être ce qui vaut une attention spéciale au bébé de la part de l'archevêque Alexandre Antonin Taché (1823-1894). S'il a bien été baptisé par Monseigneur Taché ou s'il l'a eu comme parrain, Alexandre Antonin Trudel a dû être un des derniers. Six mois à peine après ce baptême, l'archevêque décédait le 22 juin 1894. Selon les notes que j'ai à son sujet, Alexandre Antonin Trudel va étudier chez les Frères du Sacré-Cœur à Ottawa, travailler en tant que commis de magasin puis se faire embaucher comme « rancher » à Battleford en Saskatchewan en 1910. En raison de son âge, j'ai du mal à le voir comme propriétaire ou gérant d'un ranch à cette date précoce. Cowboy, peut-être... En 1916, il s'enrôle dans l'armée canadienne et il est fait caporal. Cependant, les documents l'attestant ne sont pas disponibles en-ligne comme le sont ceux pour ses frères Jean-Joseph et Paul-Émile, pour qui j'ai les attestations de leur enrôlement.
au bébé de la part de l'archevêque Alexandre Antonin Taché (1823-1894). S'il a bien été baptisé par Monseigneur Taché ou s'il l'a eu comme parrain, Alexandre Antonin Trudel a dû être un des derniers. Six mois à peine après ce baptême, l'archevêque décédait le 22 juin 1894. Selon les notes que j'ai à son sujet, Alexandre Antonin Trudel va étudier chez les Frères du Sacré-Cœur à Ottawa, travailler en tant que commis de magasin puis se faire embaucher comme « rancher » à Battleford en Saskatchewan en 1910. En raison de son âge, j'ai du mal à le voir comme propriétaire ou gérant d'un ranch à cette date précoce. Cowboy, peut-être... En 1916, il s'enrôle dans l'armée canadienne et il est fait caporal. Cependant, les documents l'attestant ne sont pas disponibles en-ligne comme le sont ceux pour ses frères Jean-Joseph et Paul-Émile, pour qui j'ai les attestations de leur enrôlement.
Stationné à Valcartier jusqu'à la fin de la guerre, il devient ensuite épicier à Ottawa de 1919 à 1925, où il avait épousé Marie-Anita-Jeanne Joly le 21 mai 1918 à l'église Saint-Jean-Baptiste. Des enfants naissent, mais cela n'empêchera pas la famille de quitter la capitale. Elle s'établira ensuite à Windsor en 1926, puis à Détroit après 1932.
J'ai déjà eu l'occasion de parler d'Edmond Trudel (1860-1933), dont la vie s'est partagée entre Ottawa et Saint-Boniface au Manitoba. Sa mère était Delphine Lafleur, que l'on peut voir dans le
 cliché que je reproduis ci-contre — et que l'on peut comparer à l'ambrotype reproduit précédemment : elle n'a pas l'air plus commode dans l'un que dans l'autre. Edmond avait épousé Marie-Adeline-Augustine Raby le 16 août 1887 à Saint-André-Avellin.
cliché que je reproduis ci-contre — et que l'on peut comparer à l'ambrotype reproduit précédemment : elle n'a pas l'air plus commode dans l'un que dans l'autre. Edmond avait épousé Marie-Adeline-Augustine Raby le 16 août 1887 à Saint-André-Avellin.Sa sœur aînée, Marie-Scholastique-Cimodocée, née en février 1858, avait épousé Charles Beautron Major (1851-1924) le 29 février 1876 à Sainte-Scholastique. Après la mort de son mari, qui avait fait carrière dans la politique provinciale, elle se serait retirée chez les Sœurs Grises d'Ottawa, où elle se serait trouvée encore en 1944... Selon sa biographie, Major aurait été le promoteur et directeur du Northern Colonization Railway. Il s'agit sans doute du Montreal Northern Colonization Railway (MNCR) lancé en 1869, un an après l'arrivée du célèbre curé Labelle à Saint-Jérôme. Plus tard, l'entreprise devenait la Montreal, Ottawa and Western Railway Company avant d'être officiellement acquise en 1882 par le Quebec, Montreal, Ottawa &Occidental Railway. Toutefois, l'entité MNCR semble avoir conservé une existence légale, puisque le CPR achète d'elle en 1897 la ligne qui va de Saint-Jérôme à Labelle — celle qui devait devenir le « petit train du Nord » une fois prolongée jusqu'à Mont-Laurier au début du siècle dernier.
Alfred Trudel aurait été le premier agent du CPR à la station de Sainte-Scholastique. Ainsi, il aurait partagé avec son gendre des intérêts ferroviaires...
Par contre, je dois corriger ce que j'avais écrit précédemment. Edmond Trudel n'avait pas fait ses études au Collège de Saint-Boniface, mais au Collège de Montréal de 1873 à 1881. (À gauche, j'inclus une photo du jeune Edmond, prise en principe en 1880 quand il avait vingt ans.) Ainsi, il n'a pas pu connaître Georges Lemay au
 Collège de Saint-Boniface; par contre, comme il s'établit au Manitoba en juillet 1881, ayant abandonné le droit pour le journalisme, il a quand même passé quelques années sur place avant de recevoir en 1884 le livre de Georges Lemay et il est donc possible qu'ils se connaissaient. Il est alors rédacteur en chef du journal Le Manitoba depuis peu, car il occupera ce poste de 1884 à 1894. Autrement dit, il sera aux premières loges pour la rébellion de Riel en 1885 et sa condamnation, ainsi que pour le débat des écoles du Manitoba...
Collège de Saint-Boniface; par contre, comme il s'établit au Manitoba en juillet 1881, ayant abandonné le droit pour le journalisme, il a quand même passé quelques années sur place avant de recevoir en 1884 le livre de Georges Lemay et il est donc possible qu'ils se connaissaient. Il est alors rédacteur en chef du journal Le Manitoba depuis peu, car il occupera ce poste de 1884 à 1894. Autrement dit, il sera aux premières loges pour la rébellion de Riel en 1885 et sa condamnation, ainsi que pour le débat des écoles du Manitoba...Sur la fin, il cumule ses fonctions éditoriales avec un emploi de maître de poste de Saint-Boniface de 1892 à 1895. C'est en décembre 1895 qu'il accepte un emploi au Bureau des Terres du Dominion, qui fait partie du département de l'Intérieur. Transféré à Régina en 1898, il est de nouveau transféré en 1905, quand il est affecté à Ottawa. Entre temps, il avait ramené sa femme dans l'Ouest et mon grand-père était né, premier enfant de la famille, en 1888 à Saint-Boniface.
Leur quatrième enfant et troisième garçon naît le 5 décembre 1893, peu après l'accession d'Edmond Trudel au rang de maître de poste. C'est peut-être ce qui vaut une attention spéciale
 au bébé de la part de l'archevêque Alexandre Antonin Taché (1823-1894). S'il a bien été baptisé par Monseigneur Taché ou s'il l'a eu comme parrain, Alexandre Antonin Trudel a dû être un des derniers. Six mois à peine après ce baptême, l'archevêque décédait le 22 juin 1894. Selon les notes que j'ai à son sujet, Alexandre Antonin Trudel va étudier chez les Frères du Sacré-Cœur à Ottawa, travailler en tant que commis de magasin puis se faire embaucher comme « rancher » à Battleford en Saskatchewan en 1910. En raison de son âge, j'ai du mal à le voir comme propriétaire ou gérant d'un ranch à cette date précoce. Cowboy, peut-être... En 1916, il s'enrôle dans l'armée canadienne et il est fait caporal. Cependant, les documents l'attestant ne sont pas disponibles en-ligne comme le sont ceux pour ses frères Jean-Joseph et Paul-Émile, pour qui j'ai les attestations de leur enrôlement.
au bébé de la part de l'archevêque Alexandre Antonin Taché (1823-1894). S'il a bien été baptisé par Monseigneur Taché ou s'il l'a eu comme parrain, Alexandre Antonin Trudel a dû être un des derniers. Six mois à peine après ce baptême, l'archevêque décédait le 22 juin 1894. Selon les notes que j'ai à son sujet, Alexandre Antonin Trudel va étudier chez les Frères du Sacré-Cœur à Ottawa, travailler en tant que commis de magasin puis se faire embaucher comme « rancher » à Battleford en Saskatchewan en 1910. En raison de son âge, j'ai du mal à le voir comme propriétaire ou gérant d'un ranch à cette date précoce. Cowboy, peut-être... En 1916, il s'enrôle dans l'armée canadienne et il est fait caporal. Cependant, les documents l'attestant ne sont pas disponibles en-ligne comme le sont ceux pour ses frères Jean-Joseph et Paul-Émile, pour qui j'ai les attestations de leur enrôlement.Stationné à Valcartier jusqu'à la fin de la guerre, il devient ensuite épicier à Ottawa de 1919 à 1925, où il avait épousé Marie-Anita-Jeanne Joly le 21 mai 1918 à l'église Saint-Jean-Baptiste. Des enfants naissent, mais cela n'empêchera pas la famille de quitter la capitale. Elle s'établira ensuite à Windsor en 1926, puis à Détroit après 1932.
2006-03-14
Création collective
Depuis une dizaine d'années, le congrès Boréal est devenu une sorte de création collective. Cela remonte essentiellement, je crois, au congrès de 1995 (Boréal 12) quand j'avais envoyé aux participants potentiels une lettre-circulaire qui comportait une liste de sujets envisagés pour des tables rondes. Les personnes sollicitées devaient indiquer leur intérêt pour la participation à une table ronde en cochant la case correspondant à un chiffre allant de 1 à 3. Si elles désiraient animer les discussions, elles pouvaient cocher la case à cet effet.
Je m'étais sans doute inspiré du sondage semblable mis en œuvre par le responsable de la programmation du congrès Readercon. (Cette année, cet excellent congrès de sf littéraire a comme invité d'honneur Jorge Luis Borges... à titre posthume, évidemment. Mais je me souviens qu'au congrès Boréal à Chicoutimi en 1988, Luc Pomerleau était entré en transe pour permettre à Jules Verne, ou peut-être Hugo Gernsback, d'intervenir lors d'une table ronde.)
Mais revenons à la programmation des congrès Boréal. Le processus s'est corsé les années suivantes lorsque Claude Mercier ou moi-même avons commencé à solliciter des idées par internet avant de les soumettre aux Boréaliens. Depuis que Christian Sauvé est devenu le grand vizir de la programmation, tout se passe sur internet et il est maintenant possible de soumettre des idées, de donner son avis sur ces idées en tant que spectateur et aussi de se porter volontaire pour telle ou telle table ronde ou activité. Pour le faire en vue du congrès 2006, il suffit de cliquer ici. Dépêchez-vous : il ne vous reste que quelques jours pour répondre !
Je m'étais sans doute inspiré du sondage semblable mis en œuvre par le responsable de la programmation du congrès Readercon. (Cette année, cet excellent congrès de sf littéraire a comme invité d'honneur Jorge Luis Borges... à titre posthume, évidemment. Mais je me souviens qu'au congrès Boréal à Chicoutimi en 1988, Luc Pomerleau était entré en transe pour permettre à Jules Verne, ou peut-être Hugo Gernsback, d'intervenir lors d'une table ronde.)
Mais revenons à la programmation des congrès Boréal. Le processus s'est corsé les années suivantes lorsque Claude Mercier ou moi-même avons commencé à solliciter des idées par internet avant de les soumettre aux Boréaliens. Depuis que Christian Sauvé est devenu le grand vizir de la programmation, tout se passe sur internet et il est maintenant possible de soumettre des idées, de donner son avis sur ces idées en tant que spectateur et aussi de se porter volontaire pour telle ou telle table ronde ou activité. Pour le faire en vue du congrès 2006, il suffit de cliquer ici. Dépêchez-vous : il ne vous reste que quelques jours pour répondre !
Libellés : Boréal
2006-03-13
Retour au bercail
La dernière journée d'un salon du livre est toujours un peu triste. Le dimanche, que l'on soit à Gatineau ou à Montréal, le Salon existe dans une bulle particulièrement distincte du reste de la ville qui tourne au ralenti parce que les bureaux et de nombreux commerces sont fermés. Les auteurs sur place et les visiteurs, pour la plupart, doivent retourner au travail le lendemain. Pas question, donc, d'organiser un ultime gueuleton avec des amis. En soirée, si soirée il y a, il ne restera plus que les happy few.
Mais comme le Salon du Livre de l'Outaouais prend fin le dimanche, tout s'arrête l'après-midi.
Un peu avant 17h, dimanche, on entendait déjà les bruits des boîtes que l'on rouvre, que l'on remplit, ou que l'on scelle à grand renfort de papier collant. Les allées se vidaient, tout le monde repartait et plus personne ne surveillait l'entrée du salon. Les bénévoles et les employés étaient conscrits à d'autres tâches. Les auteurs s'éclipsaient pour se retrouver dans le lobby ou le stationnement de l'hôtel Sheraton de la rue Laurier, en attendant d'être rejoints par les autres professionnels, afin de profiter de la navette qui ramènerait les uns et les autres à Montréal. J'y ai croisé Bryan Perro qui, lui, repartait en voiture pour la Mauricie.
Mais si Bouquinville était retourné à la virtualité, j'y étais encore dans ma tête. L'avantage d'un salon du livre, c'est parfois de pouvoir se rebrancher sur l'évanescente vie littéraire du Canada francophone. Il ne faut pas se cacher que la solitude de l'écrivain de métier est souvent aggravée par l'impression tenace d'être seul de son espèce; un Salon du Livre rappelle qu'il existe bel et bien une communauté du livre, qui a une existence concrète qui n'est pas seulement faite des chicanes répercutées dans les émissions dites culturelles et des billets assassins de telle ou telle grande gueule.
Il m'est déjà arrivé d'écrire dans la navette qui rentre à Montréal, mais cette fois j'avais écrit mon content durant les jours précédents. De retour chez moi, il ne me reste plus qu'à mettre au propre les brouillons pondus dans le café du Salon — ou durant la séance de signatures du jeudi. Le prochain salon, ce sera donc l'occasion de revenir à Bouquinville — ou d'écrire la suite.
Mais comme le Salon du Livre de l'Outaouais prend fin le dimanche, tout s'arrête l'après-midi.
Un peu avant 17h, dimanche, on entendait déjà les bruits des boîtes que l'on rouvre, que l'on remplit, ou que l'on scelle à grand renfort de papier collant. Les allées se vidaient, tout le monde repartait et plus personne ne surveillait l'entrée du salon. Les bénévoles et les employés étaient conscrits à d'autres tâches. Les auteurs s'éclipsaient pour se retrouver dans le lobby ou le stationnement de l'hôtel Sheraton de la rue Laurier, en attendant d'être rejoints par les autres professionnels, afin de profiter de la navette qui ramènerait les uns et les autres à Montréal. J'y ai croisé Bryan Perro qui, lui, repartait en voiture pour la Mauricie.
Mais si Bouquinville était retourné à la virtualité, j'y étais encore dans ma tête. L'avantage d'un salon du livre, c'est parfois de pouvoir se rebrancher sur l'évanescente vie littéraire du Canada francophone. Il ne faut pas se cacher que la solitude de l'écrivain de métier est souvent aggravée par l'impression tenace d'être seul de son espèce; un Salon du Livre rappelle qu'il existe bel et bien une communauté du livre, qui a une existence concrète qui n'est pas seulement faite des chicanes répercutées dans les émissions dites culturelles et des billets assassins de telle ou telle grande gueule.
Il m'est déjà arrivé d'écrire dans la navette qui rentre à Montréal, mais cette fois j'avais écrit mon content durant les jours précédents. De retour chez moi, il ne me reste plus qu'à mettre au propre les brouillons pondus dans le café du Salon — ou durant la séance de signatures du jeudi. Le prochain salon, ce sera donc l'occasion de revenir à Bouquinville — ou d'écrire la suite.
Libellés : Salon du livre, Vie
2006-03-12
D'un salon l'autre
Du salon de Grimmwire au salon de Bryan Perro (c'est-à-dire le Salon du Livre de l'Outaouais 2006), ce fut un samedi placé sous le signe du voyage. De Montréal à Gatineau à Ottawa, en passant par plusieurs lieux dans chaque ville en moins de vingt-quatre heures. Il n'est pas mauvais de rappeler qu'une telle journée serait impensable sans les techniques modernes. Et qu'elle pourrait devenir impensable si la hausse du coût du pétrole nous forçait à économiser nos déplacements. Cette semaine, j'aurai fait deux fois l'aller-retour entre Montréal et Ottawa-Gatineau, sans compter les déplacements mineurs...
Le Salon m'a semblé assez tranquille pour un samedi après-midi, mais je commets sans doute l'erreur de le comparer subconsciemment aux Salons de Montréal et de Paris. (Il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître quand le Salon du Livre de l'Outaouais était pour moi ce haut-lieu de la littérature où j'interviewais John Saul ou Sylvain Trudel pour La Rotonde. Depuis, il a un peu rétréci au lavage des ans.) Il aurait fallu que j'en parle à Serena Gentilhomme, notre visiteuse italo-bisontine... Aussi présents sur les lieux de nos multiples forfaits littéraires : Claude Bolduc, Vittorio Frigerio, Michèle Laframboise, Pierre-Luc Lafrance, Alexandre Lemieux, Christian Sauvé, Guy Sirois... et de nombreux autres intervenants du monde littéraire.
Laurent McAllister s'est prêté à une entrevue de très haute tenue conduite par Alexandre Lemieux, qui sera baladodiffusée un de ces jours. On aimerait que certains journalistes fassent preuve du même souci de bien préparer ce genre de rencontre... Et Laurent s'est aussi prêté à une entrevue avec Christian Sauvé qui n'était pas sérieuse du tout. Mais pour faire plaisir à Fractale Framboise, McAllister s'est empressé d'écrire une scène — mettant en vedette une framboise fractale, naturellement — qui se retrouvera peut-être dans le prochain roman jeunesse de McAllister si celui-ci juge suffisants les encouragements sonnants et trébuchants à le faire...
Pour terminer, une réunion de quelques anciens de Lyngarde dans un bon petit restau chinois de la rue Somerset ainsi qu'un café du Marché By a permis de faire le point sur les projets d'écriture des uns et des autres. Beaucoup d'idées, plusieurs espoirs, quelques succès.
Ainsi va la vie des écrivains.
Le Salon m'a semblé assez tranquille pour un samedi après-midi, mais je commets sans doute l'erreur de le comparer subconsciemment aux Salons de Montréal et de Paris. (Il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître quand le Salon du Livre de l'Outaouais était pour moi ce haut-lieu de la littérature où j'interviewais John Saul ou Sylvain Trudel pour La Rotonde. Depuis, il a un peu rétréci au lavage des ans.) Il aurait fallu que j'en parle à Serena Gentilhomme, notre visiteuse italo-bisontine... Aussi présents sur les lieux de nos multiples forfaits littéraires : Claude Bolduc, Vittorio Frigerio, Michèle Laframboise, Pierre-Luc Lafrance, Alexandre Lemieux, Christian Sauvé, Guy Sirois... et de nombreux autres intervenants du monde littéraire.
Laurent McAllister s'est prêté à une entrevue de très haute tenue conduite par Alexandre Lemieux, qui sera baladodiffusée un de ces jours. On aimerait que certains journalistes fassent preuve du même souci de bien préparer ce genre de rencontre... Et Laurent s'est aussi prêté à une entrevue avec Christian Sauvé qui n'était pas sérieuse du tout. Mais pour faire plaisir à Fractale Framboise, McAllister s'est empressé d'écrire une scène — mettant en vedette une framboise fractale, naturellement — qui se retrouvera peut-être dans le prochain roman jeunesse de McAllister si celui-ci juge suffisants les encouragements sonnants et trébuchants à le faire...
Pour terminer, une réunion de quelques anciens de Lyngarde dans un bon petit restau chinois de la rue Somerset ainsi qu'un café du Marché By a permis de faire le point sur les projets d'écriture des uns et des autres. Beaucoup d'idées, plusieurs espoirs, quelques succès.
Ainsi va la vie des écrivains.
Libellés : Salon du livre, Vie
2006-03-11
Moment d'existence
L'objet d'un party, c'est de ne pas en avoir. La nuit dernière, Grimmwire célébrait son anniversaire et il avait invité ses amis en utilisant Evite. Ainsi, il y avait là A. J., Kino Kid, Yves, Claude et Elise, Emru, Jo et Sasha... Même si j'ai un peu parlé de Boréal, c'était surtout le moment de goûter du vin (j'avais apporté du vin garanti bio et un ami de Grimmwire avait apporté un cru suisse), d'écouter les copains toujours intéressants du héros de la fête, de dire des bêtises, d'admirer les trois écrans affichant des animations abstraites au fond de la pièce plongée dans la pénombre... Rien de mémorable n'a été dit. C'est mieux ainsi.
Après tout, je fêtais un peu aussi pour ma paroisse, si je puis dire. Avais-je déjà imaginé très particulièrement le moment de la remise de mon doctorat? Non, et je n'avais pas vraiment essayé. À défaut, j'imaginais une cérémonie officielle, comme à Convocation Hall à l'Université de Toronto. Mais quand je suis revenu d'Ottawa la nuit dernière, j'ai trouvé une note sur ma porte. Les concierges avaient gardé un paquet pour moi. Quand je me suis présenté le matin venu, ils m'ont dit que le commissionnaire avait tenté de laisser cette grande enveloppe rigide devant ma porte. Brillante idée : mon diplôme aurait passé la nuit et le reste de la journée dans un corridor fréquenté. Il aurait pu se faire ramasser ou piétiner... Mais je l'ai reçu en fin de compte des mains de ma concierge. Petite ironie de la vie... mais mon bonheur était inentamable hier.
Il y a des moments de notre existence qu'il faut savoir vivre sans songer à ce qui lui manque.
Après tout, je fêtais un peu aussi pour ma paroisse, si je puis dire. Avais-je déjà imaginé très particulièrement le moment de la remise de mon doctorat? Non, et je n'avais pas vraiment essayé. À défaut, j'imaginais une cérémonie officielle, comme à Convocation Hall à l'Université de Toronto. Mais quand je suis revenu d'Ottawa la nuit dernière, j'ai trouvé une note sur ma porte. Les concierges avaient gardé un paquet pour moi. Quand je me suis présenté le matin venu, ils m'ont dit que le commissionnaire avait tenté de laisser cette grande enveloppe rigide devant ma porte. Brillante idée : mon diplôme aurait passé la nuit et le reste de la journée dans un corridor fréquenté. Il aurait pu se faire ramasser ou piétiner... Mais je l'ai reçu en fin de compte des mains de ma concierge. Petite ironie de la vie... mais mon bonheur était inentamable hier.
Il y a des moments de notre existence qu'il faut savoir vivre sans songer à ce qui lui manque.
Libellés : Université, Vie
2006-03-10
Un Salon verglacé
Verglas à Ottawa, hier : Le plus dur en sortant de chez soi, c'était les six ou sept premiers mètres sous une pluie battante, sur l'ancienne glace, sur la neige croûtée de glace plus ou moins neuve et sur le verglas en formation à même l'asphalte — toutes ces surfaces s'avérant excessivement glissantes une fois détrempées. (Si les Inuit n'ont pas autant de mots pour désigner la glace et la neige qu'on l'a prétendu, il n'est pas douteux qu'ils pourraient fort bien en avoir besoin...) Une fois dans la rue, j'ai pu atteindre l'arrêt d'autobus sans encombre et me rendre au Salon du Livre de l'Outaouais sans avoir à parcourir un autre mètre sur des trottoirs glacés ou sous l'averse.
Bien au chaud dans le Palais des Congrès, le Salon du Livre a pourtant été frappé par le verglas. Selon la rumeur, des annulations de sorties scolaires par les conseils idoines expliqueraient l'absence des hordes habituelles de jeunes collectionneurs de numéros d'Archie et de marque-pages dédicacés par les auteurs présents. Mes deux heures de présence au Salon en après-midi ont donc été des plus tranquilles et j'ai pu réfléchir à de nouvelles horreurs pour le quatrième roman jeunesse de Laurent McAllister. En revanche, j'ai revu les copains et les collègues. Pour la plupart, il s'agissait des gens de la région : Claude Bolduc, Colette Michaud, Christ Oliver, Jean-François Somain, Monique Bertoli, sans parler de ceux que j'ai simplement salués de loin ou au passage. Mais j'ai aussi fait escale au stand d'Alire, toujours animé par la dynamique Louise Alain, acheté le premier roman jeunesse de Michel J. Lévesque, Samuel de la chasse-galerie (Médiaspaul), et parlé un peu affaires çà et là.
La grande visite, ce sera pour la fin de semaine, paraît-il.
Bien au chaud dans le Palais des Congrès, le Salon du Livre a pourtant été frappé par le verglas. Selon la rumeur, des annulations de sorties scolaires par les conseils idoines expliqueraient l'absence des hordes habituelles de jeunes collectionneurs de numéros d'Archie et de marque-pages dédicacés par les auteurs présents. Mes deux heures de présence au Salon en après-midi ont donc été des plus tranquilles et j'ai pu réfléchir à de nouvelles horreurs pour le quatrième roman jeunesse de Laurent McAllister. En revanche, j'ai revu les copains et les collègues. Pour la plupart, il s'agissait des gens de la région : Claude Bolduc, Colette Michaud, Christ Oliver, Jean-François Somain, Monique Bertoli, sans parler de ceux que j'ai simplement salués de loin ou au passage. Mais j'ai aussi fait escale au stand d'Alire, toujours animé par la dynamique Louise Alain, acheté le premier roman jeunesse de Michel J. Lévesque, Samuel de la chasse-galerie (Médiaspaul), et parlé un peu affaires çà et là.
La grande visite, ce sera pour la fin de semaine, paraît-il.
Libellés : Ottawa, Salon du livre
2006-03-09
Iconographie de la SFCF (6)
Commençons par un rappel des livraisons précédentes : (1) l'iconographie de Surréal 3000; (2) l'iconographie du merveilleux pour les jeunes; (3) le motif de la soucoupe; (4) les couvertures de sf d'avant la constitution du milieu de la «SFQ»; et (5) les aventures de Volpek.
Pour un certain nombre de connaisseurs de la SFCF, l'époque moderne de la science-fiction commence en 1974 au Canada francophone. L'argument principal concerne moins la présence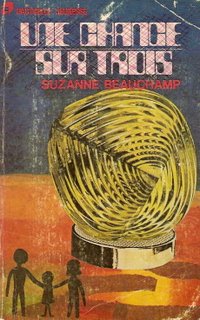 de nouveaux ouvrages ou une accélération du nombre de parutions, mais la fondation du fanzine Requiem qui allait devenir une pépinière de talents et un carrefour incontournable avant de changer de peau et de devenir la revue Solaris. C'est la thèse des institutions structurantes, disons, même si ce critère fait de 1979 une année encore plus importante puisque c'est alors le lancement d'imagine..., l'acte de naissance de Solaris, le premier congrès Boréal et le départ de l'expérience PTBGDA. En revanche, le critère des publications idoines ne fait pas de 1974 un moment unique. Après tout, j'ai déjà souligné l'existence de nombreux ouvrages antérieurs à 1974, et même à 1960 (date retenue de préférence par les universitaires qui veulent faire le lien entre la modernité de la science-fiction et la modernité du Québec qui abordait la Révolution tranquille). Mais si 1974 n'est pas l'année d'une percée sans précédente, c'est quand même une année particulièrement féconde en publications relevant de la science-fiction ou du fantastique. Une quinzaine d'ouvrages — romans ou recueils ou romans pour jeunes — sont édités en 1974 dans ces genres et offerts à la vente.
de nouveaux ouvrages ou une accélération du nombre de parutions, mais la fondation du fanzine Requiem qui allait devenir une pépinière de talents et un carrefour incontournable avant de changer de peau et de devenir la revue Solaris. C'est la thèse des institutions structurantes, disons, même si ce critère fait de 1979 une année encore plus importante puisque c'est alors le lancement d'imagine..., l'acte de naissance de Solaris, le premier congrès Boréal et le départ de l'expérience PTBGDA. En revanche, le critère des publications idoines ne fait pas de 1974 un moment unique. Après tout, j'ai déjà souligné l'existence de nombreux ouvrages antérieurs à 1974, et même à 1960 (date retenue de préférence par les universitaires qui veulent faire le lien entre la modernité de la science-fiction et la modernité du Québec qui abordait la Révolution tranquille). Mais si 1974 n'est pas l'année d'une percée sans précédente, c'est quand même une année particulièrement féconde en publications relevant de la science-fiction ou du fantastique. Une quinzaine d'ouvrages — romans ou recueils ou romans pour jeunes — sont édités en 1974 dans ces genres et offerts à la vente.
Ainsi, dans la collection L'Actuelle/Jeunesse, la jeune Suzanne Beauchamp, qui fréquente l'école secondaire Saint-Luc, signe à l'âge de seize ans un roman pour jeunes intitulé Une chance sur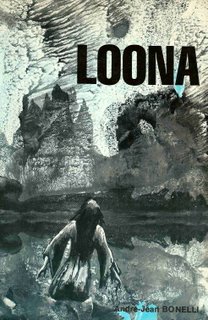 trois. On peut voir ci-dessus la couverture très abîmée de mon exemplaire de ce livre. Loin des audaces de Charles Montpetit, Beauchamp imagine une histoire d'amour entre une jeune Montréalaise et un jeune garçon de son âge qui est originaire, en fin de compte, d'une autre planète. L'illustration est de Célyne Fortin. Le nombre de récits de science-fiction parus dans cette collection est très révélateur de l'intérêt des jeunes de l'époque pour ce genre puisque cette collection publiait avant tout des textes rédigés par de jeunes auteurs.
trois. On peut voir ci-dessus la couverture très abîmée de mon exemplaire de ce livre. Loin des audaces de Charles Montpetit, Beauchamp imagine une histoire d'amour entre une jeune Montréalaise et un jeune garçon de son âge qui est originaire, en fin de compte, d'une autre planète. L'illustration est de Célyne Fortin. Le nombre de récits de science-fiction parus dans cette collection est très révélateur de l'intérêt des jeunes de l'époque pour ce genre puisque cette collection publiait avant tout des textes rédigés par de jeunes auteurs.
Dans un genre beaucoup plus adulte, le roman Loona ou Autrefois le ciel était bleu d'André-Jean Bonelli a malgré tout une certaine importance historique, si ce n'est qu'en raison de son rattachement à une collection intitulée « Demain aujourd'hui », qui est sûrement une des plus anciennes tentatives de fonder une collection de sf au Québec. L'inclusion d'un autre titre dans la même collection, Yann ou La condition inhumaine, était promise, tandis que Les clés de la cinquième dimension et Les Hybrides devaient paraître dans la collection « Les portes de l'impossible ». Comme Bonelli est né à Marseille et a longtemps vécu en Ardèche, où il était maire d'un petit village en 1974, son rapport avec le Québec n'est pas clair. La maison d'édition de Loona, Helios, était basée à Kénogami et disposait d'une boîte postale à Jonquière. Le directeur, Gaétan Thibeault, porte un nom qui se retrouve dans la région (c'est celui d'un spécialiste de l'éthique et de la bioéthique à l'UQAC à une époque), mais l'illustrateur, Alain Bonnand, est sans doute celui qui exposait au Musée de l'Érotisme de Paris en 2001, car certains dessins du livre se rapprochent du sado-masochisme. Loona a été réimprimé en France en 1977; il semble donc que Bonelli n'ait publié ce roman au Québec que par hasard.
Par contre, on ne mettra pas en doute la québécitude de Jean Côté, auteur du roman Échec au président. Les Éditions Point de Mire sont basées à Repentigny et annoncent, entre autres parutions, un Dictionnaire des expressions québécoises. On peut espérer que Jean Côté n'en était pas l'auteur, à en juger par les qualités douteuses d'Échec au président... Dans cette histoire qui défie la compréhension, la prose est inimitablement mauvaise. Qu'on en juge par le début du résumé en quatrième de couverture : « Il était devenu un amalgame de puissance surhumaine, quelque chose comme une bombe H sur deux pattes ou un Hercule renaissant de la mythologie. » Soupir... L'identité de l'illustrateur n'est pas fournie.
parutions, un Dictionnaire des expressions québécoises. On peut espérer que Jean Côté n'en était pas l'auteur, à en juger par les qualités douteuses d'Échec au président... Dans cette histoire qui défie la compréhension, la prose est inimitablement mauvaise. Qu'on en juge par le début du résumé en quatrième de couverture : « Il était devenu un amalgame de puissance surhumaine, quelque chose comme une bombe H sur deux pattes ou un Hercule renaissant de la mythologie. » Soupir... L'identité de l'illustrateur n'est pas fournie.
On peut se consoler en songeant ici à des livres de 1974 dont je n'inclus pas la couverture (faute d'avoir une édition originale sous la main). Par exemple, Jacques Brossard, mieux connu ultérieurement pour L'Oiseau de feu, réunit en cette même année un recueil composée de nouvelles des plus agréables, Le Métamorfaux (Hurtubise HMH). Également de bonne facture, le recueil Contes pour hydrocéphales adultes (CLF) de Claudette Charbonneau-Tissot offre de très bons textes.
L'ouvrage le plus singulier de 1974 est sans conteste Reliefs de l'arsenal de Roger Des Roches. Le jeune auteur et poète avait alors 24 ans et il offrait un livre monté comme certains manga. Ce qui est normalement la couverture présentait une simple illustration — une photo de Lois Siegel selon le péritexte, rendue troublante par l'absence de nez — tandis que le quatrième de couverture fournissait le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et la catégorie dans laquelle tombait l'œuvre : «Récit».
Ce qui est normalement la couverture présentait une simple illustration — une photo de Lois Siegel selon le péritexte, rendue troublante par l'absence de nez — tandis que le quatrième de couverture fournissait le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et la catégorie dans laquelle tombait l'œuvre : «Récit».
La présentation du livre précise (et avertit) : « Il devient aisé (à la lecture) de comprendre que ce texte n'est plus une narration linéaire, uniforme, monothématique, sa structure étant ce qu'elle est, et, non plus, une "prose poétique", terme qu'on voudrait et qu'on a utilisé à toutes les sauces. Une recherche calculée, pensée et préparée depuis un certain temps, de quelques aspects du récit, et plus précisément celui de "science-fiction" dont elle emprunte quelques-uns de ses aspects les plus usuels.» De fait, longtemps avant Dans une galaxie près de chez vous, Des Roches déconstruit une certaine science-fiction. Si je choisis un passage parmi les plus cohérents et lisibles (car, franchement, le reste du texte...), cela peut donner ceci : « Pendant que je discute, ferme, avec sa jeune fille, le vent porte les dernières paroles de notre héroïque commandant prenant possession, au nom de la Fédération, de la planète que les indigènes désignent par Seycherrahz'zium ("Petit Couple de Dieux Forniquant au Lever") (nom auquel il préférera évidemment le sien, comme c'est coutume, c'est-à-dire Lapointe, ce qui fera, dans les registres, plus plausible et surtout plus facile à prononcer. »
Avec Contes ardents du pays mauve de Jean Ferguson, on retombe de plusieurs crans dans le poncif. Recueil de huit nouvelles, l'ouvrage est doté d'un titre qui pique la curiosité et d'une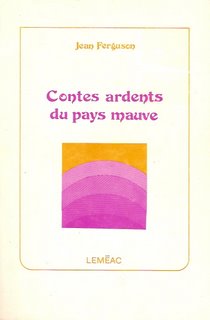 maquette d'une sobriété respectable (mais qui n'est pas créditée). Les choses se gâtent quand on se met à lire... Loin de la déconstruction littéraire de la science-fiction pratiquée par Roger Des Roches, Ferguson est plutôt de ceux pour qui la science-fiction est voisine de l'ufologie. Autrement dit, il était de son temps et ses textes de science-fiction ne transcendent nullement les clichés de son époque. Les personnages portent des numéros dans « Le petit numéro deux mille quarante », des primitifs vivent dans un monde post-apocalyptique dans « Ker, le tueur de dieu » (avec une de ces chutes à saveur biblique qui semblait le comble de l'audace à l'époque), une société future se penche sur les vestiges du vingtième siècle et juge inconcevables les bizarreries de ces sociétés disparues... Comme la langue est souvent quelconque, il n'y a franchement pas grand-chose pour racheter l'ensemble.
maquette d'une sobriété respectable (mais qui n'est pas créditée). Les choses se gâtent quand on se met à lire... Loin de la déconstruction littéraire de la science-fiction pratiquée par Roger Des Roches, Ferguson est plutôt de ceux pour qui la science-fiction est voisine de l'ufologie. Autrement dit, il était de son temps et ses textes de science-fiction ne transcendent nullement les clichés de son époque. Les personnages portent des numéros dans « Le petit numéro deux mille quarante », des primitifs vivent dans un monde post-apocalyptique dans « Ker, le tueur de dieu » (avec une de ces chutes à saveur biblique qui semblait le comble de l'audace à l'époque), une société future se penche sur les vestiges du vingtième siècle et juge inconcevables les bizarreries de ces sociétés disparues... Comme la langue est souvent quelconque, il n'y a franchement pas grand-chose pour racheter l'ensemble.
On se demande alors si ces interférences de la science-fiction, de ses lieux communs et de certaines croyances mutantes (aux OVNIs, par exemple) peuvent expliquer la défaveur graduelle que la sf a connu depuis 1974. La science-fiction repose sur les mêmes principes qui sous-tendent les lieux communs les plus éculés et les croyances les plus loufoques : distanciation, conjecture, expérience de pensée conjuguant conjecture et déduction... Pour certains, ces choses ont un caractère difficilement séparable, qu'il s'agisse des critiques observant le phénomène de l'extérieur ou de certains des artisans eux-mêmes œuvrant à l'intérieur du genre. Dans le monde francophone, il me semble que la confusion a été entretenue avec beaucoup plus d'insistance qu'ailleurs, la faute à des sous-produits de la pensée comme la revue Planète ou Le Matin des magiciens. Ce qui donne encore aujourd'hui une certaine coloration à la science-fiction francophone qui accueille, dans le meilleur des cas, des auteurs comme Maurice Dantec ou Éric Vincent ou qui doit admettre, dans le pire des cas, des scories ésotérico-illuminées comme celles d'un certain nombre d'auteurs québécois souvent édités à leurs frais...
Heureusement, le niveau est un peu relevé en 1974 par la science-fiction pour jeunes. Le titre phare est sans doute Titralak, cadet de l'espace (Éditions Héritage), de Suzanne Martel. La couverture de Bernard Beaudry aurait pu être rattachée à mon exploration du thème de la soucoupe (voir ci-dessus), mais elle n'en vaut franchement pas la peine. Le dessin est assez maladroit, en particulier en ce qui concerne le personnage au premier plan (qui peut rappeler un jeune Luc Pomerleau...). Le roman est bien meilleur. Certes, Martel recourt à certaines des stratégies employées par Ferguson pour mettre en scène le choc des perspectives, mais ce qui est difficilement supportable dans un recueil destiné à des lecteurs adultes passe beaucoup mieux dans un ouvrage pour les jeunes. De plus, Martel fait montre d'une habileté certaine en mêlant la réalité d'un visiteur extraterrestre à un jeu imaginé par des enfants qui s'amusent à faire semblant qu'ils sont... des explorateurs spatiaux. Le pauvre Titralak, cadet naufragé sur Terre, est abusé par leurs prétentions innocentes et c'est le point de départ d'aventures relativement bien informées du point de vue scientifique. (Martel s'était renseignée auprès de chercheurs de l'École Polytechnique. Et ce qu'elle décrit du moteur nucléaire de l'engin de Titralak correspond effectivement à certaines conceptions très sérieuses dans le domaine.)
Beaudry aurait pu être rattachée à mon exploration du thème de la soucoupe (voir ci-dessus), mais elle n'en vaut franchement pas la peine. Le dessin est assez maladroit, en particulier en ce qui concerne le personnage au premier plan (qui peut rappeler un jeune Luc Pomerleau...). Le roman est bien meilleur. Certes, Martel recourt à certaines des stratégies employées par Ferguson pour mettre en scène le choc des perspectives, mais ce qui est difficilement supportable dans un recueil destiné à des lecteurs adultes passe beaucoup mieux dans un ouvrage pour les jeunes. De plus, Martel fait montre d'une habileté certaine en mêlant la réalité d'un visiteur extraterrestre à un jeu imaginé par des enfants qui s'amusent à faire semblant qu'ils sont... des explorateurs spatiaux. Le pauvre Titralak, cadet naufragé sur Terre, est abusé par leurs prétentions innocentes et c'est le point de départ d'aventures relativement bien informées du point de vue scientifique. (Martel s'était renseignée auprès de chercheurs de l'École Polytechnique. Et ce qu'elle décrit du moteur nucléaire de l'engin de Titralak correspond effectivement à certaines conceptions très sérieuses dans le domaine.)
Parmi les romans pour jeunes, il faut aussi noter L'Héritage de Bhor (Paulines, collection « Jeunesse-Pop ») de Jean-Pierre Charland, Révolte secrète (Paulines, collection « Jeunesse-Pop ») de Louis Sutal (Normand Côté de son vrai nom) et Les farfelus du cosmos (Paulines, collection « Jeunesse-Pop ») de Herménégilde Laflamme. Dans ce dernier roman, des OVNIs visitent Solaris (!), une petite ville apparemment située dans la région du Saguenay...
Outre ces parutions, on note aussi la sortie en 1974 du roman Les Patenteux (Éditions du Jour) de l'archéologue Marcel Moussette, dont la part de science-fiction est modeste et réside surtout dans les machines incongrues des protagonistes. Passons sur un court volume illustré de Robert Hénen, Le grand silence : Sharade, aventurière de l'espace (Éditions Héritage), et il ne reste plus qu'à mentionner le premier roman d'Esther Rochon, En hommage aux araignées. La couverture de Léo Côté (qu'il est difficile de retracer) a l'avantage d'illustrer le sujet du roman, mais on ne saurait dire qu'elle est particulièrement attirante. (Un de ces jours, je la comparerai aux couvertures des autres éditions de ce roman.) La Citadelle de Frulken et sa situation sur les hauteurs de l'île sont suggérées par une illustration en forme de mosaïque multicolore. La toile d'araignée accrochée aux nuages, et surplombant la Citadelle, évoque assez bien le personnage de Jouskilliant Green, dont la présence souterraine jette une ombre sur la vie des habitants de Frulken, et aussi celui la jeune Anar Vranengal, un peu dans les nuages puisqu'elle est un peu rêveuse...
plus qu'à mentionner le premier roman d'Esther Rochon, En hommage aux araignées. La couverture de Léo Côté (qu'il est difficile de retracer) a l'avantage d'illustrer le sujet du roman, mais on ne saurait dire qu'elle est particulièrement attirante. (Un de ces jours, je la comparerai aux couvertures des autres éditions de ce roman.) La Citadelle de Frulken et sa situation sur les hauteurs de l'île sont suggérées par une illustration en forme de mosaïque multicolore. La toile d'araignée accrochée aux nuages, et surplombant la Citadelle, évoque assez bien le personnage de Jouskilliant Green, dont la présence souterraine jette une ombre sur la vie des habitants de Frulken, et aussi celui la jeune Anar Vranengal, un peu dans les nuages puisqu'elle est un peu rêveuse...
Contrairement aux jeunes auteurs publiés sous l'étiquette L'Actuelle/Jeunesse, Rochon était en 1974 une jeune femme de 26 ans en pleine rédaction de thèse de doctorat en mathématiques. Le roman reflète cette maturité. En fait, il suffit de lire quelques lignes pour comprendre pourquoi c'est l'ouvrage qui surnage de l'année 1974. À tout le moins, il se classe avec les recueils de Brossard et de Charbonneau-Tissot pour la finesse des descriptions et le sang-froid d'une imagination que l'altérité n'effraie pas.
Comme Rochon a fait une longue carrière depuis, participant à toutes les instances et institutions de la SFCF, remportant tous les prix et signant de nombreux textes, on se souvient en partie de 1974 parce que c'est l'année qui marque le début de cette carrière. Évidemment, on s'en souvient aussi en raison de la fondation du fanzine Requiem au CEGEP Édouard-Montpetit. Je reproduis ci-dessous la couverture d'un numéro assez typique de la première année de publication (on y retrouve des textes de Daniel Sernine, Élisabeth Vonarburg et... Esther Rochon). C'est donc un numéro de 1975, mais je n'ai pas de numéro plus ancien dans ma collection, puisque je ne fais pas partie du premier cercle... En 1975, Requiem comptait 24 pages, couvertures comprises. On était loin des 164 pages (couvertures comprises) atteintes par le nouveau Solaris. Il faut admirer en tout cas une couverture qui réussit à combiner dans la même maquette la science (la plaque de Pioneer 10 conçue par Carl Sagan et Frank Drake), la science-fiction ou le fantastique (sous la forme de ce personnage serpentiforme) et le salace...
Pour un certain nombre de connaisseurs de la SFCF, l'époque moderne de la science-fiction commence en 1974 au Canada francophone. L'argument principal concerne moins la présence
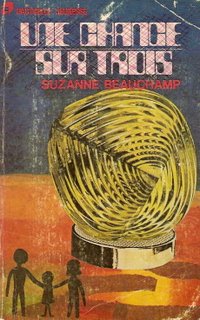 de nouveaux ouvrages ou une accélération du nombre de parutions, mais la fondation du fanzine Requiem qui allait devenir une pépinière de talents et un carrefour incontournable avant de changer de peau et de devenir la revue Solaris. C'est la thèse des institutions structurantes, disons, même si ce critère fait de 1979 une année encore plus importante puisque c'est alors le lancement d'imagine..., l'acte de naissance de Solaris, le premier congrès Boréal et le départ de l'expérience PTBGDA. En revanche, le critère des publications idoines ne fait pas de 1974 un moment unique. Après tout, j'ai déjà souligné l'existence de nombreux ouvrages antérieurs à 1974, et même à 1960 (date retenue de préférence par les universitaires qui veulent faire le lien entre la modernité de la science-fiction et la modernité du Québec qui abordait la Révolution tranquille). Mais si 1974 n'est pas l'année d'une percée sans précédente, c'est quand même une année particulièrement féconde en publications relevant de la science-fiction ou du fantastique. Une quinzaine d'ouvrages — romans ou recueils ou romans pour jeunes — sont édités en 1974 dans ces genres et offerts à la vente.
de nouveaux ouvrages ou une accélération du nombre de parutions, mais la fondation du fanzine Requiem qui allait devenir une pépinière de talents et un carrefour incontournable avant de changer de peau et de devenir la revue Solaris. C'est la thèse des institutions structurantes, disons, même si ce critère fait de 1979 une année encore plus importante puisque c'est alors le lancement d'imagine..., l'acte de naissance de Solaris, le premier congrès Boréal et le départ de l'expérience PTBGDA. En revanche, le critère des publications idoines ne fait pas de 1974 un moment unique. Après tout, j'ai déjà souligné l'existence de nombreux ouvrages antérieurs à 1974, et même à 1960 (date retenue de préférence par les universitaires qui veulent faire le lien entre la modernité de la science-fiction et la modernité du Québec qui abordait la Révolution tranquille). Mais si 1974 n'est pas l'année d'une percée sans précédente, c'est quand même une année particulièrement féconde en publications relevant de la science-fiction ou du fantastique. Une quinzaine d'ouvrages — romans ou recueils ou romans pour jeunes — sont édités en 1974 dans ces genres et offerts à la vente.Ainsi, dans la collection L'Actuelle/Jeunesse, la jeune Suzanne Beauchamp, qui fréquente l'école secondaire Saint-Luc, signe à l'âge de seize ans un roman pour jeunes intitulé Une chance sur
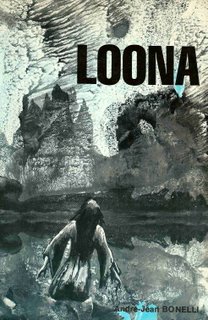 trois. On peut voir ci-dessus la couverture très abîmée de mon exemplaire de ce livre. Loin des audaces de Charles Montpetit, Beauchamp imagine une histoire d'amour entre une jeune Montréalaise et un jeune garçon de son âge qui est originaire, en fin de compte, d'une autre planète. L'illustration est de Célyne Fortin. Le nombre de récits de science-fiction parus dans cette collection est très révélateur de l'intérêt des jeunes de l'époque pour ce genre puisque cette collection publiait avant tout des textes rédigés par de jeunes auteurs.
trois. On peut voir ci-dessus la couverture très abîmée de mon exemplaire de ce livre. Loin des audaces de Charles Montpetit, Beauchamp imagine une histoire d'amour entre une jeune Montréalaise et un jeune garçon de son âge qui est originaire, en fin de compte, d'une autre planète. L'illustration est de Célyne Fortin. Le nombre de récits de science-fiction parus dans cette collection est très révélateur de l'intérêt des jeunes de l'époque pour ce genre puisque cette collection publiait avant tout des textes rédigés par de jeunes auteurs.Dans un genre beaucoup plus adulte, le roman Loona ou Autrefois le ciel était bleu d'André-Jean Bonelli a malgré tout une certaine importance historique, si ce n'est qu'en raison de son rattachement à une collection intitulée « Demain aujourd'hui », qui est sûrement une des plus anciennes tentatives de fonder une collection de sf au Québec. L'inclusion d'un autre titre dans la même collection, Yann ou La condition inhumaine, était promise, tandis que Les clés de la cinquième dimension et Les Hybrides devaient paraître dans la collection « Les portes de l'impossible ». Comme Bonelli est né à Marseille et a longtemps vécu en Ardèche, où il était maire d'un petit village en 1974, son rapport avec le Québec n'est pas clair. La maison d'édition de Loona, Helios, était basée à Kénogami et disposait d'une boîte postale à Jonquière. Le directeur, Gaétan Thibeault, porte un nom qui se retrouve dans la région (c'est celui d'un spécialiste de l'éthique et de la bioéthique à l'UQAC à une époque), mais l'illustrateur, Alain Bonnand, est sans doute celui qui exposait au Musée de l'Érotisme de Paris en 2001, car certains dessins du livre se rapprochent du sado-masochisme. Loona a été réimprimé en France en 1977; il semble donc que Bonelli n'ait publié ce roman au Québec que par hasard.
Par contre, on ne mettra pas en doute la québécitude de Jean Côté, auteur du roman Échec au président. Les Éditions Point de Mire sont basées à Repentigny et annoncent, entre autres
 parutions, un Dictionnaire des expressions québécoises. On peut espérer que Jean Côté n'en était pas l'auteur, à en juger par les qualités douteuses d'Échec au président... Dans cette histoire qui défie la compréhension, la prose est inimitablement mauvaise. Qu'on en juge par le début du résumé en quatrième de couverture : « Il était devenu un amalgame de puissance surhumaine, quelque chose comme une bombe H sur deux pattes ou un Hercule renaissant de la mythologie. » Soupir... L'identité de l'illustrateur n'est pas fournie.
parutions, un Dictionnaire des expressions québécoises. On peut espérer que Jean Côté n'en était pas l'auteur, à en juger par les qualités douteuses d'Échec au président... Dans cette histoire qui défie la compréhension, la prose est inimitablement mauvaise. Qu'on en juge par le début du résumé en quatrième de couverture : « Il était devenu un amalgame de puissance surhumaine, quelque chose comme une bombe H sur deux pattes ou un Hercule renaissant de la mythologie. » Soupir... L'identité de l'illustrateur n'est pas fournie.On peut se consoler en songeant ici à des livres de 1974 dont je n'inclus pas la couverture (faute d'avoir une édition originale sous la main). Par exemple, Jacques Brossard, mieux connu ultérieurement pour L'Oiseau de feu, réunit en cette même année un recueil composée de nouvelles des plus agréables, Le Métamorfaux (Hurtubise HMH). Également de bonne facture, le recueil Contes pour hydrocéphales adultes (CLF) de Claudette Charbonneau-Tissot offre de très bons textes.
L'ouvrage le plus singulier de 1974 est sans conteste Reliefs de l'arsenal de Roger Des Roches. Le jeune auteur et poète avait alors 24 ans et il offrait un livre monté comme certains manga.
 Ce qui est normalement la couverture présentait une simple illustration — une photo de Lois Siegel selon le péritexte, rendue troublante par l'absence de nez — tandis que le quatrième de couverture fournissait le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et la catégorie dans laquelle tombait l'œuvre : «Récit».
Ce qui est normalement la couverture présentait une simple illustration — une photo de Lois Siegel selon le péritexte, rendue troublante par l'absence de nez — tandis que le quatrième de couverture fournissait le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et la catégorie dans laquelle tombait l'œuvre : «Récit».La présentation du livre précise (et avertit) : « Il devient aisé (à la lecture) de comprendre que ce texte n'est plus une narration linéaire, uniforme, monothématique, sa structure étant ce qu'elle est, et, non plus, une "prose poétique", terme qu'on voudrait et qu'on a utilisé à toutes les sauces. Une recherche calculée, pensée et préparée depuis un certain temps, de quelques aspects du récit, et plus précisément celui de "science-fiction" dont elle emprunte quelques-uns de ses aspects les plus usuels.» De fait, longtemps avant Dans une galaxie près de chez vous, Des Roches déconstruit une certaine science-fiction. Si je choisis un passage parmi les plus cohérents et lisibles (car, franchement, le reste du texte...), cela peut donner ceci : « Pendant que je discute, ferme, avec sa jeune fille, le vent porte les dernières paroles de notre héroïque commandant prenant possession, au nom de la Fédération, de la planète que les indigènes désignent par Seycherrahz'zium ("Petit Couple de Dieux Forniquant au Lever") (nom auquel il préférera évidemment le sien, comme c'est coutume, c'est-à-dire Lapointe, ce qui fera, dans les registres, plus plausible et surtout plus facile à prononcer. »
Avec Contes ardents du pays mauve de Jean Ferguson, on retombe de plusieurs crans dans le poncif. Recueil de huit nouvelles, l'ouvrage est doté d'un titre qui pique la curiosité et d'une
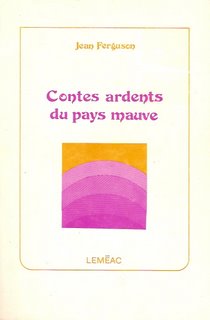 maquette d'une sobriété respectable (mais qui n'est pas créditée). Les choses se gâtent quand on se met à lire... Loin de la déconstruction littéraire de la science-fiction pratiquée par Roger Des Roches, Ferguson est plutôt de ceux pour qui la science-fiction est voisine de l'ufologie. Autrement dit, il était de son temps et ses textes de science-fiction ne transcendent nullement les clichés de son époque. Les personnages portent des numéros dans « Le petit numéro deux mille quarante », des primitifs vivent dans un monde post-apocalyptique dans « Ker, le tueur de dieu » (avec une de ces chutes à saveur biblique qui semblait le comble de l'audace à l'époque), une société future se penche sur les vestiges du vingtième siècle et juge inconcevables les bizarreries de ces sociétés disparues... Comme la langue est souvent quelconque, il n'y a franchement pas grand-chose pour racheter l'ensemble.
maquette d'une sobriété respectable (mais qui n'est pas créditée). Les choses se gâtent quand on se met à lire... Loin de la déconstruction littéraire de la science-fiction pratiquée par Roger Des Roches, Ferguson est plutôt de ceux pour qui la science-fiction est voisine de l'ufologie. Autrement dit, il était de son temps et ses textes de science-fiction ne transcendent nullement les clichés de son époque. Les personnages portent des numéros dans « Le petit numéro deux mille quarante », des primitifs vivent dans un monde post-apocalyptique dans « Ker, le tueur de dieu » (avec une de ces chutes à saveur biblique qui semblait le comble de l'audace à l'époque), une société future se penche sur les vestiges du vingtième siècle et juge inconcevables les bizarreries de ces sociétés disparues... Comme la langue est souvent quelconque, il n'y a franchement pas grand-chose pour racheter l'ensemble.On se demande alors si ces interférences de la science-fiction, de ses lieux communs et de certaines croyances mutantes (aux OVNIs, par exemple) peuvent expliquer la défaveur graduelle que la sf a connu depuis 1974. La science-fiction repose sur les mêmes principes qui sous-tendent les lieux communs les plus éculés et les croyances les plus loufoques : distanciation, conjecture, expérience de pensée conjuguant conjecture et déduction... Pour certains, ces choses ont un caractère difficilement séparable, qu'il s'agisse des critiques observant le phénomène de l'extérieur ou de certains des artisans eux-mêmes œuvrant à l'intérieur du genre. Dans le monde francophone, il me semble que la confusion a été entretenue avec beaucoup plus d'insistance qu'ailleurs, la faute à des sous-produits de la pensée comme la revue Planète ou Le Matin des magiciens. Ce qui donne encore aujourd'hui une certaine coloration à la science-fiction francophone qui accueille, dans le meilleur des cas, des auteurs comme Maurice Dantec ou Éric Vincent ou qui doit admettre, dans le pire des cas, des scories ésotérico-illuminées comme celles d'un certain nombre d'auteurs québécois souvent édités à leurs frais...
Heureusement, le niveau est un peu relevé en 1974 par la science-fiction pour jeunes. Le titre phare est sans doute Titralak, cadet de l'espace (Éditions Héritage), de Suzanne Martel. La couverture de Bernard
 Beaudry aurait pu être rattachée à mon exploration du thème de la soucoupe (voir ci-dessus), mais elle n'en vaut franchement pas la peine. Le dessin est assez maladroit, en particulier en ce qui concerne le personnage au premier plan (qui peut rappeler un jeune Luc Pomerleau...). Le roman est bien meilleur. Certes, Martel recourt à certaines des stratégies employées par Ferguson pour mettre en scène le choc des perspectives, mais ce qui est difficilement supportable dans un recueil destiné à des lecteurs adultes passe beaucoup mieux dans un ouvrage pour les jeunes. De plus, Martel fait montre d'une habileté certaine en mêlant la réalité d'un visiteur extraterrestre à un jeu imaginé par des enfants qui s'amusent à faire semblant qu'ils sont... des explorateurs spatiaux. Le pauvre Titralak, cadet naufragé sur Terre, est abusé par leurs prétentions innocentes et c'est le point de départ d'aventures relativement bien informées du point de vue scientifique. (Martel s'était renseignée auprès de chercheurs de l'École Polytechnique. Et ce qu'elle décrit du moteur nucléaire de l'engin de Titralak correspond effectivement à certaines conceptions très sérieuses dans le domaine.)
Beaudry aurait pu être rattachée à mon exploration du thème de la soucoupe (voir ci-dessus), mais elle n'en vaut franchement pas la peine. Le dessin est assez maladroit, en particulier en ce qui concerne le personnage au premier plan (qui peut rappeler un jeune Luc Pomerleau...). Le roman est bien meilleur. Certes, Martel recourt à certaines des stratégies employées par Ferguson pour mettre en scène le choc des perspectives, mais ce qui est difficilement supportable dans un recueil destiné à des lecteurs adultes passe beaucoup mieux dans un ouvrage pour les jeunes. De plus, Martel fait montre d'une habileté certaine en mêlant la réalité d'un visiteur extraterrestre à un jeu imaginé par des enfants qui s'amusent à faire semblant qu'ils sont... des explorateurs spatiaux. Le pauvre Titralak, cadet naufragé sur Terre, est abusé par leurs prétentions innocentes et c'est le point de départ d'aventures relativement bien informées du point de vue scientifique. (Martel s'était renseignée auprès de chercheurs de l'École Polytechnique. Et ce qu'elle décrit du moteur nucléaire de l'engin de Titralak correspond effectivement à certaines conceptions très sérieuses dans le domaine.)Parmi les romans pour jeunes, il faut aussi noter L'Héritage de Bhor (Paulines, collection « Jeunesse-Pop ») de Jean-Pierre Charland, Révolte secrète (Paulines, collection « Jeunesse-Pop ») de Louis Sutal (Normand Côté de son vrai nom) et Les farfelus du cosmos (Paulines, collection « Jeunesse-Pop ») de Herménégilde Laflamme. Dans ce dernier roman, des OVNIs visitent Solaris (!), une petite ville apparemment située dans la région du Saguenay...
Outre ces parutions, on note aussi la sortie en 1974 du roman Les Patenteux (Éditions du Jour) de l'archéologue Marcel Moussette, dont la part de science-fiction est modeste et réside surtout dans les machines incongrues des protagonistes. Passons sur un court volume illustré de Robert Hénen, Le grand silence : Sharade, aventurière de l'espace (Éditions Héritage), et il ne reste
 plus qu'à mentionner le premier roman d'Esther Rochon, En hommage aux araignées. La couverture de Léo Côté (qu'il est difficile de retracer) a l'avantage d'illustrer le sujet du roman, mais on ne saurait dire qu'elle est particulièrement attirante. (Un de ces jours, je la comparerai aux couvertures des autres éditions de ce roman.) La Citadelle de Frulken et sa situation sur les hauteurs de l'île sont suggérées par une illustration en forme de mosaïque multicolore. La toile d'araignée accrochée aux nuages, et surplombant la Citadelle, évoque assez bien le personnage de Jouskilliant Green, dont la présence souterraine jette une ombre sur la vie des habitants de Frulken, et aussi celui la jeune Anar Vranengal, un peu dans les nuages puisqu'elle est un peu rêveuse...
plus qu'à mentionner le premier roman d'Esther Rochon, En hommage aux araignées. La couverture de Léo Côté (qu'il est difficile de retracer) a l'avantage d'illustrer le sujet du roman, mais on ne saurait dire qu'elle est particulièrement attirante. (Un de ces jours, je la comparerai aux couvertures des autres éditions de ce roman.) La Citadelle de Frulken et sa situation sur les hauteurs de l'île sont suggérées par une illustration en forme de mosaïque multicolore. La toile d'araignée accrochée aux nuages, et surplombant la Citadelle, évoque assez bien le personnage de Jouskilliant Green, dont la présence souterraine jette une ombre sur la vie des habitants de Frulken, et aussi celui la jeune Anar Vranengal, un peu dans les nuages puisqu'elle est un peu rêveuse...Contrairement aux jeunes auteurs publiés sous l'étiquette L'Actuelle/Jeunesse, Rochon était en 1974 une jeune femme de 26 ans en pleine rédaction de thèse de doctorat en mathématiques. Le roman reflète cette maturité. En fait, il suffit de lire quelques lignes pour comprendre pourquoi c'est l'ouvrage qui surnage de l'année 1974. À tout le moins, il se classe avec les recueils de Brossard et de Charbonneau-Tissot pour la finesse des descriptions et le sang-froid d'une imagination que l'altérité n'effraie pas.
Comme Rochon a fait une longue carrière depuis, participant à toutes les instances et institutions de la SFCF, remportant tous les prix et signant de nombreux textes, on se souvient en partie de 1974 parce que c'est l'année qui marque le début de cette carrière. Évidemment, on s'en souvient aussi en raison de la fondation du fanzine Requiem au CEGEP Édouard-Montpetit. Je reproduis ci-dessous la couverture d'un numéro assez typique de la première année de publication (on y retrouve des textes de Daniel Sernine, Élisabeth Vonarburg et... Esther Rochon). C'est donc un numéro de 1975, mais je n'ai pas de numéro plus ancien dans ma collection, puisque je ne fais pas partie du premier cercle... En 1975, Requiem comptait 24 pages, couvertures comprises. On était loin des 164 pages (couvertures comprises) atteintes par le nouveau Solaris. Il faut admirer en tout cas une couverture qui réussit à combiner dans la même maquette la science (la plaque de Pioneer 10 conçue par Carl Sagan et Frank Drake), la science-fiction ou le fantastique (sous la forme de ce personnage serpentiforme) et le salace...

Libellés : Canada, Science-fiction
