2006-02-17
Iconographie de la SFCF (4)
Dans mes livraisons précédentes sur l'iconographie de la SFCF, j'ai vanté les ouvrages pour jeunes dont les couvertures sont plus souvent illustrées qu'autrement. Souvent, ce sont ses  couvertures qui nous permettent de nous faire une certaine idée de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le fantastique, la science-fiction, le futur, etc. C'était assez frappant dans le cas du roman Surréal 3000 de Suzanne Martel. L'illustration du merveilleux au Canada francophone a livré aussi quelques couvertures caractéristiques. Il est également possible de suivre les apparitions d'un motif, comme celui de la soucoupe volante... Les ouvrages pour jeunes ont, comme je l'indiquais, l'avantage de viser un public jugé plus sensible à des images primaires, et donc évidentes. Ainsi, Louise Roy-Kerrigan est certes assez fidèle à la description donnée par Henriette Major dans son roman À la conquête du temps (1970). Les deux jeunes héros ont découvert chez leur oncle inventeur « un étrange appareil : c'était tout bonnement un fauteuil de barbier à l'ancienne mode entouré d'une série de plaques de métal qui formaient tout autour comme une espèce de réseau d'où sortaient des dizaines de fils électriques. Ces fils étaient reliés à une sorte d'ordinateur sur lequel un panneau brillait de tous ses cadrans et de toutes ses manettes. La machine semblait en marche car on entendait un léger bourdonnement tandis que des lumières clignotaient par endroits.» (p. 14) Néanmoins, le choix a été fait d'illustrer, un peu comme dans le cas de Surréal 3000, non pas un élément nécessairement caractéristique du roman, mais un élément emblématique des technologies de pointe de l'époque — l'ordinateur (légèrement anthropomorphique dans ce cas-ci).
couvertures qui nous permettent de nous faire une certaine idée de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le fantastique, la science-fiction, le futur, etc. C'était assez frappant dans le cas du roman Surréal 3000 de Suzanne Martel. L'illustration du merveilleux au Canada francophone a livré aussi quelques couvertures caractéristiques. Il est également possible de suivre les apparitions d'un motif, comme celui de la soucoupe volante... Les ouvrages pour jeunes ont, comme je l'indiquais, l'avantage de viser un public jugé plus sensible à des images primaires, et donc évidentes. Ainsi, Louise Roy-Kerrigan est certes assez fidèle à la description donnée par Henriette Major dans son roman À la conquête du temps (1970). Les deux jeunes héros ont découvert chez leur oncle inventeur « un étrange appareil : c'était tout bonnement un fauteuil de barbier à l'ancienne mode entouré d'une série de plaques de métal qui formaient tout autour comme une espèce de réseau d'où sortaient des dizaines de fils électriques. Ces fils étaient reliés à une sorte d'ordinateur sur lequel un panneau brillait de tous ses cadrans et de toutes ses manettes. La machine semblait en marche car on entendait un léger bourdonnement tandis que des lumières clignotaient par endroits.» (p. 14) Néanmoins, le choix a été fait d'illustrer, un peu comme dans le cas de Surréal 3000, non pas un élément nécessairement caractéristique du roman, mais un élément emblématique des technologies de pointe de l'époque — l'ordinateur (légèrement anthropomorphique dans ce cas-ci).
D'ailleurs, Henriette Major (1933-) fait pratiquement partie de la même génération que Suzanne Martel (1924-) et n'est pas beaucoup plus âgée qu'André Ber (1920-), qui a commencé par se rapprocher de la science-fiction avec un roman d'aventures d'un genre assez rare au Canada français, Le Repaire des loups gris (1962). Un peu comme dans Rocketship Galileo d'Heinlein et de nombreux autres romans d'aventures de l'après-guerre (dans la foulée des textes publiés durant les années de guerre), on trouve des Nazis qui disposent d'une base secrète. Celle-ci a la particularité de se trouver dans une île qui abrite des vestiges de l'Atlantide. L'action se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel. C'est l'existence de ces vestiges de l'Atlantide qui rattache l'ouvrage à la science-fiction, car le reste relève d'une intrigue qui mêle la guerre, l'espionnage et l'amour de manière assez classique. L'illustration de Gabriel de Beney — qui a illustré le premier roman de science-fiction pour jeunes de Daniel Sernine, Organisation Argus (1979) — n'inclut d'ailleurs aucune illusion flagrante à cet élément de l'histoire. L'atmosphère qui se dégage du tableau rappelle plutôt la littérature de voyage et les romans d'aventures exotiques signés par Verne et par ses successeurs. Il faut d'ailleurs souligner que rien n'indique qu'il s'agit de littérature pour jeunes; l'ouvrage est présenté comme faisant partie de la collection « Rêve et Vie », qui comprend des titres de Guermaine Guèvremont, Félix Leclerc (Pieds nus dans l'aube) et Antonine Maillet.
rapprocher de la science-fiction avec un roman d'aventures d'un genre assez rare au Canada français, Le Repaire des loups gris (1962). Un peu comme dans Rocketship Galileo d'Heinlein et de nombreux autres romans d'aventures de l'après-guerre (dans la foulée des textes publiés durant les années de guerre), on trouve des Nazis qui disposent d'une base secrète. Celle-ci a la particularité de se trouver dans une île qui abrite des vestiges de l'Atlantide. L'action se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel. C'est l'existence de ces vestiges de l'Atlantide qui rattache l'ouvrage à la science-fiction, car le reste relève d'une intrigue qui mêle la guerre, l'espionnage et l'amour de manière assez classique. L'illustration de Gabriel de Beney — qui a illustré le premier roman de science-fiction pour jeunes de Daniel Sernine, Organisation Argus (1979) — n'inclut d'ailleurs aucune illusion flagrante à cet élément de l'histoire. L'atmosphère qui se dégage du tableau rappelle plutôt la littérature de voyage et les romans d'aventures exotiques signés par Verne et par ses successeurs. Il faut d'ailleurs souligner que rien n'indique qu'il s'agit de littérature pour jeunes; l'ouvrage est présenté comme faisant partie de la collection « Rêve et Vie », qui comprend des titres de Guermaine Guèvremont, Félix Leclerc (Pieds nus dans l'aube) et Antonine Maillet.
Toutefois, un passage du roman annonce l'ouvrage suivant de Ber. Le narrateur est l'assistant d'un professeur et se passionne pour les religions atlantes après la découverte d'un temple qui se serait dressé au cœur de la capitale de l'Atlantide. Quand il revient du temple ruiné, il livre à sa compagne de voyage ce que son imagination lui dit de la civilisation atlante : « Pour elle, j'essayais de revivre ces sortes de rêves étranges que je faisais parfois tout éveillé dans le silence. Allongé sur les dalles, dans une sorte de transe cataleptique je laissais mon esprit remonter le temps. Et ainsi, des heures durant, j'ai parcouru les plaines de l'Atlantide, j'ai gravi ses montagnes, j'ai vécu dans la Cité aux portes d'or. Une seule explication plausible à ces rappels fulgurants du passé : toutes mes lectures, toutes mes pensées, depuis des années avaient été orientées sur ce sujet. Mon imagination aidant, je reconstituais machinalement dans mon subconscient, des fresques historiques où rien ne manquait, ni la couleur, ni la véracité puisque je puisais mon inspiration à la source même. » (p. 121) Or, dans le roman suivant de Ber, Ségoldiah (1964), une intervention du surnaturel est également expliquée (au moins en partie) par un phénomène semblable d'auto-hypnose, même s'il est plus longuement justifié. Cette fois, il s'agit clairement d'un roman tout ce qu'il y a de plus adulte, même si le personnage de Ségoldiah l'immortelle, esprit immanent capable de prendre possession des cerveaux mortels, pourrait devoir quelque chose à certains personnages de la littérature populaire antérieure (on pense à She de Haggard ou à l'Antinéa de Benoit, toutes proportions gardées).
serait dressé au cœur de la capitale de l'Atlantide. Quand il revient du temple ruiné, il livre à sa compagne de voyage ce que son imagination lui dit de la civilisation atlante : « Pour elle, j'essayais de revivre ces sortes de rêves étranges que je faisais parfois tout éveillé dans le silence. Allongé sur les dalles, dans une sorte de transe cataleptique je laissais mon esprit remonter le temps. Et ainsi, des heures durant, j'ai parcouru les plaines de l'Atlantide, j'ai gravi ses montagnes, j'ai vécu dans la Cité aux portes d'or. Une seule explication plausible à ces rappels fulgurants du passé : toutes mes lectures, toutes mes pensées, depuis des années avaient été orientées sur ce sujet. Mon imagination aidant, je reconstituais machinalement dans mon subconscient, des fresques historiques où rien ne manquait, ni la couleur, ni la véracité puisque je puisais mon inspiration à la source même. » (p. 121) Or, dans le roman suivant de Ber, Ségoldiah (1964), une intervention du surnaturel est également expliquée (au moins en partie) par un phénomène semblable d'auto-hypnose, même s'il est plus longuement justifié. Cette fois, il s'agit clairement d'un roman tout ce qu'il y a de plus adulte, même si le personnage de Ségoldiah l'immortelle, esprit immanent capable de prendre possession des cerveaux mortels, pourrait devoir quelque chose à certains personnages de la littérature populaire antérieure (on pense à She de Haggard ou à l'Antinéa de Benoit, toutes proportions gardées).
Le responsable de la couverture n'est pas identifié et ce maquettiste anonyme n'a pas livré quelque chose de très parlant. La maquette d'une autre couverture de 1962 est plus parlante. Trop, peut-être. En effet, tout ce qu'elle offre, c'est la reproduction en transparence d'une page du journal du docteur Jan von Fries. Les Éditions À la page constituaient une petite maison sise à Montréal, qui avait également publié Claude Jasmin et trois autres auteurs à cette date. Le roman n'a d'ailleurs été tiré qu'à 800 exemplaires. Celui que je possède est l'exemplaire numéro 25 et il est dédicacé de la main de Ronald Després à « M. et Mme Claude Aubry ». Claude Aubry (1914-1984), directeur de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 1953 à 1979, était lui-même un auteur de quelques ouvrages à saveur fantaisiste. Je l'avais rencontré dans mes jeunes années, quelques années avant sa mort, lors d'une fête quelconque à la bibliothèque de mon quartier à Gloucester, sur le chemin Ogilvie. Comme Ronald Després était en 1962 un traducteur à la Chambre des Communes du Parlement d'Ottawa, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ses deux hommes de lettres se soient connus dans ce qui devait être un très petit milieu littéraire francophone à cette époque de l'histoire d'Ottawa... La couverture peut passer pour minimaliste, mais elle n'est pas dénuée d'originalité et elle a l'avantage de prêter vie à un texte assez sec et fort difficile à illustrer. (Comment diable plaquer une image sur la relation par un médecin de son entreprise de vivisection de l'humanité entière?)
Trop, peut-être. En effet, tout ce qu'elle offre, c'est la reproduction en transparence d'une page du journal du docteur Jan von Fries. Les Éditions À la page constituaient une petite maison sise à Montréal, qui avait également publié Claude Jasmin et trois autres auteurs à cette date. Le roman n'a d'ailleurs été tiré qu'à 800 exemplaires. Celui que je possède est l'exemplaire numéro 25 et il est dédicacé de la main de Ronald Després à « M. et Mme Claude Aubry ». Claude Aubry (1914-1984), directeur de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 1953 à 1979, était lui-même un auteur de quelques ouvrages à saveur fantaisiste. Je l'avais rencontré dans mes jeunes années, quelques années avant sa mort, lors d'une fête quelconque à la bibliothèque de mon quartier à Gloucester, sur le chemin Ogilvie. Comme Ronald Després était en 1962 un traducteur à la Chambre des Communes du Parlement d'Ottawa, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ses deux hommes de lettres se soient connus dans ce qui devait être un très petit milieu littéraire francophone à cette époque de l'histoire d'Ottawa... La couverture peut passer pour minimaliste, mais elle n'est pas dénuée d'originalité et elle a l'avantage de prêter vie à un texte assez sec et fort difficile à illustrer. (Comment diable plaquer une image sur la relation par un médecin de son entreprise de vivisection de l'humanité entière?)
On ne peut en dire autant de la couverture du roman de Jean Tétreau, Les Nomades (1967). Alors qu'il s'agit, contrairement à la plupart de ces livres, d'un roman de science-fiction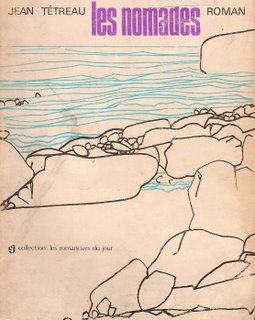 pleinement assumé, appartenant même à un sous-genre déjà classique, soit celui du récit post-cataclysmique, la couverture offre la plus désolante vacuité.
pleinement assumé, appartenant même à un sous-genre déjà classique, soit celui du récit post-cataclysmique, la couverture offre la plus désolante vacuité.
Cette maquette créée par le Studio Gagnier, Fleury et Associés semble représenter, de manière épurée, un rivage quelconque. (De fait, le roman commence bien au bord de la Méditerranée.) Alors que Tétreau raconte les aventures de Silvana dans un monde bouleversé par des catastrophes aux origines complexes, la couverture ne laisse rien filtrer du propos. Une couverture « blanche », à la française, aurait tout aussi bien fait l'affaire dans ce cas.
Pourtant, Tétreau fait intervenir des escadres d'astronefs, fait allusion à une émergence de l'Atlantide et promène son héroïne dans plusieurs lieux de la péninsule italienne, voire de l'Europe. Certes, le projet semble vaciller entre le roman d'aventures ou de science-fiction, et le roman philosophique, mais on ne peut que déplorer la timidité de l'éditeur qui avait ici l'occasion de commander une couverture beaucoup plus dramatique. Le flou du positionnement esthétique de la science-fiction a sans doute joué un rôle. Et le désir de respectabilité l'a peut-être emporté...
 couvertures qui nous permettent de nous faire une certaine idée de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le fantastique, la science-fiction, le futur, etc. C'était assez frappant dans le cas du roman Surréal 3000 de Suzanne Martel. L'illustration du merveilleux au Canada francophone a livré aussi quelques couvertures caractéristiques. Il est également possible de suivre les apparitions d'un motif, comme celui de la soucoupe volante... Les ouvrages pour jeunes ont, comme je l'indiquais, l'avantage de viser un public jugé plus sensible à des images primaires, et donc évidentes. Ainsi, Louise Roy-Kerrigan est certes assez fidèle à la description donnée par Henriette Major dans son roman À la conquête du temps (1970). Les deux jeunes héros ont découvert chez leur oncle inventeur « un étrange appareil : c'était tout bonnement un fauteuil de barbier à l'ancienne mode entouré d'une série de plaques de métal qui formaient tout autour comme une espèce de réseau d'où sortaient des dizaines de fils électriques. Ces fils étaient reliés à une sorte d'ordinateur sur lequel un panneau brillait de tous ses cadrans et de toutes ses manettes. La machine semblait en marche car on entendait un léger bourdonnement tandis que des lumières clignotaient par endroits.» (p. 14) Néanmoins, le choix a été fait d'illustrer, un peu comme dans le cas de Surréal 3000, non pas un élément nécessairement caractéristique du roman, mais un élément emblématique des technologies de pointe de l'époque — l'ordinateur (légèrement anthropomorphique dans ce cas-ci).
couvertures qui nous permettent de nous faire une certaine idée de la manière dont nos prédécesseurs voyaient le fantastique, la science-fiction, le futur, etc. C'était assez frappant dans le cas du roman Surréal 3000 de Suzanne Martel. L'illustration du merveilleux au Canada francophone a livré aussi quelques couvertures caractéristiques. Il est également possible de suivre les apparitions d'un motif, comme celui de la soucoupe volante... Les ouvrages pour jeunes ont, comme je l'indiquais, l'avantage de viser un public jugé plus sensible à des images primaires, et donc évidentes. Ainsi, Louise Roy-Kerrigan est certes assez fidèle à la description donnée par Henriette Major dans son roman À la conquête du temps (1970). Les deux jeunes héros ont découvert chez leur oncle inventeur « un étrange appareil : c'était tout bonnement un fauteuil de barbier à l'ancienne mode entouré d'une série de plaques de métal qui formaient tout autour comme une espèce de réseau d'où sortaient des dizaines de fils électriques. Ces fils étaient reliés à une sorte d'ordinateur sur lequel un panneau brillait de tous ses cadrans et de toutes ses manettes. La machine semblait en marche car on entendait un léger bourdonnement tandis que des lumières clignotaient par endroits.» (p. 14) Néanmoins, le choix a été fait d'illustrer, un peu comme dans le cas de Surréal 3000, non pas un élément nécessairement caractéristique du roman, mais un élément emblématique des technologies de pointe de l'époque — l'ordinateur (légèrement anthropomorphique dans ce cas-ci).D'ailleurs, Henriette Major (1933-) fait pratiquement partie de la même génération que Suzanne Martel (1924-) et n'est pas beaucoup plus âgée qu'André Ber (1920-), qui a commencé par se
 rapprocher de la science-fiction avec un roman d'aventures d'un genre assez rare au Canada français, Le Repaire des loups gris (1962). Un peu comme dans Rocketship Galileo d'Heinlein et de nombreux autres romans d'aventures de l'après-guerre (dans la foulée des textes publiés durant les années de guerre), on trouve des Nazis qui disposent d'une base secrète. Celle-ci a la particularité de se trouver dans une île qui abrite des vestiges de l'Atlantide. L'action se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel. C'est l'existence de ces vestiges de l'Atlantide qui rattache l'ouvrage à la science-fiction, car le reste relève d'une intrigue qui mêle la guerre, l'espionnage et l'amour de manière assez classique. L'illustration de Gabriel de Beney — qui a illustré le premier roman de science-fiction pour jeunes de Daniel Sernine, Organisation Argus (1979) — n'inclut d'ailleurs aucune illusion flagrante à cet élément de l'histoire. L'atmosphère qui se dégage du tableau rappelle plutôt la littérature de voyage et les romans d'aventures exotiques signés par Verne et par ses successeurs. Il faut d'ailleurs souligner que rien n'indique qu'il s'agit de littérature pour jeunes; l'ouvrage est présenté comme faisant partie de la collection « Rêve et Vie », qui comprend des titres de Guermaine Guèvremont, Félix Leclerc (Pieds nus dans l'aube) et Antonine Maillet.
rapprocher de la science-fiction avec un roman d'aventures d'un genre assez rare au Canada français, Le Repaire des loups gris (1962). Un peu comme dans Rocketship Galileo d'Heinlein et de nombreux autres romans d'aventures de l'après-guerre (dans la foulée des textes publiés durant les années de guerre), on trouve des Nazis qui disposent d'une base secrète. Celle-ci a la particularité de se trouver dans une île qui abrite des vestiges de l'Atlantide. L'action se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel. C'est l'existence de ces vestiges de l'Atlantide qui rattache l'ouvrage à la science-fiction, car le reste relève d'une intrigue qui mêle la guerre, l'espionnage et l'amour de manière assez classique. L'illustration de Gabriel de Beney — qui a illustré le premier roman de science-fiction pour jeunes de Daniel Sernine, Organisation Argus (1979) — n'inclut d'ailleurs aucune illusion flagrante à cet élément de l'histoire. L'atmosphère qui se dégage du tableau rappelle plutôt la littérature de voyage et les romans d'aventures exotiques signés par Verne et par ses successeurs. Il faut d'ailleurs souligner que rien n'indique qu'il s'agit de littérature pour jeunes; l'ouvrage est présenté comme faisant partie de la collection « Rêve et Vie », qui comprend des titres de Guermaine Guèvremont, Félix Leclerc (Pieds nus dans l'aube) et Antonine Maillet.Toutefois, un passage du roman annonce l'ouvrage suivant de Ber. Le narrateur est l'assistant d'un professeur et se passionne pour les religions atlantes après la découverte d'un temple qui se
 serait dressé au cœur de la capitale de l'Atlantide. Quand il revient du temple ruiné, il livre à sa compagne de voyage ce que son imagination lui dit de la civilisation atlante : « Pour elle, j'essayais de revivre ces sortes de rêves étranges que je faisais parfois tout éveillé dans le silence. Allongé sur les dalles, dans une sorte de transe cataleptique je laissais mon esprit remonter le temps. Et ainsi, des heures durant, j'ai parcouru les plaines de l'Atlantide, j'ai gravi ses montagnes, j'ai vécu dans la Cité aux portes d'or. Une seule explication plausible à ces rappels fulgurants du passé : toutes mes lectures, toutes mes pensées, depuis des années avaient été orientées sur ce sujet. Mon imagination aidant, je reconstituais machinalement dans mon subconscient, des fresques historiques où rien ne manquait, ni la couleur, ni la véracité puisque je puisais mon inspiration à la source même. » (p. 121) Or, dans le roman suivant de Ber, Ségoldiah (1964), une intervention du surnaturel est également expliquée (au moins en partie) par un phénomène semblable d'auto-hypnose, même s'il est plus longuement justifié. Cette fois, il s'agit clairement d'un roman tout ce qu'il y a de plus adulte, même si le personnage de Ségoldiah l'immortelle, esprit immanent capable de prendre possession des cerveaux mortels, pourrait devoir quelque chose à certains personnages de la littérature populaire antérieure (on pense à She de Haggard ou à l'Antinéa de Benoit, toutes proportions gardées).
serait dressé au cœur de la capitale de l'Atlantide. Quand il revient du temple ruiné, il livre à sa compagne de voyage ce que son imagination lui dit de la civilisation atlante : « Pour elle, j'essayais de revivre ces sortes de rêves étranges que je faisais parfois tout éveillé dans le silence. Allongé sur les dalles, dans une sorte de transe cataleptique je laissais mon esprit remonter le temps. Et ainsi, des heures durant, j'ai parcouru les plaines de l'Atlantide, j'ai gravi ses montagnes, j'ai vécu dans la Cité aux portes d'or. Une seule explication plausible à ces rappels fulgurants du passé : toutes mes lectures, toutes mes pensées, depuis des années avaient été orientées sur ce sujet. Mon imagination aidant, je reconstituais machinalement dans mon subconscient, des fresques historiques où rien ne manquait, ni la couleur, ni la véracité puisque je puisais mon inspiration à la source même. » (p. 121) Or, dans le roman suivant de Ber, Ségoldiah (1964), une intervention du surnaturel est également expliquée (au moins en partie) par un phénomène semblable d'auto-hypnose, même s'il est plus longuement justifié. Cette fois, il s'agit clairement d'un roman tout ce qu'il y a de plus adulte, même si le personnage de Ségoldiah l'immortelle, esprit immanent capable de prendre possession des cerveaux mortels, pourrait devoir quelque chose à certains personnages de la littérature populaire antérieure (on pense à She de Haggard ou à l'Antinéa de Benoit, toutes proportions gardées).Le responsable de la couverture n'est pas identifié et ce maquettiste anonyme n'a pas livré quelque chose de très parlant. La maquette d'une autre couverture de 1962 est plus parlante.
 Trop, peut-être. En effet, tout ce qu'elle offre, c'est la reproduction en transparence d'une page du journal du docteur Jan von Fries. Les Éditions À la page constituaient une petite maison sise à Montréal, qui avait également publié Claude Jasmin et trois autres auteurs à cette date. Le roman n'a d'ailleurs été tiré qu'à 800 exemplaires. Celui que je possède est l'exemplaire numéro 25 et il est dédicacé de la main de Ronald Després à « M. et Mme Claude Aubry ». Claude Aubry (1914-1984), directeur de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 1953 à 1979, était lui-même un auteur de quelques ouvrages à saveur fantaisiste. Je l'avais rencontré dans mes jeunes années, quelques années avant sa mort, lors d'une fête quelconque à la bibliothèque de mon quartier à Gloucester, sur le chemin Ogilvie. Comme Ronald Després était en 1962 un traducteur à la Chambre des Communes du Parlement d'Ottawa, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ses deux hommes de lettres se soient connus dans ce qui devait être un très petit milieu littéraire francophone à cette époque de l'histoire d'Ottawa... La couverture peut passer pour minimaliste, mais elle n'est pas dénuée d'originalité et elle a l'avantage de prêter vie à un texte assez sec et fort difficile à illustrer. (Comment diable plaquer une image sur la relation par un médecin de son entreprise de vivisection de l'humanité entière?)
Trop, peut-être. En effet, tout ce qu'elle offre, c'est la reproduction en transparence d'une page du journal du docteur Jan von Fries. Les Éditions À la page constituaient une petite maison sise à Montréal, qui avait également publié Claude Jasmin et trois autres auteurs à cette date. Le roman n'a d'ailleurs été tiré qu'à 800 exemplaires. Celui que je possède est l'exemplaire numéro 25 et il est dédicacé de la main de Ronald Després à « M. et Mme Claude Aubry ». Claude Aubry (1914-1984), directeur de la Bibliothèque publique d'Ottawa de 1953 à 1979, était lui-même un auteur de quelques ouvrages à saveur fantaisiste. Je l'avais rencontré dans mes jeunes années, quelques années avant sa mort, lors d'une fête quelconque à la bibliothèque de mon quartier à Gloucester, sur le chemin Ogilvie. Comme Ronald Després était en 1962 un traducteur à la Chambre des Communes du Parlement d'Ottawa, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que ses deux hommes de lettres se soient connus dans ce qui devait être un très petit milieu littéraire francophone à cette époque de l'histoire d'Ottawa... La couverture peut passer pour minimaliste, mais elle n'est pas dénuée d'originalité et elle a l'avantage de prêter vie à un texte assez sec et fort difficile à illustrer. (Comment diable plaquer une image sur la relation par un médecin de son entreprise de vivisection de l'humanité entière?)On ne peut en dire autant de la couverture du roman de Jean Tétreau, Les Nomades (1967). Alors qu'il s'agit, contrairement à la plupart de ces livres, d'un roman de science-fiction
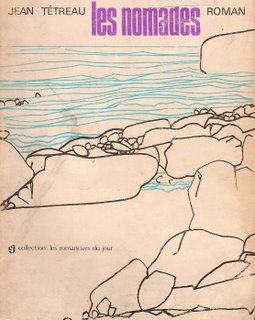 pleinement assumé, appartenant même à un sous-genre déjà classique, soit celui du récit post-cataclysmique, la couverture offre la plus désolante vacuité.
pleinement assumé, appartenant même à un sous-genre déjà classique, soit celui du récit post-cataclysmique, la couverture offre la plus désolante vacuité. Cette maquette créée par le Studio Gagnier, Fleury et Associés semble représenter, de manière épurée, un rivage quelconque. (De fait, le roman commence bien au bord de la Méditerranée.) Alors que Tétreau raconte les aventures de Silvana dans un monde bouleversé par des catastrophes aux origines complexes, la couverture ne laisse rien filtrer du propos. Une couverture « blanche », à la française, aurait tout aussi bien fait l'affaire dans ce cas.
Pourtant, Tétreau fait intervenir des escadres d'astronefs, fait allusion à une émergence de l'Atlantide et promène son héroïne dans plusieurs lieux de la péninsule italienne, voire de l'Europe. Certes, le projet semble vaciller entre le roman d'aventures ou de science-fiction, et le roman philosophique, mais on ne peut que déplorer la timidité de l'éditeur qui avait ici l'occasion de commander une couverture beaucoup plus dramatique. Le flou du positionnement esthétique de la science-fiction a sans doute joué un rôle. Et le désir de respectabilité l'a peut-être emporté...
